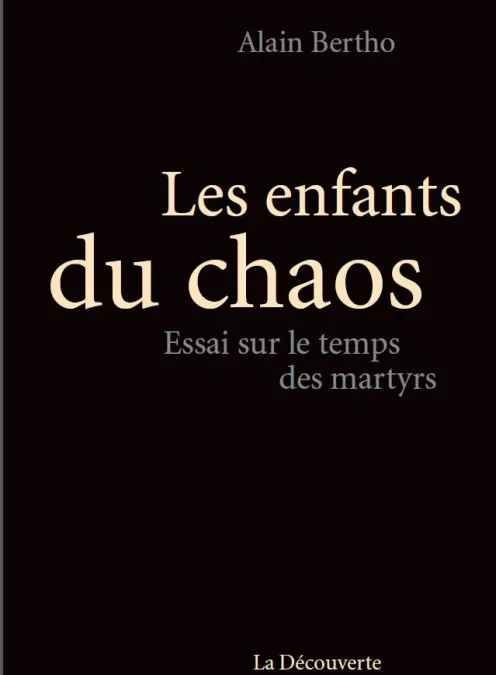Enjeux des répertoires de la violence durant le mouvement des Gilets Jaunes
Par Alain Bertho, professeur émérite d’anthropologie [1]
Intervention à la journée « Approches ethnographiques des Gilets jaunes : enquêtes et expériences », Lundi 28 et 29 octobre 2019, EHESS, Paris
Ma première participation à une réunion de collectif de Gilets Jaunes en Région Parisienne en décembre 2018, s’est ouverte par un tour de table sur l’expérience personnelle de la violence des participantes et participants lors du samedi précédent (acte 8). Étaient présents des générations différentes, des origines différentes, des expériences militantes (ou non expérience) diverses. Cette catharsis de l’expérience fut mon ticket d’entrée entre un jeune « street médic » et un syndicaliste chevronné qui avaient, tous les deux, vécu de près les affrontements et pour qui cette confrontation au pouvoir signait leur détermination tant individuelle que collective. Une autre syndicaliste sexagénaire s’est avérée par la suite une remarquable chroniqueuse de la répression vécue sur sa page Facebook. La brutalité de la répression était d’ailleurs plus spontanément réfléchie en termes pratiques (comment faire la prochaine fois ?) qu’en termes de dénonciation publique de la violence policière.
Nous sommes loin des clichés sur les blacks blocs « infiltrés ». À l’évidence, on ne peut pas cantonner la violence à un épiphénomène « regrettable » entre stratégie des Black Blocs et stratégie répressive. Elle est constitutive de l’événement, pour la mobilisation comme pour la réponse étatique qui lui a été donnée. Elle est constitutive du mouvement sur un registre si bien résumé par les manifestants chiliens lors du soulèvement déclenché par le prix du métro en octobre 2019 : « ils nous ont tout volé même la peur ».
Le rapport à la violence constitue une dimension incontournable du mouvement, de l’expérience collective qu’il a constitué, de sa capacité à faire tomber des clivages très anciens entre des résistances que le pouvoir pouvait jusqu’ici opposer les unes aux autres. Voici des décennies que la violence des révoltes ou au sein des révoltes est stigmatisée par le pourvoir qui met ainsi toute mobilisation en injonction de respectabilité : violence des « casseurs » dès 1970, violence de banlieues, violences du black bloc doivent être unanimement condamnés. Ce « consensus républicain » s’est brisé en décembre 2018. Même s’il existe depuis lors un réel débat au sein des Gilets jaunes, la confrontation physique avec le pouvoir est globalement admise. Une telle acceptation de masse est exceptionnelle dans l’histoire des mobilisations populaires
1. La violence comme objet d’étude
Cette brutalisation assumée de la mobilisation et sa résilience à la brutalisation du pouvoir éclaire des évolutions observées et analysées depuis plus de 12 ans et aujourd’hui confirmées par la vague de soulèvements de l’année 2019.
En effet si l’année s’ouvre sur le soulèvement français débuté dès le 17 novembre 2018, dès janvier, des peuples criaient leur colère au Venezuela et au Soudan où commençait une mobilisation de longue haleine. En février les villes d’Haïti se faisaient entendre contre la vie chère, celles du Sénégal étaient le théâtre de violences électorales . En Mars la jeunesse algérienne entamait un cycle de vendredis de mobilisation contre le « système ». En avril commençait une mobilisation universitaire en Colombie qui allait se prolonger jusqu’à l’automne. En mai (et jusqu’en octobre), la privatisation de la Santé et de l’École mettait le Honduras à feu et à sang. En juin, les ombrelles envahissaient les rues de Hong Kong en raison d’un projet de loi d’extradition. En août, le gouvernement indonésien faisait face à des émeutes en Papouasie. En septembre, les Haïtiens commençaient à réclamer bruyamment la démission de leur président Jovenel Moïse tandis que les indonésiens prenaient la rue contre une réforme du code pénal particulièrement rigoriste. Le mouvement s’accélère en octobre: soulèvement Oromo en Éthiopie contre Abiy Ahmed, premier ministre récemment nobélisé, en Bolivie contre Evo Morales, président réélu et soupçonné de fraude électorale, en Équateur contre le prix de l’essence décidé par le président Lenin Moreno, élu en 2017 sur des promesses socialistes, au Chili contre Sebastian Pinera et la hausse du prix du métro, à Panama contre une réforme constitutionnelle interdisant le mariage Gay, en Irak contre les pénuries et la corruption, au Liban contre une taxe sur WhatsApp, au Honduras contre un président, Juan Orlando Hernandez, dont le frère vient d’être condamné pour trafic de drogue, en Guinée Conakry contre le 3° mandat du président Alpha Condé, en Catalogne contre la condamnation des dirigeants indépendantistes et l’État espagnol. Le 16 novembre, l’augmentation du prix de l’essence déclenche une flambée d’émeutes en Iran, auxquelles le régime répond par une répression brutale et la coupure d’Internet. Une quarantaine de villes sont touchées dont la capitale, Téhéran. Au total, ces mobilisations d’une ampleur et d’une longueur variable, mais toutes aussi déterminées et prêtes à l’affrontement physique avec le pouvoir touchent 20 pays sur quatre continents.
Ces soulèvements massifs et largement populaires imposent leur présence physique par des cortèges ou, comme en 2011, par des occupations de places (place Tahrir à Bagdad, sit-in géant au Soudan). Ce sont des soulèvements d’engagement corporel, résilients face à la violence d’État, marquant par la mise en danger de soi la gravité et l’urgence de leurs exigences. En Irak et en Iran, les morts se comptent par centaines, comme les éborgnés en Chine ou au Chili.
Ce que nous appelons violence i.e. l’engagement direct des corps et leur mise en danger dans les rapports du peuple au pouvoir est une rupture mondiale avec la logique de représentation que constitue la politique moderne depuis la fin du XVIII° siècle. Cette rupture travaille dans chaque situation la capacité d’un pouvoir d’État à composer avec des mobilisations collectives, à les intégrer ou non dans un dispositif de représentation. L’initiative est en générale partagée. La montée mondiale des émeutes depuis le début du siècle montre l’incapacité actuelle des pouvoirs à entendre des colères récurrentes, à les intégrer dans des dispositifs de débat public et de concurrence politique et électorale.
Il est donc nécessaire d’analyser la violence comme un éléments de plus en plus important du répertoire de l’État comme des mobilisations collectives.(Tilly 2006, Nicolas 2002). Cette analyse est au centre de mes recherches depuis 2005. Une documentation quotidienne depuis 12 ans permet de tracer de grades tendances comme des inflexions conjoncturelles. On voit bien la montée de la brutalisation avant 2011. Mais l’année du printemps arabe ne constitue pas l’apogée révolutionnaire de cette poussée. A contraire, émeutes et affrontements civils continuent de progresser pendant deux ans notamment au cours de soulèvement de dimension nationale (Printemps érable au Québec, mobilisation autour de la place Taksim en Turquie, Euro maidan en Ukraine, mouvement brésilien contre l’augmentation des transports et la corruption). Mais cette brutalisation se manifeste aussi par la multiplication des événements localisés comme au travers des actes terroristes. En effet, le mouvement djihadiste s’inscrit dans la suite de ces colères et des échecs collectifs de l’année 2011. Dans le même temps le répertoire et le discours de la violence, voire de la guerre, ne fait que croitre depuis trente ans du côté d’Etats confrontés à une perte de légitimité dans leur gestion de la financiarisation du monde. (Joxe 2012).
2. La singularité française
Ce contexte s’est particulièrement incarné en France avec les émeutes de 2005, la logique de guerre (stratégie et armement) en banlieue et ses nombreuses victimes, la violence récurrente des mobilisations lycéennes, l’irruption de la « tête de cortège » lors des mobilisations contre les lois travail.
La France connait indiscutablement une montée forte de la violence collective depuis 2013 (année des Bonnets Rouges). Cette montée est jalonnée par les affrontements autour des ZAD (Sivens puis Notre Dame des Landes), les conflits liés aux quartiers populaires et aux bavures policières, notamment en 2017 (affaire Adam Traoré, mort le 19 juillet 2016 et affaire et Théo dont l’arrestation avec présomption de viol intervient le 2 février 2017), mais aussi les affrontements lors de mobilisations sociales (Loi travail 2016) ou en marge de celles-ci (les lycéens en 2010 et 2018) qui connaissent la progression la plus spectaculaire.
En 2018 (et certainement en 2019), le pays remporte une sorte de record mondial en nombre de situations violentes hors guerres civiles. L’essentiel de ces situations sont dues au début du mouvement des Gilets jaunes .
3. Répertoire d’État et stratégie de division, de la loi anti casseur à la sureté de l’État
Il n’est pas possible de parler du répertoire des mobilisations sans parler du répertoire de l’État dans ses trois dimensions : répressive (police et justice), législative, discursive. Les trois sont étroitement imbriquées dans une logique politique qui dépasse de loin la simple phénoménologie de « l’État policier ».
Cette logique politique est double. Il s’agit dans un premier temps d’identifier publiquement un danger, de le nommer, de le circonscrire et d’établir sur sa dangerosité plus ou moins exceptionnelle, un consensus répressif sur une loi d’exception : la délinquance, les banlieues, les casseurs, les terroristes, les gilets jaunes. Dans un second temps , il s’agit de passer de l’exceptionnalité des mesures à leur généralisation « ordinaire » (Kempf 2019) . Cette double logique assure dans le même temps le consentement à l’autorité selon la modalité « insécuritaire » (Joxe 2012) et le renforcement de l’autoritarisme et de l’arsenal répressif.
Le grand récit des « casseurs commence très tôt et prend ses racines en 1968. La première loi anticasseurs date 8 juin 1970. Elle renforçait également le contrôle des manifestants et, pénalisait la simple présence d’une manifestation qui bascule dans la violence. Sa justification était « républicaine » : « Il s’agit bien de la défense des libertés, collectives et individuelles, de la défense des personnes et des biens contre les tenants de la violence et les ennemis de la République », expliquait alors le Premier ministre Jacques Chaban-Delmas à l’Assemblée. Dénoncée comme liberticide elle est abrogée en novembre 1981.
La catégorie de « casseur » reste politiquement opératoire. Elle est largement mobilisée pour stigmatiser les affrontements lors des manifestations contre le Contrat première embauche en 2006 ou lors des manifestations contre l’OTAN ) Strasbourg en 2009. Dans le premier cas, il se double d’une stigmatisation de la jeunesse des quartiers populaires dits « de banlieue »e quelques semaines après les émeutes d’octobre novembre2005. Dans le second , il signe l’entrée en fanfare des Black block sur la scène française (Boidy 2014).
En 2006, des groupes de jeunes mobiles et violents sèment le trouble lors de la première manifestation étudiante à caractère national (23 mars 2006), s’en prenant à la fois aux manifestants et aux forces de l’ordre notamment en fin de parcours sur l’esplanade des invalides. Ces jeunes, « n’ont rien à voir avec la manifestation » assurent d’une même voix les organisations « responsables », syndicats de salariés comme syndicats étudiants . De cette caractérisation sécuritaire, voire policière d‘une tension certes sérieuse, mais d’une tension au sein même de la jeunesse populaire, découle une situation sidérante : le 28 mars, la manifestation monstre à Paris défile sous la protection de la police. Et lors de la dispersion, les forces de police collaborent avec des services d’ordre syndicaux auxquels le ministre de l’intérieur ne manquera pas de rendre hommage.
En 2009, l’action des Black Blocs génère des réactions complotistes classiques sur une « impunité » supposée de la police à leur endroit. En dénonçant la provocation, les organisations ayant pignon sur rue retournent à l’État l’injonction de respectabilité pacifique qui leur est faite. Le maire PS de Strasbourg, Roland Ries, réclame ainsi «que les responsables de la police expriment la stratégie qui a été menée» et «les raisons pour lesquelles on est arrivé à de pareilles dégradations et à de pareilles exactions».
En 2016, la stigmatisation de ce qui est devenu « le cortège de tête » est plus compliquée. Se rejoignent alors des manifestants soucieux de sortir des formes traditionnelles des défilés syndicaux et des réseaux qui font du « débordement » violent du mouvement social une stratégie consciente. Tandis que l’amalgame se fait entre ces deux subjectivités manifestantes, on observe de plus en plus de porosité avec une partie des manifestants dont la colère alimentait une envie certaine d’en découdre. Lors des affrontements le cortège de tête non seulement n’est pas isolé du reste du cortège mais il peut y puiser des forces supplémentaires. La pression de l’État est à son maximum lors de la manifestation du 23 juin 2016 réduite à un tour du bassin de l’Arsenal à Paris, entièrement nassée et sous contrôle total des forces de l’ordre. Le mouvement « Nuit debout » pour sa part tente d’éviter à tout prix la confrontation et ne cherche pas à occuper la place de la République 24 heures sur 24. Cet évitement assumé n’a sans doute pas facilité le lien entre les occupations de places à la française et les quartiers populaires.
Ces derniers ne sont en effet pas passé par la phase d’injonction à la respectabilité pacifique, mais ont été d’emblée, dès les années 1990, un laboratoire de la répression violente dont la logique s’est généralisée en 2018-2019. Dès 1994, Charles Pasqua généralise la Brigade anticriminalité (BAC), à l’origine parisienne, à l’ensemble du territoire. On en compte aujourd’hui 300. En 1995, son successeur Jean Louis Debré introduit le Flashball de la BAC, ancêtre du LBD, dans l’arsenal répressif. On compte 25 ainsi éborgnés par tir de Flash Ball entre 1995 et 2018.
Enfin le choc des attentats de 2015 fait franchir le pas qui sépare la politique sécuritaire de la logique de sureté de l’État avec l’État d’urgence promulgué le 13 novembre 2015. L’État d’urgence passe dans la loi ordinaire avec le vote de la loi antiterroriste votée le 3 octobre 2017, entrée en vigueur le 1 novembre. Cet arsenal est mobilisé dès 2015 lors de l’organisation de la COP 21 à Paris contre le militants écologistes.
Ainsi, jusqu’en 2018, le répertoire d’État, arsenal juridique, pratiques répressives et discours politique, est donc un répertoire de division : les banlieues contre les classes populaires blanches, cœur de cible du discours sécuritaire, les casseurs contre les syndicalistes responsables et respectables, les terroristes contre la France. Cette stratégie de division a été ébranlée par l’expérience large de la répression et des dénis de droit durant le mouvement des Gilets Jaunes.
4. Lexique du corps et symbolique de la révolte
Le mouvement des gilets jaunes est d’emblée marqué par la rencontre des deux cheminements que nous venons de détailler : celui du répertoire répressif de l’État et celui du rapport du mouvement populaire à la brutalisation des rapports avec ce dernier.
Les groupes organisés connus sous le nom de Black Blocs qui avaient participé à l’animation des têtes de cortège de 2016 et celui, spectaculaire, du 1 mai 2018 trouvent rapidement leur place au sein des premières manifestations de Gilets jaunes, notamment à Paris. Leur stratégie et leur pratique de confrontation est adoptée par une part grandissante des manifestants.
Cette rencontre se quantifie. On compte 381 affrontements (un lieu/un jour) répertoriés entre le 18 novembre 2018 et le 29 juin 2019 dans 99 villes différentes. Il faut y ajouter les 187 affrontements du mouvement lycéen entre le 19 novembre et le 13 décembre dans 132 villes. Nous sommes confrontés à un phénomène national.
Si comme le disait Martin Luther King le 14 mars 1968, « l’émeute est le langage de celui qui n’est pas entendu », il nous faut comprendre le lexique de cette violence qui ne fut pas marginale dans le mouvement notamment dans la phase qu’on pourra appeler « de soulèvement » entre décembre et janvier.
C’est bien un répertoire propre de la mobilisation qui se déploie comme une violence symbolique. Contrairement à 2005 où elle fut cantonnée aux quartiers périphériques ou aux violences de 2016 tributaires des parcours syndicaux quant à leur localisation, la violence de 2018-2019 vise explicitement les centres villes, les lieux de luxe et les lieux de pouvoir, des bâtiments officiels, jusqu’à une préfecture du Massif Central (Le Puy en Velay, 1 décembre 2018) ou un secrétariat d’État ( 5 janvier 2019).[2]
Il faut avoir fréquenté ces situations et leurs acteurs pour saisir la subjectivité à l’œuvre dans ces passages à l’acte bien souvent non programmés[Romain Huet 2019]. Entrainés par des groupes dont c’est la stratégie, celles et ceux qui ont franchi le pas ou sont restés solidaires expriment un sentiment de puissance retrouvée, de puissance aux mains nues à l’instar de Christophe Dettinger, le « boxeur gitan » (Peillon 2019). Ce dernier, champion de France des poids lourds-légers en 2007 qui a mis fin à sa carrière en domine l’2013, repousse un groupe de gendarmes à coup de poing sur la passerelle Léopold-Sédar-Senghor le 5 janvier 2019. Il défend alors une femme frappée à terre par un gendarme. Mais à la suite d’une plainte de deux membres des forces de l’ordre, il se rend de lui-même à la police le 7 janvier[3]. Une cagnotte en ligne sur la plateforme Leetchi atteint 117 000 euros avec 7 500 contributeurs le 8 janvier. Il devient alors une sorte d’icone dont le nom revient dans les banderoles et les slogans et dont le portrait monumental est au centre de la fresque sur les Gilets Jaunes réalisée par le collectif Black Lines rue d’Aubervilliers à Paris.
Ce répertoire assumé par une bonne partie du mouvement n’a pas beaucoup pesé sur sa popularité. Un militant septuagénaire m’a ainsi confié son « sentiment de plénitude » lors de l’acte 8 qui fut particulièrement violent.
5. La violence comme expérience de l’État
L’asymétrie des répertoires de l’État et des Gilets jaunes ne fait pas de doute. Comme le montre Romain Huet (Huet 2019), le « vertige de l’émeute » est d’abord celui du défi lancé par des manifestants désarmés à une puissance de répression dont on connait la supériorité. La mise en danger de soi domine l’engagement physique, la rage s’exprime essentiellement contre des biens matériels.
Il n’est est pas de même du répertoire institutionnel de la répression dont les effets ont été bien documentés tant par le travail du journaliste David Dufresne[4] que par le documentaire de Street Press.[5]
On connait les Chiffres officiels (Ministère de l’Intérieur) au 23.05.2019 : 19 071 tirs de LBD, 1 428 tirs de grenades lacrymogènes instantanées (chiffre inchangé depuis mars !), 5 420tirs de grenades de désencerclement , 2 448 blessés, 10 «dommages irrémédiables à l’œil», 8 700 gardes à vue et 1 796 condamnations, 561 signalements déposés à l’IGPN et 265 enquêtes de l’IGPN, 8 enquêtes administratives, 15 enquêtes judiciaires de l’IGGN, 72 enquêtes transmises au Parquet.
Les chiffres de David Dufresne sont à la fois plus précis et plus dramatiques : 2 décès, 315 blessures à la tête, 24 éborgnés (autant qu’entre 1995 et 2018), 5 mains arrachées…. La violence de la répression du mouvement lycéen dans 131 villes du 19 novembre au 13 décembre 2018 permet de dire que l’objectif était bien de l’écraser le plus vite possible.
L’expérience de cette répression a certes pesé sur la participation aux « actes » du samedi. Mais elle a aussi alimenté un sentiment de puissance qui se mesure au calme impressionnant des manifestants, pourtant souvent peu aguerris, face à une violence d’État sans précédent depuis un demi-siècle. La participation aux manifestations parisiennes au plus près possible des heurts, des discussions avec des gilets jaunes, m’ont fait constater d’abord une très grande résilience au danger de la part de personnes primo manifestantes comme de militantes et de militants septuagénaires. La mise en danger de soi était le prix à payer de la colère, une marque de l’engagement total (physique) de personnes qui, par le port du Gilet, même après des semaines de répression, se transformaient en cibles jaunes !
C’est ainsi que l’expérience de la violence est apparue comme une sorte de ticket d’entrée au groupe de gilets jaunes que j’ai intégré. Or ce groupe, totalement paritaire, intergénérationnel, réunissant de vieux militants ouvriers et des jeunes nouveaux venus des mobilisations dont un street-médic, n’avait en son sein aucun habitué militant des têtes de cortège. Le groupe fit unanimement corps avec l’élan de solidarité autour du boxeur Christophe Dettinger.
Des femmes Gilets jaunes de toutes générations ont exprimé leur compréhension vis-à-vis de ce répertoire en raison de l’attitude de la police. Dans les échanges, la présence du Black Bloc est considérée comme légitime, voire rassurante.[6].
La stratégie de la tension et de la répression choisie par le pouvoir a donc eu pour effet en premier lieu de légitimer le répertoire de « l’émeute » (Huet 2019). Elle a eu aussi pour effet d’opérer des rapprochements improbables. Le sort réservé aux lycées de Mantes la Jolie le 6 décembre 2018 est ainsi le point de départ de gestes de solidarité des manifestations de gilets jaunes dans plusieurs villes françaises le samedi suivant.
Mantes, 6 décembre 2018.
Paris, 8 décembre 2018.
Besançon, 8 décembre 2018
Orléans, 8 décembre 2018
Le pouvoir, en réprimant ceux qui étaient le cœur de cible de son discours sécuritaire anti-banlieue fait tomber des murs. Des témoignages circulent sur internet de gilets jaunes se mettant à « comprendre » les banlieues, comme celui de Cyril Perpina, chef d’entreprise le 6 janvier sur Facebook : « Ah, ben écoutez si vous croisez des « jeunes » ou moins jeunes de banlieue défavorisées, vous leur direz de ma part que s’il y a une chose que ce mouvement m’a appris, c’est de reconsidérer complétement le regard que je portais sur cette « racaille » et sa violence supposée. Moi, ça fait 1mois et 1/2 qu’on s’en prend plein la tronche une petite fois par semaine, et je suis déjà limite à bout, alors je n’imagine même pas la colère qu’ils peuvent avoir en eux de subir ce qu’ils subissent ou disent subir. Bref, je crois bien que c’est la 1ere fois que je me sens proche d’eux, et je me dis quasi tous les jours que j’ai été bien con, avec mes yeux de blanc moyen privilégié. Merci. »
Une jonction est possible. Elle a été préparée par le Comité « Vérité et justice pour Adama »[7] qui appelle dès le 27 novembre à rejoindre les Gilets jaunes. Cette jonction possible fut l’objet du meeting « Alliance Gilets Jaunes et quartiers populaires » à la Bourse du travail de Saint-Denis le 17 février 2019 en présence de Priscilla Ludovsky et Assa Traoré.
6. Images et imaginaire de la violence
Cette expérience partagée de la répression a donné lieu à une production culturelle diversifiée. Ce répertoire s’affiche et se chante dans une production souvent référencée : imagerie révolutionnaires, images iconiques du street art. Le mouvement inspire le jeune rappeur D1ST1 qui fait deux clips au milieu des lacrymogènes à Toulouse[8]. Son premier clip enregistré sur NFCA média (page Facebook) dépasse très vite les 2 millions de vues. Le Street Art[9] y prend sa part avec des images qui parlent dans toutes les régions de France. L’héroïsation y est plus présente que la victimisation.
Le 6 janvier 2019, dans le XIXe arrondissement de Paris, Pascal Boyart, alias PBoy a ainsi repris La Liberté guidant le peuple de Delacroix, en version «gilets jaunes».[10] Le 1 février le street-artiste Fred Le Chevalier [11] partage un collage de son personnage fétiche l’œil en sang, à côté d’une inscription: «Qui nous protège de la police?».
Les interventions les plus impressionnantes sont sans doute celles du collectif Black Lines. Ce collectif né en mai 2018[12] notamment à l’initiative des trois graffeurs du « crew » TWE, produit une fresque monumentale de 300 mètres pour les Gilets Jaunes et Christophe Dettinger le 20 janvier 2019 rue d’Aubervilliers à Paris. Une vingtaine d’artistes est mise à contribution. La fresque est effacée par la Mairie de Paris Le 25 février le même collectif récidive avec une trentaine d’artistes rue de la Poterne des Peupliers, dans le 13e arrondissement de Paris, La fresque de 100 mètres, baptisée « Hiver jaune 2 » moins polarisée sur la violence, inclue cette fois-ci un portrait géant de Jérôme Rodriguez éborgné. Elle sera elle-même vite effacée.
Si de nombreuses interventions graphiques restent anonymes comme le pochoir « mutilé pour l’exemple » du plateau de Milles Vaches ou la barricade de Châlons-en-Champagne, les icones du street at inspirent les œuvres. Inspiration ou original ?? en février 2019, cour d’Albret à Bordeaux la fameuse petite fille au ballon de Banksy fait son apparition avec une main arrachée.
A. Images de victimisation
Fresque de Black Lines rue d’Aubervilliers à Paris
Fred Le Chevallier, Paris
Plateau de Milles Vaches[13]
Banksy, Bordeaux
B. Images de résistance et héroïsation
PBoy La Liberté guidant le peuple ; 6 janvier 23019, Paris
Fresques de Black Lines Poterne des Peupliers, Paris
Fresques de Black Lines, rue d’Aubervilliers, Paris
Chalons en Champagne
C. Icones
Monistrol sur Loire
Lieu inconnu [14]
7. « Ils nous ont tout volé même la peur »
Les soulèvements qui se répandent dans le monde en 2019 et singulièrement à l’automne éclairent rétrospectivement cette centralité de la violence dans le mouvement des Gilets jaunes. Leur déclencheur est toujours très concret et lié à une décision ou des pratiques gouvernementales ressenties comme une mise en danger de la survie matérielle des personnes et des familles ou une remise en cause des libertés : le tarif des transports ou du carburant en France, en Équateur, au Chili ou en Iran, une loi liberticide en Indonésie, à Panama ou Hong Kong, des élections peu démocratiques en Algérie, en Bolivie et en Guinée, une taxe sur les communications au Liban. Comme en 2011, ce sont des soulèvements qui, sauf exception (Éthiopie peut-être), se font sans crier gare c’est-à-dire sans préparation, sans organisation, sans leader. Ce sont des soulèvements massifs et largement populaires, qui imposent leur présence physique par des cortèges ou, comme en 2011, par des occupations de places (place Tahrir à Bagdad, sit-in géant au Soudan). Leurs répertoires semblent en écho les uns des autres. Ce sont des soulèvements d’engagement corporel, résilients face à la violence d’État, marquant par la mise en danger de soi la gravité et l’urgence de leurs exigences. Car faute d’arguments et de légitimité, la réponse des gouvernements est toujours la même : une répression de plus en plus féroce. Si, comme l’analysait Foucault, « la politique, c’est la guerre continuée par d’autres moyens »[15], alors la disparition de la politique caractéristique de notre temps ouvre à la possibilité d’une guerre menée par des pouvoirs contre leur propres peuples.[16] Le président chilien Sebastian Pinera le déclare lui-même le 21 octobre : « Nous sommes en guerre contre un ennemi puissant, implacable, qui ne respecte rien ni personne et qui est prêt à faire usage de la violence et de la délinquance sans aucune limite ». Sur le fond, le ministre français de l’Intérieur ne disait pas autre chose au plus fort de la mobilisation des Gilets Jaunes. La violence de la réaction des gouvernements face aux soulèvements de 2019 est à la mesure de la peur qu’ils leur ont inspirée.
L’énigme persistante des soulèvements de 2019 comme des vagues successives de révolte qui les ont précédées est leur absence de subjectivité historique. Elles laissent l’eschatologie révolutionnaire aux mouvements terroristes, notamment à Daesh, qui eux-mêmes s’inscrivent dans une historicité de l’apocalypse et du jugement dernier. Si ces révoltes se rejoignent sur la dénonciation d’un système qui broie le vivant au nom du profit avec la complicité zélée des États, aucune ne met en avant une alternative possible et aucune ne part d’une dénonciation globale. Au contraire le mécanisme est partout le même : une décision de trop fait déborder le vase, l’exigence de changement est immédiate et adresse à l’État une injonction de moralité et d’esprit public. La corruption et l’incompétence sont la cible mondiale des colères. La crise se donne comme une crise mondiale de la gouvernementalité qui avec la remise en cause de toute forme de représentation, brutalise partout les rapports des peuples au pouvoir.
Le consentement aux pouvoirs s’alimente toujours d’une espérance ou d’une peur et d’une promesse ou d’une crainte d’avenir. La mobilisation politique capte les rêves autant que les colères. Quand ni les pouvoirs ni les partis ne sont en capacité de dessiner un futur, les peuples, comme le peuple chilien en octobre 2019, peuvent aussi crier « ils nous ont tout volé, même la peur »[17]. Si aujourd’hui gouverner s’apparente de plus en plus à la guerre, c’est que cette abolition de l’avenir est en train de rendre les peuples ingouvernables.
Références
Bertho Alain, 2019, “L’effondrement a commencé, il est politique”, Terrestres, 21 novembre 2019
Bertho Alain, 2018, The Age of Violence: The Crisis of Policy and the End of Utopia, Verso, London.
Bertho Alain, 2009, Le temps des émeutes, éd. Bayard.
Bertho Alain, 2019, « Le siècle à l’épreuve de sa violence », in Les Etats européens face aux militantismes violents ; dynamiques d’escalade et de désescalade, Dir Romain Sèze, Rive Neuve.
Bertho Alain 2016, « Les murs parlent de nous. Esthétique politique des singularités quelconques », Cahiers de Narratologie [En ligne], 29 | mis en ligne le 13 janvier 2016, URL : http://narratologie.revues.org/7410.
Boidy Maxime, 2014, Une iconologie politique du voilement. Sociologie et culture visuelle du black bloc, thèse soutenue à Strasbourg.
Huet Romain, 2019, Le vertige de l’émeute, PUF.
Joxe Alain, 2012, Les guerres de l’empire global. Spéculations financières, guerres robotiques, résistance démocratique, La Découverte
Nicolas Jean, 2002, La rébellion française. Mouvements populaires et conscience sociale ( 1661-1789),Paris, Seuil, 2002J
Kempf Raphaël, 2019, Ennemis d’Etat. Les lois scélérates, des anarchistes aux terroristes, La Fabrique
Peillon Antoine , 2019, Cœur de boxeur : le vrai combat de Christophe Dettinger, Paris, Les Liens qui libèrent
Tilly Charles, 2006, Regimes and Repertoires , University of Chicago Press
Notes
[1] Cet article s’appuie sur des éléments d’enquête spécifiques entre décembre 2018 et juillet 2019 : participation aux manifestations parisiennes, participation à un groupe de Gilets Jaunes en banlieue parisienne, constitution d’une statistique nationale sur la violence durant les manifestations et durant le mouvement lycéen, participation à des groupes en ligne, travail de « l’atelier des ronds-points » (chercheurs et gilets jaunes) à la MSH PN.
[2] Le procès des cinq Gilets jaunes âgés de 22 à 47 ans jugés pour avoir conduit le chariot élévateur qui a forcé la porte, été à bord ou filmé la scène a été reporté une quatrième fois le 13 décembre 2019 devant la 14 chambre du TGI de Paris.
[3] Le 13 février 2019, le tribunal correctionnel de Paris le condamne à 30 mois de prison : 12 mois de prison ferme, suivis de 18 mois avec sursis et mise à l’épreuve.,
[4] “Six mois d’«Allô Place Beauvau»: chronique des violences d’Etat”, Médiapart, 17 mai 2019, https://www.mediapart.fr/journal/france/170519/six-mois-d-allo-place-beauvau-chronique-des-violences-d-etat?onglet=full
[5] “Gilets jaunes, une répression d’État », Streetpress.com, 21 mai 2019, https://www.youtube.com/watch?v=3MjuoDpKLfI
[6] Journées d’étude de juin 2019, Atelier des Ronds-Points, MSH Paris Nord
[7] https://www.facebook.com/pages/category/Event/La-v%C3%A9rit%C3%A9-pour-Adama-160752057668634/
[8] https://www.youtube.com/channel/UCN-2-BfDdHwLo1zpERLV5ZA
[9] “Comment l’art urbain s’empare des symbols des Gilets jaunes”, Le Figaro.fr, Bandine Le Cain, 8 février 2019
[10] https://www.pboy-art.com/galerie
[11] https://www.instagram.com/fredlechevalier/
[12] « Le collectif d’artistes Black Lines fait de la peinture « un moyen de lutte », Les Inrockuptibles, Amélie Quentel, 21 décembre 2019
[13] Source : http://www.ricochets.cc/Gilets-jaunes-revue-de-presse-du-17-janvier.html
[14] Source : http://www.ricochets.cc/Gilets-jaunes-revue-de-presse-du-13-janvier.html
[15] M. Foucault, Il faut défendre la société. Cours au Collège de France, 1975-1976, Paris, Gallimard – Seuil (Hautes études), 1997, p. 15-16.
[16] Alain Bertho, « Guerre, gouvernement, police », in Dire la guerre, penser la paix dirigé par Frédéric Rognon, Labor et Fides, pages154-160. Alain Bertho, « La fin de la politique ? », in Ethnographiques.org, « L’anthropologie face aux ruptures », mai 2014.
[17] Porque nos robaron todo, incluso el miedo