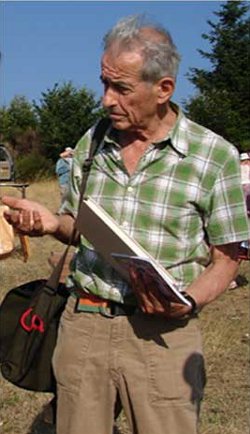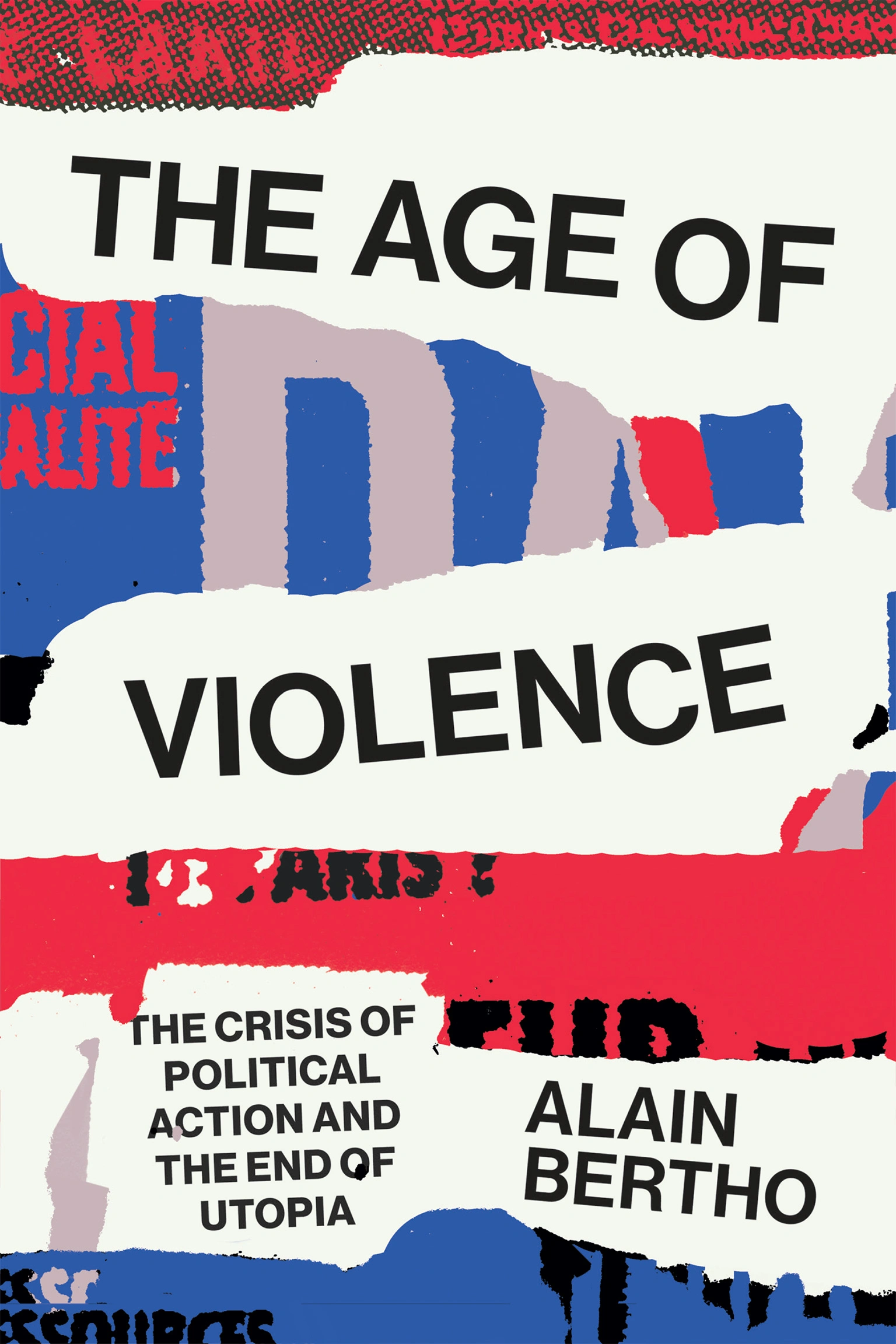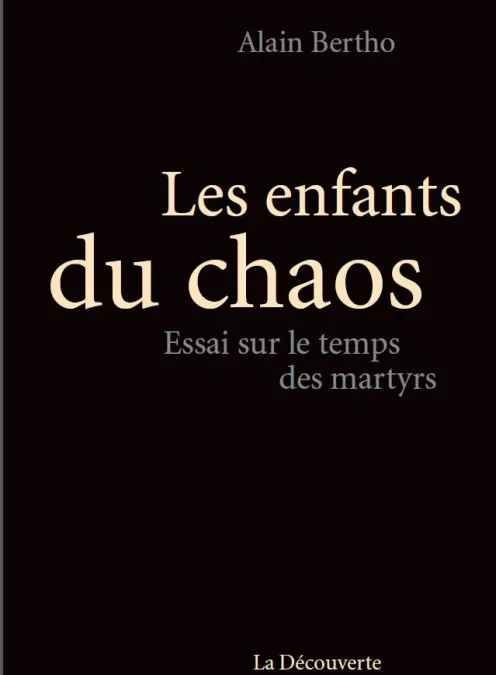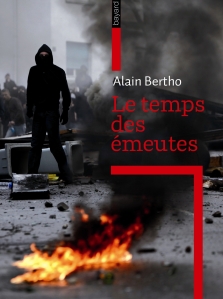Jean Nicolas et les émeutes d’avant 1789

La rébellion française – Mouvements populaires et conscience sociale 1661-1789 par Jean Nicolas
Paru le : 14/11/2008 Editeur : Gallimard (Editions) Collection : Folio Histoire ISBN : 978-2-07-035971-4 EAN : 9782070359714 Nb. de pages : 1076 pages Prix éditeur : 12,10€
De la Fronde et la révolution de 1789, Jean Nicolas analyse la violence populaire, dans ses dimensions libératrices, passéistes et novatrices. Croisant les approches – sociologique, anthropologique, économique -, il parcourt un champ jusque-là peu exploré : la vie au jour le jour, avec les cris pour le pain, la contrebande du sel et du tabac, la grève à la fabrique. Mais la mobilisation porte aussi sur d’autres enjeux moins immédiats, autour de certitudes et d’espérances, tout ce que recouvrent les mots dignité, liberté pour l’individu porté par le groupe, pour la collectivité réduite ou élargie. Place est enfin faite, dans le grand récit historique national, aux irréductibles, à tous les refus jetés à la face des hiérarchies et des pouvoirs. La rébellion constitue un mode qui a fait du heurt et de la rupture le principe du changement dans l’espace français.
Sommaire:
LES ARCHIVES DU DESORDRE Ce que disent les mots L’enquête Vues cavalières
UN MONDE DE PASSEURS Les mailles du filet Panoplie répressive Figures de la rébellion Fraudeurs en uniformes Contrebandes ordinaires Temps et lieux » Les champs de bataille «
ACTEURS ET COMPLICES Troubles urbains Réactions villageoises Groupes à risque
UNIS CONTRE LES FERMES Un entrelacs de solidarités Responsabilité collective Sedan : le coup de semonce
IL NOUS FAUT PAYER LA TAILLE Croquants tardifs L’impossible réforme La taille : une affaire de paroisse La » maîtrise des rôles » Huissiers, sergents, séquestres, garnisaires
LA SEIGNEURIE CONTESTEE Présence du fief La défense des communaux Le paiement des redevances L’épreuve des » rénovations » Chasser, pêcher : » parce que c’est notre droit » » Les trophées de l’orgueil du monde » Néo-seigneurs, seigneurs engagiers Esquisse de bilan
JOURS SANS PAIN Figures de l’émeute Le temps et l’espace 1661-1789, les décennies calamiteuses 1709, les horreurs du grand hiver Entre deux paroxysmes : les années 1711-1763 Le grand massif : 1764-1775 Ultimes sursauts : 1776-1789
POLITIQUES DE LA FAIM Acteurs Notables entre deux feux Messages
LES CONFLITS AUTOUR DU TRAVAIL Le marché du travail Les salaires Pour ou contre la liberté d’entreprendre Conflits internes » Baccanals » aux champs
DIGNITE, LIBERTE Résister à la contrainte Echapper à la justice Servir le roi ? L’indocilité des peuples » Adesso la corsica «
JEUNESSE, JEUNESSE Temps, rythmes, mobiles Maîtres chez nous Jeunesse frondeuse Fermentations
L’ESPACE DU SACRE Résistances paroissiales Les réformés face à l’intolérance Les troubles autour du jansénisme
Il a étudié 1800 rébellions françaises
mercredi 8 juillet 2009
De la période qui sépare la Fronde jusqu’à la révolution de 1789, l’historien Jean Nicolas a étudié des centaines d’émeutes populaires. Ce qu’elles peuvent nous enseigner sur la crise économique et sociale actuelle est que la rébellion est une vraie exception française. La rentrée sera chaude ?
Il suffisait de lire les archives de justice comme l’historien Jean Nicolas durant une quarantaine d’années. Elles regorgent de micro-émeutes débordant la réalité, débouchant sur des modes de protestation de plus en plus construits. Jean Nicolas en a étudié mille huit cent entre 1661 et 1789, mais il estime en avoir laissé de côté un bon millier. « Ces archives, d’une richesse incroyable, mais très mal classées, proviennent de la police, de la maréchaussée, de la justice ou encore des recours des procureurs et des mémoires défensifs des avocats », explicite le spécialiste à IDEE A JOUR.
« La rébellion n’est pas contre le pouvoir, elle est une protestation contre un pouvoir qui franchit ses limites, précise t-il. Ensuite, elle peut changer de nature, d’affectivité et déboucher vers une remise en cause radicale de ce pouvoir, c’est-à-dire la révolution. La France rébellionnaire est une réalité vivante et profonde, elle constitue même un mode collectif qui a fait du heurt et de la rupture le principe même du changement dans ce pays. » Une exception française en somme dont on peut fixer l’extrait de naissance vers les années 1660, entre la Fronde et la révolution de 1789. Auparavant, existaient les jacqueries, les croquants, les va-nu-pieds, fort nombreux, fort actifs. Mais ils constituaient autant de mouvements « conservateurs », pré-libertariens, tournés contre cette autorité monarchique en train de se consolider et qui empiétait notamment fiscalement sur leurs droits traditionnels. Après la Fronde, la rébellion change sensiblement de nature.
Des historiens allemands, comparant cette période, se sont dit surpris par l’intensité et de la multiplication des mouvements rébellionnaires à la française. « C’est une époque sous tension. Le régime monarchique est le règne de l’intranquillité par excellence, contrairement à ce que l’on imagine aujourd’hui, décrit Jean Nicolas. Les gens vivent dans une forme permanente d’anxiété. Ils ont le souci de survivre. La mendicité et l’errance s’étendent. Les peurs de l’époque sont celles de la précarisation, de l’échec des ambitions individuelles, notamment des petits clercs qui n’est pas sans rappeler la crise actuelle de l’université. Les salariés non qualifiés, cette armée des hommes de peine, suscitent également beaucoup d’inquiétude. »
« J’avoue que j’ai tremblé toutes les fois que j’ai vu la portion basse de ce peuple en émotion ! » écrira en 1788, le chroniqueur Restif de la Bretonne.
Les élites de 2009 se comportent comme les élites de 1789
Les ancêtres des « Conti » et autres licenciés protestataires qui ont défrayé la chronique sociale du premier semestre 2009 se croisent dans des conflits pour le pain, la grève à la fabrique, le refus de droits seigneuriaux, les taxes sur le sel et le tabac. Eclatant un peu partout par dizaines, mais encore de basse intensité, « ces mouvements cellulaires » auront fini par cristalliser en phénomène politique.
Par exemple, cette affaire locale élémentaire. Des paysans, protestant contre les droits seigneuriaux abusifs, arrachent les insignes du seigneur de son ban à l’église. Traînés en justice, ils vont alors quérir les services d’un célèbre avocat. Ce ténor de Grenoble lui va se référer à Montesquieu et aux Lumières devant les juges. Ce phénomène de protestation devient politique, ce que refusent de voir la majorité des grandes élites.
« L’ADN de la Grande rébellion historique qui a revêtu un caractère historique fabuleux a été la Grande Peur », marque t-il. L’attaque et le brûlage des châteaux dûs à la panique et à la rumeur d’un complot aristocratique auront constitué dans leur désorganisation, l’événement clé débouchant sur l’abolition des privilèges et la déclaration des droits de l’homme et du citoyen (juillet-août 1789).
« Sans gauchir la réalité, nous sommes avec ces rébellions, au vif du sujet. Il ne s’agissait plus de pain, plus d’octroi et de barrières douanières, mais au cœur du problème, la contestation du privilège. » En 2009, cette question égalitaire devant les situations revient sur le devant de la scène française et dans les débats, mais elle ne l’avait jamais vraiment quitté selon Jean Nicolas. «
L’historien qui a étudié le grand aveuglement des élites de 1789 ne peut s’empêcher tout de même « de faire un rapprochement avec le comportement de nos élites financières et bancaires contemporaines en temps de crise ».
POLITIQUE DE LA RÉBELLION
En explorant le » champ rébellionnaire » de la France entre la prise du pouvoir de Louis XIV et la Révolution de 1789, Jean Nicolas réoriente le regard sur la réalité et le sens des » contestations » de la fin de l’Ancien Régime. Un article de l’historien Claude Mazauric (*).
Au sens propre du qualificatif, voici un livre formidable (1) : une somme incroyablement riche de faits et d’analyses qui feront date, un ouvrage qui est le fruit arrivé à maturité d’un effort de recherche de plusieurs décennies, conduit avec maîtrise par un historien dont on admirera au surplus la plume précise, l’expression directe, le style limpide (ce qui devient rare). Mais surtout, le livre de Jean Nicolas contribuera à réorienter le regard que nous portons sur l’ancienne France des XVIIe et XVIIIe siècles, qu’on pourrait croire lointaine et qu’on sent pourtant, à la lecture de l’ouvrage, si proche. Pour peu que nous soyons attentifs dans l’actualité aux permanences de longue durée des comportements, affects et représentations, à la prégnance des héritages symboliques et mentaux, aux enjeux comme aux formes affichées de la revendication sociale, nous lirons le livre de Nicolas sur les contestations anciennes avec le regard de celui, de celle qui veut comprendre avec la profondeur que donnent la connaissance de l’histoire, la nature spécifique, les formes et les arguments de légitimation des luttes et contestations d’aujourd’hui autant que d’hier.
Qu’est-ce qu’une » rébellion » ? Les autorités de l’Ancien Régime disposaient de mots variés pour le dire, du plus euphémisant au plus excessif : » sensation « , » agitation « , » tumulte « , » mutinerie « , » attroupement « , » révolte « , etc. et même » sédition « , sans compter les appellations propres à chaque province ou dialecte ou type d’activité… Dans son enquête, Jean Nicolas accepte tous les types de contestation impliquant un minimum de » violence collective non canalisée » : il entend par là ce qui relèverait d’un effet » d’accommodement « , de compromis ou de » recours judiciaire « . De 1661 à 1789, il dénombre ainsi 8 528 » affaires » relevant de sa définition : évaluation impressionnante et qui ne représente cependant qu’un relevé minimum des faits, ceux dont les sources d’archives ont conservé la trace écrite ! Le traitement informatisé des données recueillies et traitées selon une grille permettant classification et comparaison, conduit à distinguer 72 types de conflits regroupés en 13 catégories, régionalement répartis en 26 unités provinciales sur tout l’espace français tel qu’il est devenu aujourd’hui, incluant donc, outre les territoires et enclaves acquis pendant le règne de Louis XIV, la Lorraine ducale, la Corse, la Savoie, Avignon et le Comtat (…) La » France rébellionnaire » est aussi bien urbaine que villageoise : partout, en réalité, a régné » l’intranquillité « , ce dissensus facteur de créativité, de marche en avant, de progrès. Jean Nicolas place son livre sous l’invocation d’Héraclite : » Toutes choses sont engendrées par la discorde « . C’est dire qu’il n’a pas une conception frileuse ou culpabilisée de son sujet.
La forte diversité régionale de cette France émeutière était bien connue ; elle se confirme : un Grand Sud rural se différencie d’un Nord plus urbanisé et traversé de routes, les pays de bocages et de montagnes se distinguent des grandes plaines ouvertes à l’échange, le littoral de l’intérieur, mais partout des luttes collectives ! Une certaine manière d’écrire l’histoire devenue internationalement hégémonique, créditait l’État moderne absolutiste, construit aux lendemains des graves crises de la moitié du XVIIe siècle, d’avoir su imposer un ordre bureaucratico-clérical assorti qui plus est du » consentement des peuples « . Les tendances rébellionnaires se seraient donc atténuées, la Révolution française, dans sa dimension de révolution populaire et sociale, intervenant en quelque sorte à contresens de l’évolution sous l’effet d’une crise politique venue d’en haut : tout faux, nous démontre Jean Nicolas !
L’étude du » mouvement séculaire » montre au contraire la permanence depuis 1661 de la contestation sociale rébellionnaire, puis sa montée régulière et massive à partir de 1740 jusqu’en 1789, avec des moments paroxystiques, 1694-1695, 1709-1710, 1755-1765, 1775-1776, puis l’envolée de 1788. Dans ces conditions, sans céder à une interprétation de type téléologique, 1789 et la suite nationale des grandes révoltes et insurrections qui ont suivi la convocation des états généraux et poussé en avant la marche de la Révolution, apparaissent comme un couronnement et la résultante de tout un mouvement qui vient de loin. (…) Ceux qui prétendaient lire la société comme un » texte » dont on aurait évacué la dimension conflictuelle, devront revoir leur copie en cessant de tenir pour négligeables les luttes réelles et la conscience sociale que révèlent les proclamations qui les accompagnent comme ces appels pathétiques à la mobilisation collective : » Au loup ! « , proférés par ces femmes qui se soulèvent contre des maltôtiers ou des agents de seigneurie. Jean Nicolas, à l’encontre de toute une historiographie bénisseuse, constate le » durcissement des mours » et » la dégradation du climat relationnel du second tiers du XVIIIe siècle « .
Ceux qui se rebellent le font au nom d’une argumentation qui donne légitimité à leur entreprise et désarment à l’occasion les autorités ; ils revendiquent leurs » droits » : droit à la vie, droit au respect de soi, qui s’opposent à la loi. Loi abusive très souvent car elle méconnaît les » droits » reconnus antérieurement, acquis inscrits dans les pratiques, les coutumes, les » privilèges « , un temps acceptés et même inclus dans des traités ou la jurisprudence des cours. Bientôt, on ne réclamera pas seulement l’équité mais l’égalité ! Dans l’immédiat, on exige le respect de ces droits devant les tribunaux, s’il se peut et au prix quelquefois d’interminables procédures, mais à terme fort souvent, c’est sur le terrain des rapports de forces réels que l’affaire trouve une sorte d’aboutissement provisoire… et la mémoire de la chose ne s’efface pas (cf. par exemple l’affaire de Villefort). Cette dialectique complexe du procès en argumentation et de la manifestation rebelle, fonde une sorte de » propédeutique contestataire » sur laquelle prendra racine le processus de » politisation « , que la Révolution française portera à des sommets inégalés. Dans ce » champ rébellionnaire « , Jean Nicolas a garde d’ailleurs de ne point omettre, ni les luttes pour la dignité des individus, que le collectif tient pour des victimes de l’injustice des puissants, ni les combats pour leurs libertés des religionnaires protestants des Cévennes, du Vivarais ou d’ailleurs, ni celle des jansénistes lorrains ou d’×le-de-France. Son choix est raisonnable, parce que ces refus-là ne sont pas extérieurs à la construction de la conscience sociale qui est au cour de son propos. (…)
Résistance donc. Archaïsme ? Refus des nouveautés ? Rien de tel en vérité malgré le discours répétitif des élites qui vise à discréditer (pour l’isoler) la » conscience sociale » des couches populaires. En réalité, derrière le foisonnement des » affaires » de rébellion, un enjeu essentiel que porte l’air du temps : qui paiera le prix de la modernité ? Modernité de l’État au service de la communauté politique en construction, modernité de l’économie marchande créatrice de croissance matérielle, rationalisation des administrations et des justices d’arbitrage. Tous les peuples de l’Europe, entre 1700 et 1900, ont été confrontés à cette évolution qui a pris cette forme de » nécessité historique » qu’après Marx ont fort bien identifiée naguère de grands historiens britanniques comme E. P. Thompson ou Eric J. Hobsbawm. Jean Nicolas n’ignore pas cette dimension européenne comparative, qu’au surplus il contribue à éclairer (cf. page 12), mais il montre comment la réponse roturière française, créatrice de spécificité nationale, a peu à peu consisté à imputer au politique, en partant de la BASE de la société et non de son sommet, l’achèvement ultime de la confrontation pluriséculaire entre les classes populaires, rurales et urbaines, et les élites sociales détentrices d’une grande part des richesses accumulées et de la presque totalité du capital matériel et symbolique.
Jean Nicolas conclut : » Refoulées mais non pas abolies, les attentes du commun peuple s’érigent peu à peu en doctrines partagées par des couches élargies, elles orientent l’avenir quand même elles semblent aller à contre-courant » (page 541). Une telle histoire du » populaire » n’est donc en rien un enfermement dans la sphère étroite des satisfactions sociales à courte vue, mais une manière d’éclairer dans sa vastitude le mouvement de l’histoire. Voilà qui donne à penser ! Si, comme je le crois, les lecteurs de l’Humanité sont des femmes et des hommes qui ont le souci de saisir et de comprendre la raison et la portée des luttes sociales, les nôtres et celles d’autrefois, d’inscrire la mémoire des luttes anciennes dans le présent de leur intelligence, alors nul doute qu’ils feront tout pour que bibliothèques privées et publiques, centres de documentation divers, offrent à leurs habitués, ce maître livre qui donne autant à voir le passé qu’à susciter le désir, par contraste ou par filiation, de comprendre le présent. On ne passe pas à côté d’une si belle réussite.
Claude Mazauric
(*) Historien. Derniers travaux : présentation de la réédition des Ouvres complètes de Maximilien Robespierre, Librissimo, 2000 ; introduction à la réédition de l’Utopie de Thomas More, J’ai lu, 1999.
(1) Jean Nicolas, la Rébellion française, mouvements populaires et conscience sociale (1661-1789), Éditions du Seuil, 2002, collection » Univers historique « , 610 pages, 28 euros.
La Rébellion française

Il semble que l’époque se prête à un retour aux diverses formes de contestation. Le cinéma se penche sur Mesrine et la Bande à Baader. La mémoire de la Grande Guerre évoque immanquablement les mutineries et les soldats fusillés, dans une confusion qui se dispense d’une étude serrée du contexte du conflit. Le quarantième anniversaire de Mai 68 a accouché de nombreux ouvrages commémoratifs. Bref, le héros du jour semble opposé à l’autorité. De Robin des Bois à Mandrin, de Zorro au héros de V for Vendetta, le rebelle attire et fascine. Il traduit l’existence d’une autre réalité que celle de l’appareil légal et des vérités officielles. Par ailleurs, les discours politiques sur l’insécurité ambiante ont alimenté de trop nombreuses polémiques pour être dépourvus d’intérêt. En d’autres termes, l’antithèse de l’ordre et de la légalité pourrait dès lors en révéler beaucoup sur nos sociétés, leurs malaises et leurs aspirations.
En ce sens, le livre de Jean Nicolas, consacré aux phénomènes disparates de la « rébellion française » sous l’Ancien Régime, de la prise du pouvoir par Louis XIV à la chute de la Bastille, constitue un apport de taille à notre compréhension des ressorts de la société pré-révolutionnaire… et de la nôtre. Cette étude massive, fruit d’une recherche archivistique démesurée, et tirant profit de plusieurs monographies locales, analyse plus d’un siècle d’attitudes contestataires à l’autorité sur l’ensemble du territoire français. Grâce à Jean Nicolas, se dessine une « autre France », celle de l’opposition à l’autorité, et sous des formes et une amplitude variant selon les régions, le climat, l’opinion religieuse, et même l’âge.
Cette enquête permet de déterminer des pôles de cristallisation de la rébellion, en particulier autour de l’impôt, indirect ou direct (la taille). La fraude est une réalité de l’Ancien Régime aussi établie que la monarchie absolue. Les attitudes contestataires s’étendent à tous les échelons de la société, et il n’est pas rare de voir le clergé et les magistrats locaux faire preuve de clémence, voire de soutien, aux oppositions locales, par souci d’atténuer le poids de la centralisation administrative. Se constate également, au moins au XVIIIème siècle, un affaiblissement du rôle stabilisateur du fief seigneurial. Par ailleurs, les caprices du climat peuvent alimenter de véritables insurrections de la faim, dans des contextes de disette – en particulier sous le règne de Louis XIV. Autre source de conflit : le monde des artisans et des ouvriers, qui peine à supporter le carcan du corporatisme. En d’autres termes, la rébellion française découle d’abord d’impératifs matériels, liés aux conditions de vie quotidienne et de travail, alors que le pouvoir et les privilégiés rechignent à s’adapter.
Mais, souligne Jean Nicolas, cette motivation serait réductrice. Le XVIIIème siècle témoigne en effet de la prolifération de revendications fondées sur l’idée de justice – judiciaire et sociale. L’arbitraire royal, les exactions de la police, les conditions de vie des détenus, mais aussi les inégalités sociales, suscitent une indignation croissante. L’antagonisme catholicisme-protestantisme génère également de nombreux désordres. Quant aux réactions répressives, elles aboutissent à un surcroît d’exaspération – conservatrice ou non – dont la jeunesse se fait l’écho.
Bref, 1789 ne saurait constituer un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Le Siècle des Lumières a bel et bien favorisé, ou recyclé, des mouvements contestataires, mais il serait erroné d’en déduire que ces impulsions sont venues du haut : au contraire, révèle cet ouvrage, l’environnement social a facilité l’éclosion et la diffusion des idées libérales. La rébellion française sous l’Ancien Régime semble avoir préparé le terrain à la mise en doctrine de ce que seront les préceptes de la Révolution française. La pratique a précédé la théorie.
Repères : La rébellion française (1661-1789), de Jean Nicolas, Folio histoire, 1064 pages, 12,10 €.