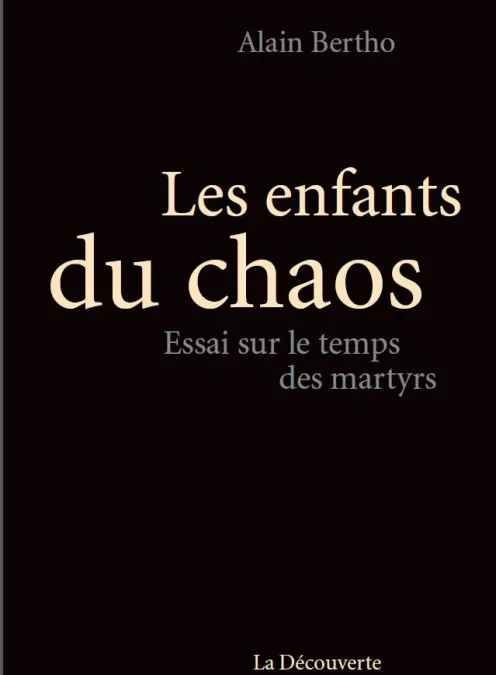Zapatistes : la sexta contre le destin

Virginie Robert, Anthropologue
En juin 2005, au Mexique, les zapatistes attiraient l’attention vers eux en déclarant l’alerte rouge et assuraient ainsi le retentissement de leur sixième déclaration. En juillet 2005, ils lisaient leur déclaration (appellée la sixième : la Sexta) et annonçaient ainsi l’entrée de leur organisation dans une seconde étape.
La Sexta porte un nouveau projet et, plus précisément, elle présente l’appel fait par les zapatistes à ceux ‘d’en bas’ (en opposition à ceux ‘d’en haut’, dans la sphère du pouvoir) pour qu’ils participent à l’élaboration d’un plan de lutte national de gauche et anticapitaliste. La sexta fait la démonstration que le processus zapatiste est en plein rebondissement et la détermination politique toujours vive. La Sexta est en continuité avec l’objectif poursuivi par l’organisation zapatiste depuis leur apparition en 1994 mais elle correspond à un nouvel envol qu’elle prend avec Otra Campaña (‘l’Autre Campagne’).
La Sexta comme clôture de la première étape
Il y a plus de 13 ans maintenant, les zapatistes ouvraient une séquence politique avec une guerre contre l’Etat n’ayant pas pour objectif la prise du pouvoir de l’Etat. Déclarée le 1er janvier 1994 et menée par une armée (l’EZLN[1]) dont les communautés sont ‘bases de soutien’, la guerre est davantage un défi lancé aux peuples mexicain et du monde qu’à l’armée fédérale. Car en effet, les zapatistes appellent à cette époque ‘tous’ les Mexicains à destituer le PRI (Parti Révolutionnaire Institutionnel au pouvoir depuis plus de 70 ans) et, dans le même temps, ‘tous’ les peuples’ du monde à défendre leurs droits, les droits de tous. Cet appel engendre en réalité une forte mobilisation nationale (et internationale). Le cessez-le-feu est signé et une phase de dialogue entre gouvernement et zapatistes se prépare.
Les zapatistes deviennent les protagonistes d’un processus politique inédit mais il va être ‘détenu’ par la défense des droits indigènes. Certes, la reconnaissance des indigènes figurait parmi les premiers objectifs. Mais les droits indigènes n’ont de sens qui si ‘tous’ ont ‘leurs’ droits : ils n’ont pas cessé de le répéter. Si donc les zapatistes s’assoient à la première table en tant qu’indigènes, invitent d’autres indigènes à dialoguer et, finalement, parviennent à des accords sur les ‘droits et culture indigènes’, la phase de dialogue s’en tient là. Seuls les indigènes se sont mobilisés pour ‘leurs droits’ et, dans le même temps, l’Etat n’a pas joué le jeu des négociations. En laissant pour lettre morte les accords de San Andres auquel était parvenu le dialogue en février 1996[2], la négociation avec le gouvernement et l’Etat n’a aucun sens, aucune valeur. Par conséquent, l’opportunité de s’asseoir pour négocier autour des trois autres tables prévues s’efface (les trois tables étaient ‘démocratie et justice’, ‘bien-être et développement’ et ‘droits des femmes’). Il s’agit donc avec la Sexta de rebondir et de dépasser la défense des droits indigènes, de s’extraire de ce ‘dialogue’, et par conséquent, de clôre cette première étape.
Une première bataille a été livrée : les indigènes ont pris une voix(e). Et puis, plus encore, les zapatistes ont montré au fur et à mesure des années que l’autonomie et une ‘autre‘ forme de gouvernement étaient possibles. La démonstation culmine en août 2003 avec la mise en place des cinq ‘assemblées de bon gouvernement’ (Juntas de buen gobierno). Annoncées explicitement dans la cinquième déclaration comme une application des accords de San Andres, ces Juntas appliquent les droits sans loi et indépendemment de l’Etat et, dans le même temps, ils s’appuient sur l’article 39 de la Constitution mexicaine et l’article 169 de l’OIT (Organisation Internationale du Travail dont est membre le Mexique) qui font respectivement référence à la souveraineté du peuple et au droit des peuples ‘autochtones’ de s’autogouverner. Les peuples indigènes, tel que cela a été négocié dans ces accords, ont le droit de choisir leurs autorités et, plus délicat du point de l’Etat, de gérer les richesses du sol et du sous-sol sur leur territoire : on comprend ici la réticence de l’Etat à tenir ses promesses.
Les juntas sont ces ‘nouvelles’ autorités qui ne sont pas une simple transposition de l’autorité ‘indigène’, même si horizontalité, obéissance et révocation sont caractéristiques et l’autorité demeure comprise comme une ‘charge’. Les Juntas sont un gouvernement pour tous : la preuve tient au fait que des non zapatistes font appel à leur ‘service’. Toutefois, si en 2005 et après 2 ans d’expériences elles ont déjà des résultats probants, les Juntas renvoient à une capacité des communautés zapatistes : il manque tous les autres. Les Juntas signifient alors que les zapatistes sont allés au bout de la voie empruntée avec le dialogue, mais sont dans une impasse du point du processus politique ouvert en 1994. De fait, fidèles au slogan qu’ils entonnent depuis leurs débuts ‘tout pour tous et rien pour nous’, ils reprennent la lutte pour tous dans sa dimension nationale (voir internationale).
Les zapatistes forts de 12 ans d’expérience et de résistance se relancent sur le terrain national avec un projet qui s’inscrit dans la stratégie de la guerre déclarée il y a plus de 13 ans. Ils tentent une nouvelle fois de changer le monde en construisant un ‘autre’ pouvoir : c’est ce pouvoir qui est à prendre et non celui de l’Etat. On rappelle qu’ils sont en effet les premiers à crier en 1994 ’un autre monde est possible’, et qu’ils ont d’emblée spécifié qu’il n’y aura pas de paix tant que les peuples ne seront pas en mesure de se gouverner eux-mêmes. La paix ne sera possible qu’avec un ‘autre’ mode faire de la politique, un nouveau rapport au pouvoir et donc avec un pouvoir non plus comme domination.
L’objectif ultime est le même bien que le monde ait bougé. Au Mexique, le PRI est tombé, la démocratie mexicaine est dans tous ses états mais, dans le fond, rien n’a changé. Et, selon eux, avec le nouveau président (quel qu’il soit), rien ne changera. Les peuples ne sont pas souverains ni même respectés, règnent l’argent et les pouvoirs qui s’y soumettent, alors ils poursuivent leur guerre (c’est extrêmement simplifié et pourtant très proche du monde qu’ils dénoncent). Envers et contre tout (ce qui là aussi serait très simplifié), le projet veut rompre avec la logique de la ‘voie unique’, la voie capitaliste. Disons alors que le projet tente à contre-courant. Il vise la globalisation de la rébellion et s’envisage comme une nouvelle bataille pouvant parvenir à la paix en défaisant la domination capitaliste et étatique. Ni voie unique ni théorie, elle construit à contre-courant et donc à partir du principe selon lequel des pratiques qui rompent avec la logique capitaliste engendrent un nouveau mode de relations.
La proposition ne s’adresse pas à des spécialistes : ‘les savants sont parmi nous’ peut-on entendre. Tous doivent chercher, inventer : ce sont aux peuples eux-mêmes de construire l’espace d’une autorité où ce sont eux qui commandent et elle qui obéit : ‘commander en obéissant’ étant le fondement d’un ‘autre’ gouvernement. Indexé sur la vie des gens et non celle de l’Etat, les juntas sont l’épreuve réussie et non parfaite d’un ‘autre’ gouvernement. Les zapatistes ont mis à l’épreuve leurs propositions. Néanmoins ils ne se sont pas soulevés en armes pour défendre les seuls droits indigènes et, par conséquent, pour que les Juntas prennent tout leur sens, ils ont ‘besoin’ que les autres construisent les bouts de mondes qui leur ressemblent. La Sexta correspond à cet appel.
Ils réaffirment qu’il y a guerre et son originalité est préservée : la guerre est livrée à travers la création d’un mouvement civil et pacifique. Il y a rebondissement dans la continuité[3].
La Otra, une aventure sans filet
Les zapatistes décrivent régulièrement le monde qu’ils ‘rêvent’ : ‘un monde qui contient beaucoup de monde’. La proposition de la Sexta s’y accole.
Le projet se déploie avec l’’Autre campagne’, la Otra, entendue comme l’espace de la construction d’une voie anticapitaliste ‘multiple’. La Otra est l’exercice d’un autre mode faire de la politique pouvant conduire à un ‘autre’ pouvoir. La Otra est lancée mais elle n’est pas programmatique et sciemment laissée vague. Car sans leadership, et avec tous ceux ‘d’en bas et à gauche’, l’élaboration du projet ne sera pas l’œuvre des zapatistes, ni des seuls indigènes, ni des seuls ouvriers etc., mais de tous.
L’espace de la Otra ne devrait alors pas désigner un ‘hybride’ : c’est autre chose qu’une fusion créatrice entre des forces ‘hétérogènes’ pouvant caractériser l’organisation zapatiste (le néozapatisme est né de l’échange entre guérilleros et indigènes : succintement, les guérilleros se sont fait indigènes en apportant leur savoir). Ici, les forces ‘d’en bas et à gauche’ de tous le pays sont vouées à s’unir, sans se fondre, pour bâtir une chose si souple qu’elle pourra englober toutes les différences, toutes les réalités sans les effacer, et donc être multiple. Il ne s’agit pas de complémentarité mais de multiplicité : il s’agit de réalités qui ne sont pas forcément conciliables mais qui ont ‘toutes’ droit à un espace. Les réalités sont différentes et ‘toutes’ sont efficaces : elles identifient ceux qui les vivent et les font vivre.
Si cette multiplicité n’existe pas ou s’il y a échec, cela est renvoyé du côté du système qui uniformise et détruit les modes singuliers propres aux gens. Dits minoritaires, ces modes sont identifiés comme nuisibles selon l’ordre et le progrès que se chargent d’imposer ceux ‘d’en haut’. Ces modes, plus que niés, sont même criminalisés et finalement détruits par le système du pouvoir d’Etat et capitaliste. La criminilisation des pauvres et des luttes sociales identifiée comme au cœur de la politique de ceux ‘d’en haut’, ceux ‘d’en bas’ sont appelés à s’organiser pour rompre ce cycle. C’est à contre-courant que veut fonctionner la Otra et donc c’est précisément sur les modes singuliers qu’elle va s’appuyer. Les gens qui ont ‘le cœur à gauche’ sont exhortés à organiser la résistance autour de ces modes multiples et singuliers et dont la logique n’est pas celle du pouvoir d’Etat ni capitaliste. Une logique différente est en train de façonner le pouvoir de ceux ‘d’en bas’ car ils s’y reconnaissent, s’y retrouvent et sont eux-mêmes capables : ils ne sont pas représentés et sont ceux qui travaillent à faire avancer ‘leur’ alternative.
Pour ceux qui connaissent le chemin parcouru par les zapatistes depuis 1994, cette proposition coïncide avec le principe zapatiste de ‘marcher en se questionnant’. Mais l’empreinte zapatiste est identifiable plus rapidement encore. En effet, ce qui a d’emblée fait l’originalité de cette organisation est sa mise à distance d’avec le pouvoir d’Etat. Cette ‘Autre campagne’, la Otra, cherche à construire ‘en bas’, à ‘l’opposé du pouvoir’. C’est la condition première et indissociable de l’axe anticapitaliste. De fait, en opposition à la campagne présidentielle organisée à la même période, le schéma est ‘autre’ : la Otra Campaña va se poursuivre de façon indéterminée, sans jamais être en mesure de promettre, et à la charge de ceux qui veulent qu’elle progresse. Dès lors, l’engouement reste relatif.
L’appel est dirigé non pas à ‘tous les Mexicains et aux peuples du monde’ mais, cette fois, à ‘tous ceux en bas et à gauche’. Et les zapatistes le disent clairement, le temps où certains ‘s’achetaient’ une bonne conscience est révolu : il s’agit maintenant d’engagement et non plus de soutien à l’armée zapatiste ni de solidarité avec les communautés zapatistes, comme cela s’est perpétué pendant plus de dix ans. Il n’y aura de solidarité que mutuelle : ils ne se sont pas soulevés pour recevoir de l’aide mais pour ‘gagner’, c’est-à-dire faire naître un autre monde.
Il y a défi et l’éteau se ressert sur les plus déterminés.
L’appel de la Sexta, étonnant ou décalé pour beaucoup, est une étincelle qui enflamme le cœur de dizaines de milliers de Mexicains prêts à livrer la bataille (‘jusqu’à mourir’ diront même certains au cours de cette ‘campagne’). Les gens n’octroient plus leur confiance en les partis. Ils avancent sans connaître ni même savoir vers quoi ils se dirigent. La seule certitude énoncée de la Otra se résumerait ainsi : « si tu vois quelque chose pour améliorer ou mieux vivre ta vie, pour être ce que tu es, il va falloir l’obtenir toi-même avec tes compañeros ; si tu ne vois pas, il va falloir chercher ; chacun son mode mais ‘tous’ ; donc, à toi de voir si tu as intérêt ou pas à entrer dans la Otra ».
‘Tous’ mis face à leur destin dans la Otra, ils ne sont pas encore aujourd’hui ‘ensemble’ : c’est ce chemin qu’il s’agit de parcourir en ces débuts. La Otra est l’espace où se tissent des liens, elle est comme un réseau de luttes. L’exigence est la même pour tous : respecter le style et la forme de penser des uns et des autres, se soutenir mutuellement et construire avec tous malgré ‘les différences’. Alors ils inventent l’espace où tous s’impliquent pour eux et donc pour tous sans aucune autre garantie que le fait d’être eux-mêmes les maîtres d’œuvre. Il faut être déterminé à défendre ses propres droits en tant que femmes, indigènes, ouvriers, paysans, anarchistes, artistes, jeunes, homosexuels etc. Et cela signifie être prêt à se battre sur tous les fronts, tous les jours en tant que artiste homosexuel, jeune ouvrier indigène mais aussi à accepter et soutenir son voisin punk, sa voisine handicapée, sa sœur étudiante, son frère végétarien etc.
Il faut être déterminé à lutter, être conscient qu’un monde pour tous naîtra de l’effort de tous et avoir confiance en sa capacité et celle des autres. L’équilibre est alors précaire et incertain mais la rationalité de ce projet tient précisément à l’ancrage aux ressorts subjectifs sans lesquels l’activité des êtres est anéantie. S’appuyer sur la capacité des gens n’est pas insensée ni irrationnelle. Certes, la tâche en question est ‘hautement importante’, cependant elle est plus qu’accessible à ‘tous’ puisque personne ne peut vivre, décider et agir à la place des autres : elle devient même un ‘devoir’ en regard de la vie (de la dignité disent-ils parfois). C’est la vie des gens qui est en jeu et la capacité de chacun dépendant de celle de tous. Le succès de la Otra est par conséquent sous condition que tous se l’approprient comme la leur, qu’ils reconnaissent la capacité de lutte de l’autre et, par-là, la solidarité comme nécessairement mutuelle.
Prémisses d’un projet de longue haleine, les premiers pas participent déjà de cette ‘révolution’. Car le monde se révolutionne depuis ‘en bas’, les pas franchis par les gens ‘d’en bas’ tous les jours forment cette la rébellion permanente, quotidienne, qui au fur et à mesure tracent de nouvelles voies. La Sexta est en marche : la Otra correspond à la gestation d’un monde qui contient tous les mo(n)des.
C’est une tentative, peut-être la dernière. Le mouvement peut effectivement résoudre le conflit (ce qu’il vise) et, par conséquent, induire la disparition politique de l’EZLN. Ou encore, puisque les zapatistes proposent avec ce mouvement de devenir des ‘compañeros’, ils risquent de perdre leur protagonisme. Du côté des méfiants, on entend que les zapatistes se sont lancés dans ce projet pour ne pas avouer leur échec. La question de savoir si c’est l’ultime n’est pas la nôtre, d’autant moins qu’elle est encore en cours de réalisation. Quant à savoir si cet un échappatoire, j’insisterai sur le fait qu’eux-mêmes disent précisément qu’ils n’ont pas abouti mais qu’ils ne se sont pas encore rendus. Retenons que c’est une étape grande et décisive de l’histoire de l’organisation zapatiste dont le devenir est indéniablement soumis à la capacité des autres, ce qui là encore est une caractéristique zapatiste depuis les débuts. Les zapatistes vont à la rencontre de ceux ‘d’en bas’.
Rencontre de ceux d’‘en bas et à gauche’
Pour les premier pas de la Otra, la Commission Sexta est crée et Marcos, le sous-commandant de l’EZLN, est nommé à cette occasion ‘délégué zéro’. Il est prévu qu’il coordonne les rencontres avec tous ceux qui se sont reconnus dans le projet. Envoyé à travers les 32 Etats de la république fédérale du Mexique, Marcos va donc rencontrer tous les adhérents et les sympathisants de la Sexta et va surtout devenir le prétexte à la rencontre de tous ces adhérents entre eux.
Ces rencontres sont préparées au Chiapas dès le mois suivant l’annonce de la Sexta (en août 2005) : de nombreux groupes, collectifs, organisations et individus de tout le pays sont venus se présenter à ceux qui sont en passe de devenir ‘leurs compagnons’. Les réunions de ‘travail’ sont amorcées : les rencontres avec les autres sont les préliminaires à l’élaboration commune d’un plan.
Les réunions doivent commencer en janvier au Chiapas et se poursuivre, Etat par Etat, jusque juin 2006. Encore ‘guidées’ par la commission sexta, les réunions sont en quelque sorte l’occasion de remettre le projet entre les mains des adhérents. Les zapatistes, et concrètement le ‘délégué zéro’, vont durant les premiers pas de cette ‘autre’ campagne veiller à ce que le projet se mette en place dans les termes de son annonce.
Dès les premiers instants, la Comission Sexta en la personne de Marcos est suivie. Sur plus de 40000 km, pendant des mois, des dizaines de voitures forment une Karavane (‘K’ : pour spécifier qu’elle est une ‘autre’ caravane), et les gens qui s’y joignent sont à l’image de ce monde multiple. Adhérents, pour la plupart, ces gens sont tous différents. C’est un moment enrichissant. Ils vont ensemble pénétrer les centaines de réalités qu’ils méconnaissaient. Ils vont vivre ensemble, partager, discuter, se confronter même.
Les journalistes sont nombreux dans cette campagne même si les seuls ‘officiels’ acceptés sont ceux de la Jornada (un quotidien) et de Contra Linea (un mensuel). Dans cette campagne, tout le monde fait ‘son’ journalisme. Tout le monde rapportera la parole entendue et, surtout, l’espace des médias indépendents s’est inauguré comme central dans cette étape. Pour une ‘autre’ information et une ‘autre’ culture, il faut d’’autres’ médias, d’autres canaux de diffusion, d’autres supports. Ces médias sont à l’épreuve et ceux dont cette campagne ne peut se passer (Marcos le dira lui-même). En fin de cortège, le monde des ‘puissants’ domine : police d’Etat et fédérale, armée, service d’intelligence, service de renseignements. C’est un ‘autre’ cortège et c’est un moment politique ‘historique’ disent aussi les adhérents.
Cette Karavane représente une chaîne de ‘savoirs’, d’expériences de vie et de lutte multiples. Les mois de réunions sont le patrimoine de cette première phase de la Otra. La création de sens commun qui en surgit préfigure le ‘nouveau’ monde. Un monde qui réunit les indigènes, les anarchistes, les punks, les libertaires, les communistes, les paysans, les femmes de ménage, les ouvriers, les petits entrepreneurs, les chauffeurs, les étudiants, les mères de famille, les artistes, les travailleurs sexuels, les prisonniers, les intellectuels, les homosexuels, les jeunes, les vieux, les enfants, d’autres encore et ‘tous’ finalement. Tous voient leur vie se réduire à néant. Alors il n’y a plus de classes ni de catégorie mais des gens qui veulent vivre dignement et librement. Dignité et liberté ne renvoie pas au fait de faire ce que l’on veut mais être qui l’on est et jouir de l’espace qui nous correspond.
C’est un espace extrêmement ouvert car il doit tout contenir. Durant ces rencontres qui sont de taille et de richesse inégales, c’est un peu comme si l’engagement de chacun allait être observé par tous les autres. Pour former un mouvement ensemble, il faut se connaître, se respecter mais aussi être en confiance. La confiance misée sur un ‘compâñero’ sera évaluée à la lumière de son engagement : il doit participer lui-même à la construction d’une alternative capitaliste depuis ‘en bas’, c’est à dire ‘desde su trinchera’ (‘depuis sa galère’ dirait-on en France). Disons encore que c’est lui-même qui doit préserver et nourrir ce qu’il est, ce pour quoi il vit. C’est la condition pour que le monde soit complet.
C’est une étape délicate : un nouveau regard sur celui qui est l’autre. Dire que la création du mouvement est fragilisée par le fait que la confiance est sans garantie serait toutefois aller trop loin car il existe une base solide sur laquelle s’ancre la confiance. Il s’agit de s’appuyer sur l’intérêt commun qui revient ici à se libérer du capitalisme identifié comme la cause des maux dont souffrent ‘tous’ les gens ‘d’en bas’. Et si les gens sont tous différents, ils ont donc en commun la vie et un même ‘ennemi’, ‘celui qui engendre la mort’. Ceux qui intègrent la Otra parlent en effet tous de leur vie, de la vie des gens et de la mort que répandent tous les projets ‘néolibéraux’. Tous rejettent les immenses fortunes maîtresses de ces grands projets auxquels souscrivent les Etats. Ils sont tous critiques vis à vis des projets qui, par exemple, au nom du développement durable et la protection de l’environnement, expulsent les paysans, les pêcheurs, les habitants qui sont contraints d’immigrer souvent aux Etats-Unis. Tous ces projets ont pour conséquence, et/ou pour condition, la privatisation des ressources ‘nationales’, la ‘policisation’ de la politique et la criminalisation des pauvres, la division et l’individualisation pour défaire la capacité collective, la précarisation de l’ensemble de la population. Ils décrivent sans cesse un monde de destruction.
Dans le cadre de la Otra, il faut vaincre l’uniformité et l’homogénéisation, revaloriser le collectif (et non la collectivité), construire à contre-courant la vie que le capitalisme avilit. Le monde des ‘affaires’ veut ‘absolument’ tout s’accaparer. Et si ce sont ceux ‘d’en haut’ qui décident, ils en sont tous convaincus, ceux ‘d’en bas’ n’auront jamais de place et plus rien. C’est alors plus que pour un monde incluant qu’ils se battent. Deux réalités se font face. La réalité des gens, dans les termes de ceux de la Otra, c’est la vie, l’humanité, la nature, le destin des peuples, c’est la réalité des échanges et de la solidarité, c’est la réalité du savoir populaire et des traditions, de la religion, de la culture, de la justice. La réalité c’est leurs enfants, leur terre, leur quartier, leur usine, leur travail, la maladie, leurs désirs, leurs rêves, leurs angoisses, leur liberté. C’est la vie qui produit de la vie. Jamais ils n’accèdent à la réalité que constituent le marché, les entreprises et les finances, les institutions (internationales ou pas).
Une alternative contre le capitalisme même humanisé
Il y a deux mondes : hétérogènes, ils sont tenus mutuellement à distance pour exister et s’excluent l’un l’autre. La lutte n’envisage pas une réforme, elle est anticapitaliste. Les zapatistes s’engagent postulant que le capitalisme ne peut s’humaniser. Rappelons ici qu’en 1996, les zapatistes avaient organisé la première ‘Réunion Intergalactique contre le néolibéralisme et pour l’humanité’. On voit donc bien qu’il s’agit d’un re-centrage de la lutte dans cette seconde phase.
Ils savent que le chemin est long et difficile, semé d’embûches et destiné à la répression mais aussi que ‘tous ceux d’en bas’ sont les seuls à pouvoir enmprunter ce chemin. La lutte sociale est sujette à la répression mais ils n’ont pas peur car ‘la vie n’est pas la vie’. Ils prennent des risques mais plus que par goût du risque, c’est surtout l’espoir de perdre une vie de ‘misère’ qui les anime. La flexibilité du travail est dénoncée comme la mort des travailleurs. Les transnationales écrasent tout sur leur passage : les éoliennes expulsent à la Ventana (Etat de Oaxaca) ; les barrages électriques font disparaître des communautés et, dans ce cadre, le conflit à La Parrota (Etat de Guerrero) est en ce moment en train de connaître une phase décisive ; Wall Mart a négocié, pour bénéficier d’un accès direct, la destruction de la Barranca de las Sauces (un grand fossé naturel) à … (Etat de…) et il propose de s’installer au sommet d’une pyramide du site archéologique de Teotihuacan (Etat de Mexico) ; des déchetteries envahissent des territoires ; la biopiraterie s’infiltre partout ; des stations essence s’implantent partout ; les entreprises, les industries polluent les rivières desquels se nourrissent hommes et poissons, et pas seulement on le sait ; la déforestation devient massive ; la privatisation des terres est imposée (Procede et Procecom sont des programmes qui contraignant à la titularisation des parcelles, ce que les communautés refusent en général jusqu’à ce que la corruption et la répression aient raison de la résistance). Les gens voient qu’ils comptent moins que les déchets, que leurs savoirs intéressent à condition qu’ils profitent à ceux ‘d’en haut’, que la nature et leur vie sont au service de quelques hommes (et femmes). Les gens disent que l’humanité perd ses couleurs, ses splendeurs, ses richesses : elle n’a de valeur plus que marchande.
La propriété privée va très explicitement à l’encontre du principe de propriété communale de la terre qui, jusque la réforme de l’article 27 de la Constitution en 1992, avait pu être maintenu[4]. Les communautés indigènes sont touchées dans le fondement même de leur existence. La terre est en danger, et par-là la vie : plus qu’être celle qu’ils travaillent, la terre est la Terre-Mère. Mais les indigènes ne sont pas les seuls à souffrir l’imposition violente du modèle politique. De nombreux Mexicains ‘d’en-bas’ partagent cette indignation. Les récits dressent une même toile de fond.
Les gens sont infantilisés à chaque implantation de projets : ils racontent qu’on leur fait croire qu’ils ne peuvent pas faire autrement et qu’ils ne se rendent pas compte du bien-fait de ces projets ou, encore, qu’ils n’y connaissent rien et se ‘font des idées’. Et puis, finalement, après avoir fait croire qu’ils comptaient puisqu’on les consultait, on leur dit que ce ne sont pas eux qui décident que les intérêts en jeu vont bien au-delà de leurs plaintes. On leur impose un projet et un savoir-vivre en définitive dont ils ne veulent pas : ‘comme s’ils avaient attendu ces projets pour vivre, comme s’ils ne savaient pas ce qu’ils vont perdre ou n’auront jamais, comme si les gens ne savaient pas ce qu’ils ne pourront plus faire, voir, sentir, vivre enfin. Mais l’indignation est grande chez tous et pas seulement lorsqu’il y a un projet. Les jeunes sont ‘dits’ dangereux et ne peuvent plus marcher ensemble dans la rue alors qu’ils n’ont pas encore d’espace à investir (qu’ils aient un tatouage ou pas ne change rien à moins que l’on comprenne que les insultes proférées et la force des coups seront plus violentes). Les homosexuels n’ont pas de place dans ce monde macho, les artistes n’ont d’avenir qu’en servant les idées dominantes ; les pauvres sont tous les jours plus pauvres. Les centaines de réunions de la Otra ont permis de dresser une carte de ‘tous’ les grands projets et de toutes les luttes qui s’y sont confrontrées ou s’y confrontent encore ; une carte de toutes les discriminations et de toutes les exactions, de tous les lieux de la trahison des pouvoirs. Sentiment de colère et de rage plus que de trahison, les gens pensent en effet que les pouvoirs n’ont jamais eu un engagement ‘sincère’ vis à vis du peuple, des gens. L’Etat et les hommes qui gouvernent servent les intérêts des ‘grandes’ entreprises et des transnationales et perdent ainsi le crédit qui aurait pu leur être accordé. Le pouvoir est absolète.
La question de l’Etat finira par se poser
Aller à contre-courant, c’est aller contre la voie des partis qui gagnent le pouvoir de l’Etat pour mieux se laisser corrompre. Toutefois une fois les partis rejetés, reste la structure de l’Etat, squelette du monde moderne. Les zapatistes s’engouffrent dans la brèche du monde post-moderne : les termes du monde moderne ne sont pas encore défaits mais en voie de l’être dans le langage zapatiste. L’Etat n’est pas ici investi : au cœur de la politique dans le monde moderne, l’Etat est ici mis de côté. Le processus politique se déploie indépendemment et en dehors.
Dans un tel cas, que fait-on de l’Etat ?
La question du pouvoir reste entière mais on l’a vu, cette question est largement questionnée. Un pouvoir non ‘étatique’ est en construction dans ce processus. La question de l’Etat dépend en conséquence de son déploiement et de fait y reste suspendue. Disons alors que si l’on ne sait pas ce qu’il en est du nouveau pouvoir, il est possible de faire l’économie de la question de l’Etat pour l’instant. En revanche, elle n’est pas ignorée ni absentée. On trouve de nouveau ce qui participe à l’originalité zapatiste : le pouvoir est tellement autre, et la manière si différente, que la question centrale ‘traditionnelle’ est déplacée. L’Etat n’est pas au cœur de la résolution, il n’est pas au cœur de la question politique et de ce qui va s’inventer. C’est toute la difficulté et aussi ce qui procure à cette tentative son inventivité prétendue.
L’anticapitalisme ne fait aucune difficulté dans l’esprit des gens. L’alternative est au cœur de la préoccupation et identifiée comme passant nécessairement par la rupture avec l’Etat, de fait elle dépend de cette rupture. Et la Otra s’y confronte. Tous anticapitalistes, ils ne sont pas tous prêts à rompre avec une pensée de la politique liée à l’Etat. Chez certains ‘protagonistes’ de la Otra, dont l’influence marxiste-léniniste est caractéristique, l’Etat reste nodal : il faudra l’investir. Chez les ‘protagonistes’ dont l’influence anarchiste est fondatrice, le moment viendra où il faudra le détruire. Chez d’autres, les indigènes notamment, la question pourra se résoudre une fois constitué un pouvoir avant tout ‘autonome’ (plus que populaire) et l’effort est donc à concentrer sur la constitution d’un pouvoir ‘autre’ qui n’a plus comme fondement la domination ni l’Etat.
L’Etat renvoie à la difficulté d’être ‘ensemble’ : il n’est pas le lieu de la résolution du conflit. Tous avaient mis de côté cette question jusqu’à ce qu’une jeune fille de 14 ans, visiblement sur les traces de son père attaché aux valeurs socialiste et à son processus révolutionnaire, rejette la présence anarchiste dans ce mouvement. Prétextant que l’anarchie n’était que chaos et qu’au contraire seuls la discipline et l’ordre conduisent à la victoire, cette adolescente a mis le feu au poudre. L’assistance contient difficilement son énervement et Marcos prend à sa suite la parole pour demander aux anarchistes s’ils voulaient répondre ou si lui le faisait à leur place. Il précise alors pour la enième fois que dans ce mouvement il n’y avait pas qu’une seule voie. En outre, il spécifie (pour la première fois clairement me semble-t-il) que si la question de l’Etat allait un jour se poser, elle n’était pas à l’ordre du jour. Les anarchistes vont alors rappeler que de grands révolutionnaires mexicains étaient anarchistes et surtout expliquer que l’auto-gestion n’est pas le chaos.
Cette réunion engendrera une prise de conscience chez les anarchistes : ils doivent défendre leurs principes à l’intérieur même de ce mouvement tout en travaillant à rendre plus lisibles leurs principes vis à vis de leurs ‘compañeros’ ignorants sur ce point. De l’autre côté, cette réunion fait dire aux communistes que les anarchistes ont les privilèges du sous-commandant. Nous sommes en réalité face à deux forces inconcialiables et qui pourtant devraient construire ensemble. Avançons que c’est en réalité ‘la troisième voie’ qui devrait l’emporter car la seule qui ouvre la voie à un espace multiple non excluant, ni dominant. La multiplicité est possible à condition de rompre avec les schémas antérieurs. La voie encore inexplorée ne pourra être empruntée qu’à condition que ‘tous’ se défassent en définitive des anciens ‘modes’ et, pourtant, c’est à partir de ces mêmes modes qu’ils devront bâtir. Sortir de ces paradoxes est le chemin qui ouvre la voie à l’alternative : tout le monde le voit, le chemin est long et difficile.
La naissance d’un monde se fait dans la douleur
A chaque réunion, les récits pleuvent. C’est parfois poignant, troublant, c’est parfois rageant ou encourageant, c’est parfois insoutenable, c’est en tous les cas toujours fort et même détonnant. Et c’est aussi la vie qui bât sont plein. Les adhérents, les sympathisants et les autres vivent ces rencontres comme un hymne à l’amour de ‘tous ceux qui ont le cœur qui bât à gauche’ pour la vie et la lutte, comme un hommage à la sensibilité des hommes et des femmes qui offre depuis toujours au monde sa richesse et sa force. Tous délectent ce jaillissement d’énergies rebelles, de convivialité et de connivence, ce moment de ‘vivance[5]’, de magie presque. Ils savent que l’euphorie est momentanée et ne veulent alors pas se priver de ce moment de grand espoir. Dès les premières semaines, des actes de répression ont en effet été signalés après le passage de la Karavane mais, avant tout, ils ont déjà tous l’expérience de la répression (s’ils ne la vivent pas, ils la voient régulièrement). Les récits de luttes sont en effet toujours associés à la répression. Le Mexique est une cocotte-minute. Une pression très forte va devoir être expulsée : la tentation de tous ces gens de laisser jaillir leur ‘rage’ et leur ‘puissance créative’ est si forte qu’elle paraît vouloir s’assouvir bientôt. Et c’est cette excitation qui est resentie.
Tout va pour le mieux jusqu’à la violente répression d’Atenco le 3 et 4 mai 2006. La mort a pris sa place. La répression atteint la communauté d’Atenco (Etat de Mexico). Quelques jours après le passage de la Otra sur ces terres, Atenco est assalli. Connue depuis 2001, Atenco fait référence en général à la communauté de communes sortie victorieuse du conflit avec le gouvernement qui voulait imposer l’installation d’un aéroport international sur leurs terres. En 2006, ils sont adhérents à la Otra. Plus exactement, certains ont maintenu l’activité du FPDT (Front des Communes en Défense pour la Terre) et ont ainsi apporté leur solidarité à d’autres lutte pour la terre. Précurseur d’une certaine façon, cette partie de la population est donc celle qui s’engage dans la Otra. Le 2 mai, les membres du FPDT appuient des fleuristes ambulants en négociation avec les autorités municipales. Il s’agit d’obtenir l’autorisation de vendre exceptionnellement le lendemain (3 mai) aux abords du marché de la ville de Texcoco. C’est un jour de fête sur lequel ils comptent depuis toujours et s’ils ont perdu l’autorisation de vendre tous les jours sur ces lieux, ils réclament donc la possibilité de vendre au moins ce jour là. Marché conclu (et filmé), les 8 fleuristes se mettent en place à l’aube du 3 mai en toute confiance. Pourtant, très vite empêchés par les forces de l’ordre, ils vont devoir se battre s’ils ne veulent pas céder. Ils appellent ceux d’Atenco qui immédiatement leur viennent en aide. Ils barrent une route nationale et celle-ci devient un champ de bataille. Les affrontements sont d’une grande violence et se déroulent à quelques kilomètres d’Atenco. Et c’est sur la commune même d’Atenco que la répression vient s’abattre. Les policiers saccagent, frappent, humilient et tuent. C’est alors un appel à la Otra dans son ensemble qui est fait. Au même moment des faits, la réunion de la Otra avait lieu sur la place des Trois Cultures dans la ville de Mexico (ironie du sort ? cette place symbolise la répression des étudiants en 1968). L’annonce des faits sème le trouble bien évidement. Tous se mettent à discuter. Une partie des adhérents se lance sur Atenco. Le sous-commandant préconise pour sa part des actions sur tout le territoire le lendemain matin à 8 heure. Et c’est à 6 heure que les policiers font leur deuxième entrée dans la ville d’Atenco. Estimés jusqu’à 4000 policiers, ils répètent avec plus de hargne encore les faits de la veille face à 300 personnes mal ‘organisées’ et, surtout, sous le choc.
La répression touche donc les compañeros de la Otra campaña qui, tous par solidarité, avaient apporté leur soutien à ceux qui luttent contre la domination violente de ceux ‘d’en haut’. Répression que l’on pourrait croire inédite tant elle est brutale, elle fait deux morts (le 3, un garçon de 14 ans est tué d’une balle tirée par un policier et le 4, un autre de 21 ans décède après 1 mois de coma suite à un projectile lacrymogène reçu en pleine tête). Elle fait aussi des dizaines de blessés, plusieurs disparus et plus de 210 prisonniers dont 33 des 44 femmes ont été violées. La violence fait peu d’émoi dans la société : la peur a gagné les cœurs et la force incarnée par Atenco a été réduite en poussière en quelques heures de répression et de matraquage médiatique.
On est à un tournant. Dès le 3 mai la Commission sexta interrompt son parcours. Le calendrier est arrêté et plus encore, l’alerte rouge est ravivée. La commission sexta annonce que la liberté des prisonniers devenait la priorité. La Otra n’avancera pas sans les prisonniers. De fait, la commsission sexta et une bonne partie de la Karavane va siéger sur la capitale pendant plusieurs mois. Avec les adhérents de la région ils développent diverses activités et c’est un travail d’organisation autour de la libération des prisonniers politiques qui est entrepris par les adhérents dans tous le pays. Manifestations, création théatrale, récupération de fonds pour payer les cautions, création d’un planton dès les premiers jours devant la prison etc. la lutte s’organise. Ils étendent la lutte à la libération tous les prisonniers et disparus politiques du pays et organisent une ‘assemblée nationale’ autour de cette question. Comprenons donc que l’interruption est celle du programme de réunions et non de la Otra . C’est au contraire même un moment intense qui pourrait engendrer des liens forts. Ils ont un objectif en commun ciblé et vont devoir créer ensemble pour faire sortir les prisonniers.
En réalité, Atenco met fin à l’enthousiasme et fait l’effet d’une grande secousse : elle présage les complications (et la répression, cela va sans dire). L’ennemi demeure le tryptique PRI-PAN[6]-PRD[7], les trois grands partis de cette ‘jeune’ démocratie. Ces trois forces au pouvoir sont en effet mises en cause dans les faits de violence (chacune à son niveau : fédéral, de l’Etat et municipal). Néanmoins, à deux mois des élections, cela fait froid dans le dos. Ce coup est compris comme volontairement porté contre la Otra. Les pouvoirs ont travaillé minutieusement et le message est clair : ‘zéro tolérance’[8]. Les mouvements sociaux vont devoir apprendre à se défendre, adopter une stratégie plus efficace. La solidarité va devoir se déployer. Elle est jusque là encore impuissante car ils ont vainement tenté de faire pression. Il reste aujourd’hui 28 personnes détenues dont trois dans une prison de haute sécurité[9]. Domination incontestable des pouvoirs et impuissance des organisations, l’échec est cuisant mais il n’est pas encore celui de la Otra ni d’un monde à venir. Inadéquation des stratégies face aux ennemis qui, eux, s’adaptent et se perfectionnent : il faut commencer par se défendre. Les organisations, collectifs, groupes et individus doivent apprendre, ensemble. C’est pourtant le début de la division qui commence.
Où en est la Otra ?
Après dix huit mois d’efforts de construction des adhèrents de la Sexta, la Otra est identifiable en mai 2007 sur tout le territoire. En effet, après cinq mois d’alerte, la commission sexta s’est redéployée : des commandants sont venus prendre la relève de Marcos pour que celui-là même poursuivre sa route vers le nord du pays et reprenne le calendrier interrompu au 3 mai. La lutte pour la libération des prisonniers s’est essoufflée et la Otra doit rebondir. Car ils n’avaient pas imaginé que cela serait si difficile (Marcos le souligne lui-même), ils devaient prendre de nouvelles mesures. L’alerte est rompue et la Otra reprend des ailes. Spécifions que l’alerte concernait également les communautés zapatistes et ce sont elles aussi qui reprennent leurs activité : en alerte, le travail des Juntas est interrompu, et les projets suspendus. Il fallait renouer avec le fil de la campagne proprement dite.
Les rencontres dans le nord ont mis en exergue la force ‘inébranlable’ des indigènes, l’efficacité et la perennité de leurs modes. La rencontre à la frontière avec ceux de ‘l’autre côté’ (des Etats-Unis) a ouvert la porte a ceux de tout le Continent. La dimension internationale prend pied avec la rencontre, prévue en octobre 2007, des indigènes de tout le Continent (une première dans le cadre de la Otra). Donc cette première étape de la Otra s’achève. Les rencontres ont eu lieu (hormis celles qui ont été annulées pour différent politique). Elles postulaient que si les gens sentent qu’ils participent d’un même présent, au lieu d’être seuls et démunis au point de céder la destinée de leur vie à d’autres, le monde aurait un autre visage et la vie serait digne. Quand dans un pays des gens qui s’ignorent et même s’opposent se rencontrent et se reconnaissent comme des pairs, le pays peut changer. Alors ces rencontres au fur et à mesure de leur passage imposent l’idée que le pays n’est déjà plus le même
C’est après ces rencontres que la deuxième phase de la Otra peut prendre forme. Une dizaine de commandant va se répartir sur le territoire pour rejoindre certains lieux de lutte. L’objectif est de travailler ensemble et de faire grandir la lutte avec la solidarité mutuelle au quotidien. Cette phase se termine en ce mois de juin.
La présence de commandants sur la côte pacifique nord (basse Californie) à engendrer le lancement d’une ‘autre’ campagne ciblée sur la ‘Défense de la Terre et du Territoire’ au niveau national et international. Une dynamique centrée à présent sur la question de la terre et du territoire permet de déployer le mouvement sur un autre versant que celui de la lutte pour les prisonniers politiques et d’entrer plus à fond dans la lutte.
Si l’on veut avancer un bilan, trois choses seraient à mettre en avant.
Premièrement, les rencontres montrent qu’à l’échelle d’un pays, ‘indépendament’ et malgré toutes leurs différences, les gens peuvent s’écouter, se respecter, s’unir, se solidariser, avancer et créer ensemble. Les rencontres ont forgé des liens entre une partie des adhérents et esquissé les modalités selon lesquelles un peuple peut se constituer autrement que par l’intermédiaire de l’Etat : plus que comme ‘compatriotes’, tous ces gens veulent vivre ensemble comme ‘compagnons’. Ils partagent une même vie[10]. Deuxièmement, la Otra est l’expérimentation d’un autre mode de faire de la politique et, si elle peine à avancer et à faire naître ‘un mouvement’, cela est lié au fait qu’elle est précisément elle-même ce mouvement qui doit parvenir à surmonter la difficulté de faire ‘ensemble’ indépendemment. Il faut inventer en regardant depuis ‘en bas’ et seulement en bas, là où sont tous ‘ceux d’en bas’. Mais ceux qui n’y parviennent pas semble mis sur la touche. Des communiqués de Marcos sont explicites à ce sujet. Ils pointent en effet que certains ont usé de la Otra pour se regonfler tandis que d’autres ne veulent pas céder sur leur vision et le principe de la voie unique de l’Etat. En somme, ceux qui sont en liste sont ceux qui regarde vers le ‘haut’, pensent comme ‘ceux d’en haut’. Il y a donc le FPR (Front Populaire Révolutionnaire), l’une des grandes organisations politiques adhérante, qui se voit concerné. Et c’est alors incompréhension et dispute entre certains membres de cette grande famille. Des clans se forment. S’éloigne-t-on de l’espace multiple ? S’agit-il de faire le tri pour créer avec ceux qui respectent le principe de base et donc tiennent sur le rejet du jeu parlementaire ? Lorsque l’on sait qu’ils s’engagent dans des campagnes électorales et qu’ils ne se sont pas détournés de l’intérêt pour des postes politiques (la situation est plus complexe mais peut s’identifier en ces termes), il semble logique d’opter pour la deuxième version. Toutefois, les critiques faites attaquent précisément le fait que ce soit l’EZLN, les zapatistes à travers la voix de Marcos, qui finalement dirige ce mouvement. Et c’est une période où chacun reprend position et crée des tensions.
Troisièmement, il faut mettre en avant le fait que les groupes d’adhérents peine à échelle locale à s’unir et à créer : les vieilles méthodes résistent, les esprits ont du mal à inventer, ils sont conditionnés, ils ont des vieux réflexes dont il faut se défaire. Il y a le doute, la méfiance, le manque de courage et de force. Alors, les gens le disent eux-mêmes. Changer le monde, c’est voir le monde par une autre fenêtre et d’abord changer soi-même, à se faire une nouvelle peau.
L’accouchement est douloureux et le mouvement naîtra d’efforts d’une grande intensité. Et il y a indéniablement du côté de la Otra une prise de conscience et de confiance en la capacité politique de tous, permettant de dépasser les moments d’hésitation ou de peur pour créer un autre rapport à la politique. Et si les rebondissements, des ruptures complexifient l’organisation de cette campagne, cela lui confère sa dimension réelle car les différences doivent devenir porteuses et défaire l’homogénéisation et la hiérarchisation et c’est un long processus. Et puis, la Otra en est donc à ses premiers pas et ne marche pas encore ‘seule’. Elle ne va pas encore sans l’arbitrage zapatiste (qui ne peut être facilement taxé d’arbitraire) mais ce constat est ‘douloureux’ pour ‘tous’. Un communiqué de Marcos du mois de mai 2007 est plein d’amertume. Amertume, déception c’est ce que ressentent d’autres adhérents rencontrés lors d’un séjour effectué à la même période (avril 2007) au Chiapas et au District fédéral (ville de Mexico). L’épreuve est rude et, aujourd’hui, la Otra est plus que jamais fragilisée. Certes, rien n’est perdu mais c’est loin d’être gagné. Mais si le projet venait à échouer, il en resterait une expérience inédite dont les fruits sont nombreux même si insignifiants au regard de l’objectif fixé : quelque chose a déjà changé et l’expérience de Oaxaca ajoute au panorama Mexicain un élément de taille quant à la possibilité des peuples de s’organiser et de créer un contre-pouvoir.
[1] Armée Zapatiste de Libération Nationale.
[2] Pendant qu’il dialoguait, l’Etat usait d’une stratégie de guerre de basse intensité, et continue. L’organisation zapatiste ne pouvant pas être défaite militairement puisque démocratie naissante le Mexique doit opter pour la voie politique et n’a plus le choix face au soutien national et international.
[3] C’est en son temps ce qu’a signifié la création du FZLN (Front Zapatiste de Libération Nationale). Crée pour qu’il engage, en l’absence de bras armé, une lutte politique avec le reste de la société, il est dissout en décembre 2005. L’échec est en écho avec l’enlisement dans la défense des droits indigènes et des accords : le Front s’est focalisé sur la solidarité avec l’organisation zapatiste sans s’être tournée sur les ‘autres’, eux-mêmes donc. Il disparaître avec la fin de cette première phase.
[4] Aux lendemains de la révolution de 1910, la constitution d’un secteur social, l’ejido, correspondait à ce qui dans le monde indigène est effectif : la terre n’appartient à personne, au contraire les hommes lui appartiennent : ils lui doivent la vie, ils la travaillent, la protègent et la vénèrent. Elle ne peut être vendue : il s’agit de la Terre-mère.
[5] J’emprunte ce terme aux habitants d’Aulnay sous bois qui vivent ‘aux 3000’.
[6] Parti d’Action National : il est au pouvoir présidentiel depuis 2000.
[7] Parti Révolutionnaire Démocratique : il dénonce la fraude qui en 2006 lui aurait fait perdre les présidentielles.
[8] Le test positif de la stratégie ‘antiinsurrectionnelle’ et de ‘guerre de basse intensité’, celui du seuil de tolérance et de la capacité réactionnelle de la société et des mouvements sociaux l’est tout autant. Test convainquant du côté du pouvoir, la violence et la terreur demeurent effectivement des armes fatalement destructrices. Les pouvoirs ont la voie libre : un mois plus tard (début juin) à Oaxaca, la répression est plus violente encore et visait les 75000 professeurs entrés en grève (mais cette fois, le(s) peuple(s) se sont soulevés : un grand mouvement est né).
[9] Ces trois hommes se sont vus condamnés début mai 2007 à 67 ans de réclusion. La violence est aussi symbolique : l’annonce du jugement a eu lieu alors que se célébrait le premier anniversaire de la répression.
[10] Je n’omets pas de préciser quils sont patriotes et non nationalistes xénophobes. Nous n’engagerons pas ici de débat à ce sujet, retenons que le monde à venir reste à former et la question des frontières une question liée à l’Etat qui est encore repoussée à plus tard : nous en parlerons).