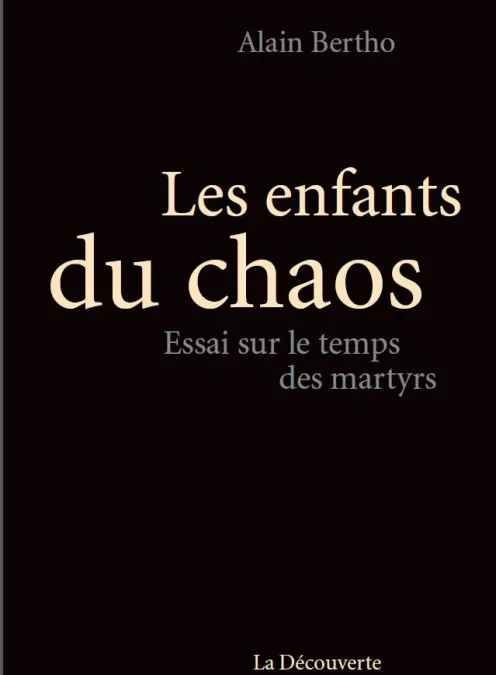Jeunes des quartiers populaires et espaces du dehors

Journée de l’Ecole doctorale de Sciences sociales sous la direction d’Alain Bertho et Hervé Vieillard-Baron, 13 mai 2006
Jeanne-Abigaïl Denzler
Doctorante CEME
En octobre 2002, le ministre de l’intérieur Mr Nicolas Sarkozy propose à l’Assemblée Nationale son « projet de loi sur la sécurité intérieure ». Celui-ci, à travers un verrouillage très sévère de l’espace public, se place dans la lignée des politiques publiques de répression pénale et de contrôle des masses, déjà annoncées par le tournant sécuritaire qui est devenu la priorité de l’Etat depuis quelques années. Ce projet de loi sur la sécurité intérieure examiné et approuvé en mars 2003 par l’Assemblée Nationale, fait de « l’espace public » un lieu sous contrôle de l’Etat et de sa police. Notre lecture de ce verrouillage forcené est celui-ci : l’espace public, la rue devient un des lieux du désordre pour l’Etat, parce qu’elle est l’espace de vie de ceux qui ne répondent pas à sa « norme », puisque c’est ainsi que le champ social est analysé aujourd’hui. Ceux qui sont dans la norme et ceux qui n’y sont pas, les « in et les out », les intégrés et les exclus, les insérés et les inadaptés aux système
Les mesures de répression que le projet de loi amène vont plus loin que toutes les politiques de différenciation de traitement des gens mises en place jusqu’alors. Approuvée, la loi sur la sécurité intérieure fait de « l’espace public » un lieu sous contrôle de l’Etat, à travers les nouvelles formes de délit qu’elle créée mais aussi par le renforcement des forces de sécurité, de leurs moyens et de leurs champs d’action.
Mes travaux sont organisés autour de deux axes de questionnement :
1- D’une part, une réflexion sur la question du contrôle de l’espace public par le pouvoir :
Le gouvernement, à travers ce projet de loi, impose une manière de vivre celui-ci qui annihile tous les « possibles » permis par l’espace urbain, la ville, la rue, les usages qui pouvaient jusqu’à présent en être fait, relatifs à sa nature sociale : Qu’implique la destruction du caractère polyfonctionnel de l’espace urbain ainsi que celui d’espace vécu en subjectivité ? La question qu’on peut se poser est celle-ci : Comment interdire à certains les lieux de tous ? N’est-ce pas incompatible avec ses fonctions premières ?
Selon moi, le projet de loi sur la sécurité intérieure nous indique les formes que prennent ou du moins que peuvent prendre aujourd’hui le contrôle des masses. C’est ce à quoi, j’ai tenté de réfléchir.
2- un questionnement sur le rapport des gens à l’espace public, et sur l’évolution de celui-ci dans le temps s’est posé à moi :
L’espace du dehors dans les quartiers populaires a de tout temps été investi par ses habitants. Qu’en est-il aujourd’hui ? L’évolution des sociétés a ainsi naturellement transformé notre rapport à l’espace public. La rue n’est plus le lieu de tous ni de toutes les activités. Partant de ces constats, certains sociologues et urbanistes contemporains ne cessent de clamer la mort de la rue : ses fonctions sociales et socialisantes ne seraient plus.
Il suffit pourtant de flâner dans les quartiers populaires pour s’apercevoir que la rue est bien vivante : les jeunes des quartiers populaires des centres et ceux des banlieues investissent toujours de manière subjective l’espace du dehors. Responsables, aux yeux de l’Etat et de ses sociologues d’un certain désordre social, les jeunes des quartiers populaires et banlieues sont directement visés par la loi sur la sécurité intérieure. Pourtant, ils font bien partie de ceux qui donnent sens à cet espace,
Aujourd’hui la ville dispose deux espaces de vie populaire : les banlieues et les quartiers populaires des centres ville. Pour des raisons liées à leur histoire et à des politiques d’habitat différentes, leurs caractéristiques urbaines sont dissemblables. Ainsi, je me suis intéressée à l’investissement du « dehors » par les jeunes.
Enjeux de l’appropriation de l’espace par les jeunes
Je me suis demandée si le rapport au dehors était différent, que l’on soit jeune de quartier populaire parisien et jeune de banlieue. En effet, les conditions d’existence de ces derniers sont les mêmes, ils sont pareillement stigmatisés par l’Etat : d’un côté les jeunes « des banlieues », de l’autre, les jeunes « des quartiers ». Or, les différentes enquêtes menées par la « Maîtrise de Sciences et Technique de formation à la connaissance des banlieues » ont montré que la cité, en réalité et par ses caractéristiques urbaines, mais aussi dans les consciences de ses habitants, ne fait pas partie de la ville.
Considérant l’absence des caractéristiques urbaines qui font que la cité « ne fait pas partie » de la ville (absence de commerces, de lieux d’activités et de loisirs, de services, qui en font un espace clos et monofonctionnel); ainsi que celles qui, à l’opposé, font la ville – la rue et ses caractéristiques polyfonctionnelles-, est-ce que le rapport au dehors est aujourd’hui différent, que l’on soit jeune de quartier populaire parisien ou jeune de banlieue ?
Pouvais-je penser que l’occupation des lieux du quartier amène une conscience de la ville, un lien à la ville différent de ceux liés à l’occupation de l’espace de la cité ? En fait, l’ « urbain », en ce qu’il fait ville, était-il un enjeu d’ouverture sur l’extérieur, l’enjeu d’un rapport d’altérité entre soi et le monde ?
Une précision est nécessaire à ce sujet. Ce questionnement sur l’ « urbain », ou plutôt sur ce qui fait ville ou pas dans les caractéristiques de l’espace urbain, ne va pas sans une profonde conviction personnelle : la question du caractère polyfonctionnel ou non de la ville et des lieux publics ne dépend pas seulement d’une question de formes urbaines mais relève de la manière dont un Etat décide ou pas de tenir compte de ses habitants. Les incohérences urbaines sont seulement l’illustration de ce choix politique. (Le rapport que les gens – jeunes ou pas-, entretiennent avec les institutions en découle de même.)
Pour tenter d’apporter quelques éléments de connaissance sur cette question du rapport des jeunes au « dehors », j’ai choisi de m’attacher à l’étude de celui- ci, du point des jeunes d’un quartier populaire de Paris, me disant que la pensée des jeunes de banlieue serait à découvrir lors d’une prochaine enquête
Regardons brièvement les enjeux liés à l’appropriation de l’espace par les jeunes :
Pédagogues et psychanalystes considèrent certains moments du processus de construction de soi comme indispensables et structurants. Selon le psychanalyste Serge Lesourd, l’âge de la jeunesse, de l’adolescence en particulier, est un « enjeu majeur du sujet dans son inscription dans le champ social »[1].
Citons le encore une fois :
« (…) essayer de comprendre la violence collective des jeunes, qu’elle soit considérée comme légitime ou illégitime, ne peut se faire sans le détour par l’agressivité individuelle de toute adolescence »
Or, l’espace public joue un rôle capital à ce moment de la vie, il fonctionne comme un lieu initiatique, rassurant. L’adolescence est cette étape de la vie où la construction de soi ne passe plus par la socialisation institutionnelle ou familiale mais par celle du groupe de pairs.
Citons encore Serge Lesourd.
« La pensée agitée par les questions et les angoisses liées aux bouleversements psychologiques, est vécue par les adolescents comme dangereuse. Le dehors, réel ou imaginaire, apparaît à cette époque de la vie comme sécurisant. Les jeunes vont donc, massivement et de tous temps, investir les espaces publics. »[2]
L’Etat n’est il pas, par sa position répressive, en train de compromettre un point important du développement des jeunes, en train de transformer le rapport au dehors des jeunes en un lien encore plus destructeur et violent ?
Selon J.Y Barrère, « La rue sert à entrer dans la ville dans tous les sens du terme. » En imprégnant de violence le rapport des jeunes à l’espace public, l’Etat n’est-il pas en train de détruire cette inscription, déjà si fragile et conflictuelle dans la ville, dans le champ social, la société ? Certains sociologues regrettent les fonctions génératrices de lien social de la rue et de l’espace public en général, et parlent de crise, apparemment déplorable, du tissu social.
L’enquête
Pour tenter d’apporter quelques éléments de connaissance sur cette question du rapport des jeunes au « dehors », j’ai choisi de m’attacher à l’étude de celui- ci, du point de vue des jeunes d’un quartier populaire de Paris, me disant que la pensée des jeunes de banlieue serait à découvrir lors d’une prochaine enquête.
Dans le contexte d’une enquête visant à interroger le rapport au « dehors » des jeunes des quartiers populaires, il m’a fallu commencer par identifier les mots de ce « dehors » dans la pensée des jeunes que j’allais interroger, et bien sûr, savoir s’il existait un réel intérêt à travailler sur cette question.
Méthodologie
Comment les interroger sur quelque chose dont je ne connaissais pas le nom dans leur pensée ? J’ai effectué une pré enquête qui m’a permis de nommer ce que j’appelais alors le « dehors » : dans la pensée des jeunes, ce dehors se nommait « la rue ». Cette pré enquête m’a aussi permis de comprendre que la rue était bien l’objet d’un investissement particulier pour les jeunes interrogés. Un dernier point est assez important car il est partie intégrante de mes questionnements de départ : celui du choix des jeunes interrogés.
J’ai volontairement interrogé, non pas des adolescents mais de jeunes adultes, de 20 à 30 ans environ. Effectivement, l’espace du dehors répond pour différentes raisons que nous avons évoquées plus haut, aux besoins adolescents, par les dimensions socialisatrices qu’il permet – Il est un enjeux majeur de l’inscription de l’adolescent dans le champ social », ainsi les dimensions socialisatrices qu’il permet sont nécessaires pour se construire à cet âge[3], notamment dans les milieux populaires dont les conditions d’existence en permettent peu d’autres.
Le fait de ne pas renoncer à cet aspect de l’espace du dehors pour des jeunes plus âgés m’a interrogée.
– Que représentait l’espace du dehors pour eux ?
– Pouvaient –ils pérenniser ce type de socialité en étant pourtant dans une projection autre que celle de l’adolescence, d’autres représentations d’eux-mêmes, à un moment de leur vie où les normes sociales leur demandent de s’insérer par le travail dans la société ?
– Quel sens avait cet ancrage au dehors, quel place avait-ce dehors dans leur représentation de la ville ?
Mon enquête a concerné 20 jeunes d’un quartier du XVIIIème arrondissement de Paris, situé à peu près entre les stations de métro Porte de St Ouen à l’ouest, Simplon au nord, la fourche à l’est et Guy Moquet au sud. Le questionnaire était composé de 22 questions, séparées en 4 grands chapitres ainsi que de quelques questions de retour sur l’enquête: Qu’en avaient pensé les jeunes? Avaient-ils des choses à ajouter?
L’objet de l’enquête
L’anthropologie des singularités subjectives propose une vision du monde selon laquelle la pensée subjective porte en elle une légitimité à penser le réel. Elle est l’un des regards sur celui-ci et mérite d’être mise à jour au même titre que d’autres, elle est une rationalité parmi d’autres.
Portant la thèse « la pensée ne pense que la pensée »[4], l’anthropologie des singularités subjectives ne recherche pas les preuves de cohérence d’un tout sociétal, mais s’intéresse aux multiplicités. Aussi, elle veut identifier, non l’implacable rapport des choses entre elles, mais au contraire, ce qui fait leur singularité.
La quête du chercheur est celle du multiple. Ici, penser, c’est dégager les différents « possibles » proposés sur les choses. Comment approcher la singularité des choses : à partir de ce qui fait leur singularité, le subjectif. L’anthropologie des singularités subjectives propose une approche du subjectif à partir de lui-même. Elle choisit d’appréhender la connaissance en intériorité.
Cette démarche anthropologique, puisqu’elle s’intéresse aux singularités subjectives, puisqu’elle considère la pensée subjective comme une rationalité à part entière et disposant une intellectualité propre, propose, comme catégorie de connaissance du réel, l’enquête car celle-ci va disposer le singulier, le subjectif et le multiple en interrogeant la pensée des gens.
Les propos recueillis par l’enquête ne sont pas tous de l’ordre de la pensée : un travail sur les mots permettra de mettre à jour ce qui est de l’ordre de la pensée dans ce qui est dit : « ce qui est pensé dans la pensée ».
Cette partie est consacrée à une lecture rapide des entretiens que j’ai effectués. Il s’agit d’un travail en intériorité sur la pensée des jeunes. Il s’organise autour de trois thèmes : la rue, le quartier, les jeunes et le gouvernement
Le mot « rue »
Le mot « rue » est complexe, multiple de sens et de prescriptions.
Il dispose plusieurs représentations singulières et disjointes, chacune étant liée à une idée de ce qu’est la rue pour les jeunes. La rue est donc apparue comme un mot multiple. Avec la catégorie de multiplicité, j’entends indiquer que le mot ne peut être restreint à la définition de son signifié, il est producteur de polysémie. Travailler sur un mot va permettre de rompre avec cette polysémie et mettre à jour ce qu’il prescrit là.
Une première entrée présente « la rue » comme l’objet d’un attachement particulier.
Elle peut représenter « la routine », répétitive et lassante, et dispose un rapport au temps particulier fait d’inaction et de rapports de groupe.
L’analyse a aussi fait apparaître qu’un lien passionnel, d’amour et de rejet pouvait être tissé avec la rue. L’amour de la rue n’est pas un amour choisi, c’est un amour fou dont on n’est pas maître et qui engage des liens de dépendance non contrôlés.
La rue est très souvent personnifiée, parfois comparée à une femme, souvent à une famille car elle dispose des rapports interpersonnels non choisis mais empreints de sentiments ambivalents, d’indifférence, d’amour, d’hypocrisie, de cruauté, typiques des liens familiaux.
L’analyse a fait apparaître que la rue n’est rien sans les gens qui la composent, qu’elle n’existe que par ce qu’elle représente pour chacun ou encore par ce que chacun y fait : « la rue sans les gens qui la composent, ça veut rien dire du tout ».
D’autres thèses, donnent la rue comme un lieu public et en partage. Le mot « rue » porte des prescriptions différentes selon son usage. La rue des jeunes n’est pas la rue de tous. Pour certains jeunes, elle est juste un lieu de passage, pour d’autres c’est beaucoup plus. Dans tous les cas, ce n’est pas « la rue donnée à tout le monde », c’est la rue qu’on « fréquente ». Il apparaît que « fréquenter la rue »induit un rapport singulier et difficile, objet d’un choix, celui de « la vie de la rue ».
Une autre entrée montre les différentes fonctions de la rue selon les jeunes. Elle apparaît comme le lieu d’expression des différentes sphères de la vie des jeunes.
Elle peut être le lieu d’expression des conflits : lieu d’affrontement entre quartiers ou encore avec la police. Elle est aussi l’expression d’une certaine liberté ; liberté de s’exprimer, absence de contraintes, tribune libre. Mais elle est aussi le lieu de l’échec individuel : au présent, elle est la représentation d’une vie en échec, l’expression de la résignation à une existence sans choix. Dans la projection, elle est le symbole d’une vie ratée : « c’est là où je finirai si j’ai pas réussi ».
Enfin, elle est le lieu du rapport à autrui ; lieu du multiple, de l’hétérogène, lieu du « tout » et du « tout le monde », lieu du lien, quand toutes les autres sphères socialisantes sont en rupture : « la rue c’est le dernier lien social quand t’es coupé du monde du travail et des études (…) ».
Enfin, une dernière entrée montre que le rapport à la rue est organisé non selon un schéma de continuité mais selon un principe de ruptures qui dissocient un « avant dans la rue » et un « maintenant ».J’ai identifié trois principes de rupture: le temps, le choix, la prise de conscience, ceux-ci induisant des usages différents des usages antérieurs : l’ « avant » étant lié à « subvenir à ses besoins », « intérêt » et « argent » le « maintenant » à « amitié » et « tuer le temps ». La rue est considérée dans le rapport à l’autre et plus dans ce qu’on peut y prendre pour soi.
Rue, en conclusion
Les caractéristiques principales de cette rue décrite par les jeunes sont celles-ci : lieu du multiple, de l’hétérogène, lieu du « libre » et lieu du lien.
En fait, la rue permet ce lien avec la ville, et par extension avec la société ce qui n’irait pas de soi chez certains jeunes, coupés de sphères socialisantes. L’attachement à la rue, c’est finalement très souvent l’attachement à la diversité, au multiple, c’est le refus de l’enfermement et de la rupture.
Etre dans la rue permet aussi de ne pas perdre pied. Dans ce sens, la rue est productrice de lien. Déjà, dire cela, parler de la pratique de la rue par les jeunes comme lien social, c’est aller à l’encontre de tous les discours produits sur le rapport des jeunes à l’espace. Peut-être est-ce un des points important de cette étude :
Les jeunes, ne se positionnent pas, dans l’espace de cette enquête, « contre » la société à travers leur appropriation de l’espace, au contraire elle témoigne d’une inscription dans le champ social, d’une conscience des possibles de la ville.
On le voit aussi, cette rue-là n’est pas le lieu du repli identitaire, « ethnique » – comme diraient d’autres- ou religieux. Cette rue n’est pas non plus la rue de la violence, de la drogue, des gangs, de la « sous culture de cité ».
Vraiment, mes interlocuteurs ne m’ont pas parlé de cela, mais bien de leur pratique de l’espace. Bien sûr, celle-ci a ses codes, mais comme toute pratique sociale, elle est faite de lois spécifiques : la moindre queue à la boulangerie fonctionne selon des principes bien définis, implicitement et inconsciemment connus de tous, il en a de même pour l’usage de la rue.
Michèle de la Pradèle, anthropologue à l’EHESS, a rédigé dans l’ouvrage « La ville et l’urbain, l’Etat des savoirs »[5], le chapitre « la ville et les anthropologues ». Elle y critique très explicitement une certaine pratique de l’anthropologie urbaine comme représentation ethnographique de la réalité sociale, une tendance à « découper de l’intérieur le phénomène urbain », le décrire comme autant de petites sociétés autonomes où se manifestent des comportements censés être caractéristiques de celles-ci. Ce n’est pas cette anthropologie « urbaine » là qu’elle entend pratiquer, car selon elle, « le propre de cette ville des ethnologues est que la ville y disparaît, il n’en reste qu’une série de fragments disparates juxtaposés (…) ».
Aussi, la catégorie d’ « urbain » ne désigne pas, dans sa pensée, la somme des cultures (et « sous cultures ») existant dans la ville : selon elle, « est urbain pour l’anthropologue ce qui est produit comme tel par les différents acteurs ».[6] Cette enquête, je crois, montre la capacité des jeunes à créer leur propre inscription dans la ville. A travers les mots des jeunes, c’est l’un des visages de la ville qui se dévoile. Ce travail prend donc sa place dans la problématique d’un questionnement sur la ville, sur les différentes logiques à l’œuvre dans la ville et sur leur sens. En cela, il met à jour un des modèles d’appropriation de l’urbain.
A côté de cela, on l’a vu, on ne compte plus les textes des urbanistes et sociologues de l’urbain qui clament la mort de la rue. Alain Leménorel, dans l’ouvrage collectif « La rue, lieu de sociabilité ? Rencontres de la rue »[7] écrit par exemple « le plus grave (…) est l’éclatement de la ville et la mort de la rue, en tant qu’espace de référence, de représentation et de socialisation. » [8]
Dans mon enquête, ceci est erroné. On ne compte plus non plus les textes des sociologues qui écrivent sur l’appropriation de l’espace des jeunes des milieux populaires. Ils parlent d’ « intrusion », d’ « appropriation intempestive », d’ « occupation », de « squat ». Ainsi, selon eux, les jeunes s’approprient l’espace, mais mal.
Les travaux de ces sociologues se placent dans la droite ligne de la thématique de l’ordre et du désordre social invoqué par les gouvernements actuels. L’appropriation de l’espace par les jeunes des milieux populaires est analysée comme une mise en désordre de l’espace public. Elle ne peut être analysée autrement de leur part, puisqu’elle vient d’une catégorie de population dont l’existence même tient, de leur point de vue, de la rupture d’ordre et dont la présence en France est intrinsèquement liée à la question du désordre social. Nous n’avons cessé de le voir cela, jusque là.
La pratique de l’espace des jeunes des milieux populaires
Ce travail voulait donc ouvrir à une autre analyse du thème de la pratique de l’espace des jeunes des milieux populaires.
Travailler sur l’inscription dans l’urbain des jeunes, sur le sens de l’espace pour eux, n’est rien d’autre que poser la question de leur citadinité.
La catégorie de « citadin », je l’appréhende ici selon son sens premier, c’est-à-dire, simplement, « de la ville ». Telle que je l’entends, la notion de « citadinité » désigne une pratique et une représentation de la ville. Ici donc, on parle de citadins et de leur liberté à créer quelque chose de particulier dans l’espace de la ville.
Cette enquête nous permet de remettre en cause une des catégories phare de la thématique du désordre social qui est « la fracture ».
Dans les thèses portées par les mots des jeunes, il n’y a pas trace de fracture ; ni sociale, ni urbaine. Les jeunes parlent au contraire de la rue de l’espace public comme lien.
Les mots des jeunes confirment par ailleurs les travaux de la MST « formation à la connaissance des banlieues » sur la question de l’urbain :
Ce qui fait ville, c’est l’hétérogénéité, la polyfonctionnalité, le multiple, l’imbrication du chacun et du tous, le croisement du public et du privé. C’est cela qui fait que la cité ne fait pas partie de la ville, car la cité, dans ses formes urbaines, ne permet que de l’entre-soi.
En ce sens, peut-être, l’investissement de la rue pour des jeunes vivant dans les quartiers populaires des centres, est-il différent de celui des jeunes de banlieue. Mais c’est encore à voir.
Les jeunes ont mis en valeur ce qui faisait sens pour eux dans la ville : la rue des jeunes, nous l’avons vu, dispose les catégories de « multiple », d’ « hétérogène », de « possible ». Les jeunes parlent aussi de la rue comme lieu du libre. Cette idée de liberté dans la rue se déploie aussi avec la question du choix, et notamment, celle du choix de vie – la vie de la rue– qui est une prescription d’une grande force. Cette idée de liberté peut aussi s’entrevoir dans cette question du rapport au temps, désinvesti, sans rapport de dépendance à celui-ci (ni dans l’épreuve de l’attente, ni dans la course au temps,…).
Nous pouvons aussi constater que la notion de liberté prescrite par les jeunes rejette toute idée de responsabilité, d’obligation, de contrainte. Selon eux, c’est cela être libre.
Liberté, du point des jeunes, est je pense un mot à interroger, à creuser, pour comprendre quelque chose du rapport à la vie, à l’existence des jeunes d’aujourd’hui.
Face aux discours de certains sociologues pour qui l’espace de la ville ne semble pouvoir être investi qu’en fonction d’une certaine norme, qui est celle de l’ordre des choses à ne pas déranger, se pose une vision des jeunes différente.
L’inscription dans la ville des jeunes, parce qu’elle prend des formes qui ne sont contrôlées que par eux-mêmes (par exemple à travers ce r apport au temps bien particulier) et parce qu’elle prescrit, dans leur pensée, une certaine idée de la liberté, est dérangeante et n’est pas acceptée comme telle.
Pour toutes ces raisons, (et pour beaucoup d’autres) la rue des jeunes est selon moi, un lieu de contre pouvoir.
Quartier
Passons maintenant à un retour sur l’analyse du mot « quartier », qui, au même titre que « rue », est apparu comme un mot des jeunes aux assignations multiples.
Le mot « quartier » propose un rapport au monde d’un autre ordre que celui qui ressort du mot « rue ». Dans la pensée des jeunes, le mot « quartier » renvoie à une perception de l’espace totalement singulière et distincte de sa définition administrative. (« D’une, un quartier, c’est pas là où on habite, c’est là où on traîne »)
Selon la même logique d’organisation que pour le mot « rue », un premier chapitre montrait les différentes prescriptions sur le quartier dans la pensée des jeunes.
Avant tout, la définition du quartier passe par l’évocation de l’humain, « un quartier, c’est des gens ».
La catégorie « quartier » est subjective. Elle représente une délimitation approximative du territoire essentiellement liée à une perception subjective de celui-ci.
Le lien qui attache au quartier est presque un lien de sang, un lien dont on ne peut se défaire malgré les années et la distance : « quoi que tu sois ou qui que tu sois, si t’es du quartier, tu reviendras ».
Les limites du quartier sont déterminées par soi-même : « un quartier, c’est là où on traîne », c’est « partout où tu connais du monde ». Peu importe les limites de ces lieux, il faut pouvoir garantir des liens nombreux. Ainsi, l’analyse montre que le « 18ème » est le nom subjectif de tous ces endroits où l’on connaît du monde. C’est le nom d’une division affective et personnelle du territoire.
« Quartier » convoque aussi « quartier pauvre » et « quartier riche» pour les jeunes interrogés. Selon les jeunes, le fait d’habiter un quartier pauvre est la condition d’une inscription singulière dans la ville.
Un second chapitre associait au mot « quartier » un ressenti personnel. Ainsi, le quartier en soi n’est rien, ou alors, il est comme tous les quartiers. Ce qui lui donne son importance et même sa grandeur sont les références subjectives de chacun, la référence au quartier est empreinte d’affect. Le quartier, en effet, est le territoire de l’intime, des relations de familiarité.
Le quartier est doté de dimensions personnelles, sentimentales et symboliques. Il est un prolongement de soi, la relation au quartier est intense, emprunte de morceaux de soi. On vit le quartier.
Le quartier réfère aussi au vécu, il est une identité personnelle, mais il est aussi une référence collective, il est l’âme du groupe. (« C’est là où on a grandi »). Il est fédérateur, instigateur de collectif. Il est la condition du vécu en commun. Tantôt les références au collectif sont négatives et vécues comme un poids écrasant, la marque de la primauté du groupe sur l’individu (« On subit la vie du quartier puisqu’on est conditionné par le quartier ») ; tantôt, elles sont positives, et le quartier est vécu comme un endroit reposant, disposant un rapport aux autres qui permet l’abandon de soi. (« C’est mon QG, c’est mon repos, c’est là que je vais chercher du réconfort quand je suis perdu »)
Jean-Claude Izzo, écrivain mort en 2000, disait à propos de sa ville aimée : « Marseille, voilà mon identité, ma culture et ma morale »[9]. Soit exactement ce qui est reproché aux jeunes des quartiers populaires. On ne reproche pas à Izzo d’investir sa ville.
Revenons sur deux prescriptions des jeunes, tout à fait distinctes l’une de l’autre :
1- « J’aime mon quartier, et c’est que entre moi et mon quartier »
2- « Dans les quartiers pauvres, on est fou amoureux de sa ville ».
Elles me font encore penser aux écrits d’Izzo. Quand Izzo parle de Marseille, il dit les mêmes choses :
« Ce sont souvent des amours secrètes, celles qu’on partage avec une ville»[10]
« Je ne suis pas chauvin, je suis marseillais, c’est à dire d’ici, passionnément. »
On y retrouve dans les deux cas, cette idée d’amour, voire d’humanisation et de personnification de l’urbain. Deux choses diffèrent cependant.
La première réside (en tout cas dans ces extraits là) dans le fait que les jeunes parlent du quartier et Izzo de la ville. Cependant, je pense que pour que chez les jeunes, l’inscription au quartier s’élargisse à l’espace de la ville, il faudrait que l’espace de la ville soit accessible aux jeunes des quartiers populaires des centres et des banlieues. Ce qui n’est pas le cas, ni dans les faits, ni dans les consciences.
La deuxième tient au fait qu’Izzo pratique et pense sa ville en toute légitimité. Il n’existe pas de catégorie de jugement extérieur concernant le rapport à la ville de Jean-Claude Izzo.
Au vu des études sur les jeunes et la ville, ce n’est pas leur cas. De plus, dans ces études, il n’est accordé aux jeunes aucune capacité à penser et à vivre individuellement l’espace du dehors. Les thèses qui ressortent de ma précédente enquête sur le mot « quartier » – ainsi que les multiples prescriptions sur « rue »- montrent le contraire.
Conclusion
Parler du quartier comme lieu de la ville aimé et approprié : nous sommes bien là dans ce qui « fait sens » dans une ville.
Je conclue ici sur « quartier » en soulevant l’absence de catégories liées à la violence dans les énoncés sur le mot « quartier ».
Le quartier, chez les jeunes interrogés n’est pas l’espace de la violence. (La catégorie « rue » déployait le registre de l’affrontement, pas celle de « quartier »).
Aussi, ce travail va à l’encontre des thèses emblématiques de la sociologie et de l’anthropologie urbaine actuelles, notamment celles de Jacques Donzelot exposées dans « la nouvelle question urbaine »[11] dans lesquelles la catégorie « quartier » est directement liée à la problématique de la violence.
La rue, mon quartier
Dans la pensée des jeunes, « rue » et « quartier » désignent des représentations et des modes d’investissements du dehors distincts. La rue est le lieu d’un investissement du dehors singulier qui rompt totalement avec l’usage et les représentations courantes de la rue. La rue des jeunes n’est pas la rue de « tout le monde ». Elle est l’objet de comparaisons ou de métaphores multiples qui disposent toutes ses facettes dans la pensée des jeunes : la routine, la famille, le lieu d’expression des conflits, de la liberté, de l’échec individuel,…
Le rapport des jeunes à la rue n’est jamais fait d’indifférence. Il est passionnel, même quand il est rejeté. Parfois le rapport à la rue est difficile, cru. La rue peut être vécue comme dangereuse car elle peut prendre le dessus sur soi. On ne maîtrise pas forcément son rapport à la rue. On peut décrire les formes qu’il prend. Le rapport à la rue est exprimé comme un fait. « La rue, c’est ça ». Il peut même être subit. Si je ne réussis pas, je finirais là.
Le quartier est aussi le lieu d’investissements singuliers et multiples mais il n’est pas le lieu du multiple. Il ne fait pas l’objet d’une multitude de définitions disjointes. Il est le lieu de l’intime, du familier. Il fait partit de soi car il est imprégné de vécu individuel et collectif.
Il est une sorte de prolongement de soi dans la ville, autant d’un point de vue personnel que collectif : il est l’âme du groupe, il est même l’identité populaire revendiquée. Le quartier parle de soi. Il représente ce que l’on est. Les rapports affectifs qui nous lient au quartier sont revendiqués. Quartier est le nom d’un découpage subjectif du territoire. Quartier est le mot qui décrit une urbanité assumée, revendiquée, faite sienne.
Faire ville prend tout son sens avec la notion de quartier déployée ici.
Rue est le nom d’un rapport subjectif à l’espace du dehors.
Quartier est le nom d’un rapport subjectif au territoire. C’est pourquoi ils portent des enjeux différents et font appel à des sphères de la pensée d’ordre différentes. Les résultats de mon enquête m’avaient emmenée loin des thèses que j’ai pu lire dans les divers ouvrages qui mettent en scène jeunes et espace public.
Bien sûr, le discours des jeunes sur la rue et sur leur pratique du dehors est parfois dur et désabusé. Mais cet aspect de la rue a été assez décrit, reprit et utilisé.
La question du choix de certains objets d’étude implique des choix éthiques, politiques. Je l’avais déjà écrit dans la partie méthodologique de mon précédent travail, selon moi, la science est une question de choix et de subjectivité : le point de départ d’une recherche et son application sont de l’ordre de la subjectivité.
J’ai essayé par ce travail et par le précédent, de montrer que le dehors des jeunes n’était pas réductible à ses aspects difficiles. Je ne prétends pas qu’il n’est pas aussi cela, mais il est multiple, et ses multiples aspects sont mis en valeur en fonction des auteurs.
Je pense qu’il est nécessaire de contrer cette sociologie servant de justification aux politiques étatiques de répression. Cependant, et cela est certainement fondamental, lutter contre un certain type de discours ne peut constituer la base d’une vraie réflexion. Penser, écrire « contre », tenter de démonter l’inexactitude d’une pensée implique de rester dans le système de pensabilité qu’elle propose en y opposant des arguments contraires. Rapidement, on se heurte aux limites de ce système ce qui atténue la puissance et la liberté de nos propres énoncés. Contourner ces écueils de la critique n’est pas un exercice facile. J’y ai encore beaucoup de peine.
D’une manière générale, l’investissement de l’espace par les jeunes pose de vraies questions sur ce à quoi sert une ville aujourd’hui, donne aussi de vraies réponse sur les possibles qu’elle dispose. Ceci reste le point de départ de mes questionnements.
Je pense que le débat sur la ville, le lien social, les fractures sociales et urbaines reste totalement vide de sens tant que l’on refuse d’interroger, de comprendre, d’accepter les multiples manières d’habiter aujourd’hui sa ville, son quartier, son immeuble,…
Travailler sur le rapport à la rue des jeunes adultes dans les quartiers populaires permet de réfléchir à leur inscription à la ville. Du point de vue d’une anthropologie pragmatique, ceci est à creuser dans la perspective de réflexions sur la ville aujourd’hui.
Selon moi, il est essentiel de réfléchir aux formes de conscience, nouvelles, de la jeunesse d’aujourd’hui.
[1] adolescences, rencontres du féminin, ERES, 1994
[2] La Jeunesse et la Rue, sous la direction d’Alain Vulbeau et Jean-Yves Barrèyre, Desclée de Brower, 1994
[3]Voir les travaux du psychanalyste Serge Lesourd, notamment : – Adolescences, rencontres du féminin, ères, 1994. Sous la direction d’Alain Vulbeau et Jean-Yves Barrère, La jeunesse et la rue, Desclée de Brower, 1994
[4] Sylvain Lazarus, Anthropologie du nom, Seuil, 1996
[5] Sous la direction de Thierry Paquot, Michel Lussault et Sophie Body-Gendrot, La ville et l’urbain, L’état des savoirs, Ed, La découverte et Syros, paris, 2000
[6] La ville et l’urbain, L’état des savoirs, page 47
[7] La rue, lieu de sociabilité ? Rencontres de la rue, Actes du colloque de Rouen, textes réunis par Alain Leménorel, publications de l’université de Rouen, 1997
[8] page 429
[9]Marseille, Jean-Claude Izzo et Daniel Mordzinski, Hoëbeke, Paris, 2000
[10]ibidem
[11]La nouvelle question urbaine, Jacques Donzelot, 1999.
Selon Donzelot, l’ « intégration » au quartier engendre une « culture de la violence ».