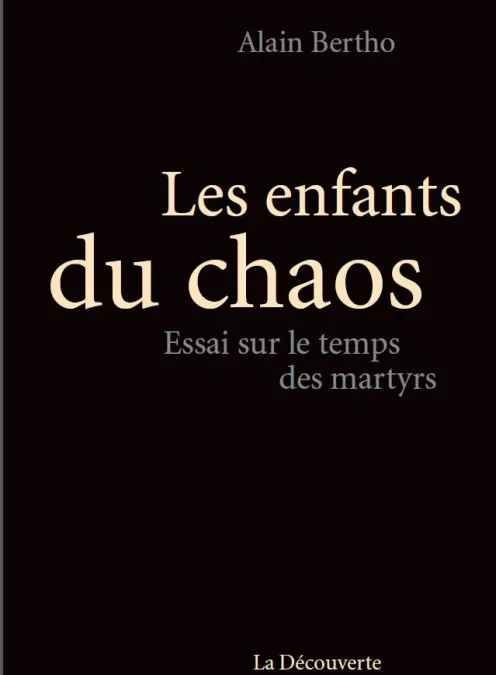Soutenance de HDR
Etat travail et politique en banlieue
Alain Bertho
Habilitation à Diriger des Recherches
Soutenue à l’Université d’Evry-Val d’Essonne le 26 janvier 2000. Jury : Pierre Cours-Saliès (Université d’Evry). Francis Godard (CNRS), Sylvain Lazarus (Paris 8), Daniel Lindenberg (Paris 8), René Mouriaux (CEVIPOF), Jan Spurk (Université d’Evry), président du jury
Exposé de soutenance
Le mémoire que je soutiens aujourd’hui n’obéit pas complètement à l’une des rares lois du genre qui consiste à présenter les travaux de recherche effectués depuis la thèse. Il y a deux raisons à cela.
La première tient au fait que j’ai soutenu ma thèse assez tard, après de longues années de recherches.
Ma thèse sur la Crise de la politique en milieu populaire a bien été le point de départ de mes recherches présentes sur la banlieue, le travail, l’Etat et la politique, qu’il s’agisse de l’enquête effectuée pour le Plan urbain, du travail sur les formes contemporaine de mobilisation ou sur la professionnalité.
Mais à bien des égards elle a aussi été l’aboutissement des problématiques accumulées au cours des enquêtes sur les comportements politiques dans les années 80, de mon travail historique sur le syndicalisme dans le Val de Marne ou du travail effectué au sein du Diplôme d’Université « Connaissance des banlieues » sur les pratiques professionnelles et les nouveaux dispositifs institutionnels de la Politique de la ville. Mes publications, avant et après la thèse, jalonnent les différentes étapes de cette réflexion que je retrace dans mon mémoire.
L’autre raison de ce désir de présenter ici globalement mes travaux est plus fondamentale. C’est qu’au travers de plus de deux décennies de recherche, au travers des trois disciplines que j’ai pratiquées successivement et parfois simultanément, au travers de la diversité de mes objets empiriques, il y a à l’évidence un fil rouge, une préoccupation première et permanente que les circonstances qui nous réunissent ont été, pour moi, l’occasion de reprendre.
Politique et sociologie
Ce fil rouge concerne les rapports de la politique et de la science sociale.
J’entends par là les deux volets possibles de ces rapports : celui de la politique comme objet de démarche cognitive mais aussi celui de la politique comme « convocation à connaître » pour reprendre l’expression de Yves Schwartz.
Rien de moins ! me direz-vous… J’ai bien conscience de toucher là à une question fondamentale, fondatrice pour une part des dites Sciences sociales. On dispose sur le sujet d’une tradition de débats et de réflexions aussi ancienne que les disciplines que je pratique. Pour n’aborder ici que la sociologie, Durkheim et Weber sont ici immédiatement convoqués, l’un lorsqu’il porte la sociologie sur les fonds baptismaux en la séparant du socialisme, l’autre quand il distingue l’éthique de la responsabilité de l’éthique de la conviction. Pour autant, chacun sait que l’affaire n’est pas close et ne le sera sans doute jamais.
Cet intérêt particulier s’enracine à l’évidence dans mon itinéraire personnel. La politique, disait Weber, exige de la passion. Je crois que je n’en ai pas manqué, la prenant d’emblée comme objet de mes premiers travaux historiques sur le Morbihan comme de mes premiers travaux de sociologie sur la banlieue quelques années plus tard. Mais, m’y étant aussi investi personnellement, j’ai par ailleurs regardé longtemps les sciences sociales comme un auxiliaire précieux de la réflexion et de l’action. C’est dans cette optique qu’avec quelques autres j’ai fondé il y a dix-neuf ans, la revue Société Française que j’ai longtemps dirigée.
Or cette expérience singulière m’a assez vite confronté à un problème de taille.
Les ruptures politiques, symboliques, intellectuelles des années 80 s’avéraient de plus en plus évidemment impensables avec le seul corpus catégoriel et théorique de la sociologie. Pour reprendre la formule de Thomas Khun[1], la science sociale se trouvait alors confrontée à une « anomalie », appelant avec de plus en plus de force un renouveau paradigmatique.
Si l’omniprésence du mot crise, observable depuis plusieurs années déjà, signalait bien la présomption de rupture, c’est, je pense, la thématique alors nouvelle de la « banlieue » qui a, en France du moins, le plus précisément nommé la perturbation intellectuelle à laquelle nous avons tous été confrontés.
La société n’était plus ce qu’elle avait été, mais surtout ne pouvait plus être pensée comme elle l’avait été.
Certains courants sociologiques étaient sans doute un peu mieux préparés que d’autres à aborder cette discontinuité historique puisque le changement d’historicité faisait partie de leurs hypothèses de base. On ne s’étonnera donc pas que c’est avec eux que j’ai eu et que je continue à avoir les débats les plus nourris. Les désaccords sont souvent productifs lorsqu’ils se développent sur des questions en partage.
Les thématiques qui émergent alors, celles de l’éclatement, de l’exclusion, de la violence sociale remettent toutes peu ou prou en cause le concept même de société.. Comme l’expriment François Dubet et Danilo Martucelli dans leur dernier ouvrage[2] :
Notre société est une société désarticulée, (…), désormais, c’est la désarticulation qui commande la représentation de la totalité. Le principe de totalité ne gouverne plus la vie sociale, il n’est que son produit aléatoire.[3]
Le diagnostic est sans appel : le principe d’unité interne à la société est devenu introuvable. La tendance dominante, alors et d’aller chercher ailleurs un tel principe, du côté, par exemple, de l’Etat. Je citerai à son tour Robert Castel comme en écho[4]
Pour peser sur le cours des choses, deux variables seront à coup sûr déterminantes : l’effort intellectuel pour analyser la situation dans sa complexité, et la volonté politique de la maîtriser en imposant cette clause de sauvegarde de la société qu’est le maintien de la cohésion sociale.
Je discute pour ma part les deux thèses.
Celle, d’une part qui consiste à poser comme le font François Dubet et Danilo Martucelli que l’unité sociale n’est qu’un effet de représentation distinct des faits sociaux par ailleurs désarticulés (je cite : « L’idée de société (…) est le résultat d’un travail constant, à travers divers conflits, pour dégager une représentation pratique de la vie sociale. « Représentations » signifie que la société se construit à distance des faits sociaux.[5] »). Et celle de la recherche hétéronome d’une solidarité étatique qui perd au passage son statut durkheimien de résultante de la division sociale du travail pour devenir une prescription volontariste.
Il me semble que la clé de l’énigme doit être cherchée du côté de la politique, très précisément du côté de ce qui a pris fin dans la politique au début des années 80.
Précisons bien que par politique, je n’entends pas ici l’espace de l’Etat, ni la part la plus institutionnalisée de la politique. Ce qui a pris fin en effet, c’est le nom politique qui a longtemps été donné au travail dans sa division sociale, je veux parler de la classe. Ce que nous aurions alors à réfléchir c’est comment cet achèvement proprement politique produit des effets lourds sur l’intellectualité savante de la situation.
Si cette hypothèse est avérée, nous sommes devant une difficulté majeure. Cela signifie en effet que la sociologie se trouverait perturbée par ce qu’elle a eu le plus de difficulté à construire en objet tout au long de son histoire : la politique comme activité et comme subjectivité qui, du statut d’effet social qu’on lui concédait, serait ici rehaussée à celui de déterminant intellectuel.
On pressent le scandale.
Je nous invite, avant de le laisser éclater, à examiner avec soin, les tenants et aboutissants de cette hypothèse sur les points sur lesquels mes travaux m’ont amené à réfléchir : l’identification de la politique d’abord, celle du travail et de la ville ensuite.
Qu’est-ce que la politique ?
Le verdict de crise de la politique lancé au milieu des années 80 fait aujourd’hui quasiment consensus.
Une crise de plus.
Mais comment la caractériser ? Doit-on penser ensemble la crise de la représentation et l’épuisement mondial du communisme qui a marqué le siècle ? Doit-on d’abord la lire comme un processus de désaffiliation, c’est à dire un processus de délitement pratique et institutionnel d’organisations étatiques ou militantes et des cultures qu’elles portaient ?
Cette lecture est empiriquement incontournable. Mais elle ne rend pas compte de l’émergence par ailleurs d’autres formes de conscience et d’autres modes militants, ce que la langue naturelle française désigne sous le terme de mouvement social, faute de pouvoir les faire entrer dans un lexique institutionnalisé par trop lié aux formes apparemment frappées d’obsolescence.
On ne peut penser les processus contemporains qu’en admettant que la politique, et singulièrement la politique populaire, déborde toujours l’espace public et institutionnel. C’est avec cette part insaisissable, non institutionnalisée de la politique que la sociologie a le plus souvent des difficultés :
Comment en effet identifier cette subjectivité prescriptive comme fait social déterminé alors même qu’elle se donne comme l’énoncé d’un autre possible ?
La réponse de Pierre Bourdieu, pourtant ostensiblement attentif à l’émergence de ces nouveaux possibles, est assez radicale. Je me permets de citer ici les dernières lignes de la Misère du Monde :
(La science) se satisfait des vérités partielles et provisoires qu’elle peut conquérir contre la vision commune et contre la doxa intellectuelle et qui sont en mesure de procurer les seuls moyens rationnels d’utiliser pleinement les marges de manœuvre laissées à la liberté, c’est-à-dire à l’action politique.
Je dis que cette réponse est radicale en ce sens qu’elle décide de ne pas penser cette subjectivité dans le champ de la science, qui ne pourrait donc penser que les faits déterminés, mais dans celui, indéfini, de la liberté. Robert Castel parlait tout à l’heure de volonté. Cette réponse est extrême, massive, mais ce n’est pas la seule.
Le travail sur le rapport des ouvriers aux normes et à l’engagement, qu’il s’agisse des travaux de Michel Verret et de ses très belles synthèses (Le travail ouvrier, La culture ouvrière et L’espace ouvrier), de Jean Paul Molinari sur les ouvriers communistes ou de Jean Pierre Terrail sur le rapport à la boisson dans la classe ouvrière m’ont indiqué d’autres pistes. Toutes me conduisaient vers le rapport entre l’expérience subjective du travail et cette subjectivité prescriptive.
Tout me conduisait donc vers le rapport entre le travail et ce que, dans l’ensemble de ce qu’on appelle politique, on pourrait identifier comme une posture militante.
Travail et politique
Entendons-nous bien : je ne suis pas là en train de redécouvrir l’antienne de la détermination de la conscience par les conditions d’existence et de travail.
Je suis en train de suggérer la thèse d’une parenté entre la subjectivité au travail et la subjectivité politique, parenté dans la posture normative et prescriptive, parenté dans la mobilisation d’une rationalité du possible. Sylvain Lazarus parle de l’innommabilité de la politique, Yves Schwartz affirme de son côté que « définir le travail est une mission impossible »[6].
Travail événement, pour reprendre la formule de Philippe Zarifian, travail « usage de soi », « comme une sorte de destin à vivre, où il faut toujours, même dans le microscopique, se choisir en choisissant les figures possibles de son rapport aux autres et à la vie sociale » (Yves Schwartz).
On comprendra pourquoi certains travaux de sociologues du travail ont pu croiser mes préoccupations de sociologue politique. Qu’il s’agisse de mes rencontres avec des militants ouvriers ou des matériaux d’enquête sur la professionnalité en banlieue, que les entretiens soient commandés par une interrogation sur la politique ou sur le métier, j’ai toujours fait le constat de ce nouage irréductible dans la confrontation singulière et normative à l’aléatoire et aux possibles.
Le travail travaille aussi sur les normes et les valeurs. Il n’est pas qu’une assignation à des rôles sociaux. Il remet sans cesse sur le chantier l’état des choses, en transforme simultanément l’objectivité et la subjectivité, la matérialité des situations et des matières et leur intellectualité. A peine est-on en mesure de le penser que le travail lui-même change la donne.
L’anticipation rationnelle et savante doit avoir conscience de son éternel retard sur l’anticipation pratique des activités humaines.
Travail et politique : mêmes dramatiques subjectives, même résistance à la conceptualisation.
Il nous faut bien pourtant les nommer, mais en ayant conscience que ce nom à quelque chose de particulier, d’instituant et de mutilant à la fois, quelque chose qui rend compte du réel et, en même temps, le prescrit. Les débat actuels sur la fin du travail, voire plus anciens comme celui sur le déplacement du centre de gravité de la conflictualité sociale du travail à la ville, ne rendent compte que du regard institutionnel sur le travail, celui de l’emploi, le plus souvent rémunéré.
Or l’emploi ne reconnaît jamais totalement le travail.
Les savants le savent déjà depuis quelque temps, qui distinguent ce qui relève de la description prescrite des tâches et ce qui relève de l’activité réellement en œuvre et qui toujours le déborde. Ceux qui travaillent le savent sans doute depuis beaucoup plus longtemps. Et l’identification de ce débordement est une question cruciale, toujours ouverte, toujours profondément politique…
Les débats contemporains sur la fin du travail ne rendent peut-être compte que de cela : l’écart entre le travail reconnu par l’emploi et l’activité industrieuse et créatrice réellement à l’œuvre n’a peut-être jamais été aussi grand. Mais cet écart n’a d’égal que notre difficulté à le nommer.
Le lexique contemporain du travail est celui de l’emploi, de l’employeur et de l’institution. C’est d’abord ce point de vue que portent les politiques d’insertion, qui sont, lorsqu’elles ne sont pas subverties localement dans leur mise en œuvre, des processus de déni de compétence et de subvention à la précarisation. Le travail, du point de vue de ceux qui travaillent, se cherche un nom qui rende compte à la fois de la place assignée, de la place réellement occupée et de la place revendiquée. Le lexique de la classe et singulièrement de classe ouvrière a tenu ce triple registre. Elle ne le tient plus. Quelque chose se cherche sans doute du côté de la professionnalité, mais l’inventaire reste à faire.
Deux choses aujourd’hui me semblent néanmoins acquises : c’est au cœur de ce travail si difficile à nommer que se déploie parfois la figure contemporaine de cette posture normative et prescriptive que je nomme posture militante.
D’autre part, c’est sans doute de cette posture militante là que s’énoncera au travers de mobilisations collectives, le lexique polémique du travail qui s’inscrira en lieu et place de celui de la classe.
Travail et ville
La dite crise du travail, qui se donne d’abord comme une crise de l’emploi, ne serait donc que la crise politique de son institutionnalisation et donc de son identification conceptuelle.
Nous y revoilà donc : la langue naturelle des sciences sociales, chère à Jean Claude Passeron[7] est d’abord structurée comme une langue institutionnelle. Le social se nomme d’abord par les mots de son institutionnalisation. Que cette institutionnalisation vienne à donner des signes d’obsolescence et la rationalité savante se trouve en difficulté, cultivant alors le langage de la crise et la recherche parfois désespérée d’une éventuelle ré-institutionnalisation.
Telle est bien la matrice de la « crise d’interprétation » et du « désordre dans nos têtes » dont parle Georges Balandier[8]
Tel est bien le registre sur lequel se développe depuis près de vingt ans la thématique de la banlieue. D’un côté un Etat en mal d’identifier des objets sociaux au travers de prescriptions claires et générales et entré dans une période durable de bricolage institutionnel. De l’autre une réflexion sociologique substituant au paradigme d’une société comprise comme une composition de groupes sociaux en tension, celui d’une dramatique du désordre et de l’ordre, de l’exclusion et de l’insertion, du multi-ethnique (ou multi-culturel) et de l’intégration, de la violence et de la sécurité.
La ville y est convoquée non plus comme une composition singulière du travail et de la politique comme nous y conviait Max Weber, mais comme une figure d’un ordre public à restaurer. Ce qui rend, soit dit en passant, difficilement pensable la ville telle qu’elle se produit aujourd’hui comme je l’ai montré à partir des politiques publiques sur le territoire de la Plaine-Saint-Denis .
Mon travail sur le passage de la banlieue rouge à la banlieue m’a semblé dans un premier temps dissoudre mon objet politique dans la sociologie urbaine. A y regarder de plus près, il me semble aujourd’hui que c’est bien plutôt la sociologie urbaine qui risque de se prendre dans les filets catégoriels de la crise de l’Etat et de l’institutionnalisation du social.
Prescription et modernité
Tel est bien aussi le défi intellectuel de la modernité. Car si un accord assez large pourrait être trouvé quant à la nécessaire critique de ces prénotions contemporaines que l’activité publique produit avec une grande générosité, autrement dit si un accord peut- être trouvé sur la nécessaire critique de toute une série de catégories et concepts marqués peu ou prou du sceau de l’Etat et d’une rationalité de mise en ordre, l’affaire se corse lorsqu’il s’agit de savoir au nom de quoi et de quel point de vue.
Deux postures possibles viennent immédiatement à l’esprit. La première est celle de la critique idéologique d’un discours d’Etat. Outre qu’elle est peu admissible sur le plan de la rigueur épistémologique qui doit être la notre, elle a toutes les chances de rester campée sur des paradigmes dont la péremption est plus que certaine et de ne pas mettre en position de développer une intellectualité réellement contemporaine du contemporain. L’autre, qui connaît un certain succès, est celle de la critique sociologique de la domination symbolique elle-même. Cette posture ne manque pas d’intérêt et elle n’a plus à prouver sa grande capacité à produire de l’intelligibilité du social.
Je ne peux pourtant la partager et ceci pour deux raisons. La première est que par la force des choses elle réserve au savant le monopole de la vérité. La seconde est qu’à focaliser l’analyse sur les processus de domination elle rend difficile l’identification des deux dimensions polémiques de l’activité humaine que sont, nous l’avons vu, le travail et la politique. On voit bien que ces deux points sont liés car la politique comme le travail projettent la subjectivité dans les possibles et la prescription du possible. La seule façon d’en rendre totalement compte est d’aborder cette subjectivité comme un élément nodal d’intelligibilité du réel, ce que l’entrée par la seule domination ne permet pas de faire jusqu’au bout.
Pourrait-on dire à ce propos, comme François Dubet que « la sociologie classique n’a jamais vraiment accepté les conséquences ultimes d’une conception de la modernité faisant de la vie sociale le seul produit de l’activité humaine »… ? Je trouve en fait que cette remarque, ou plutôt cette conclusion d’un livre consacré à la société contemporaine, doit être poussée plus loin. Car il n’y a pas d’activité sans subjectivité, il n’y a pas d’activité sans production de subjectivité, c’est à dire conjointement de pensée rationnelle, de valeurs et de conception des possibles.
Non seulement il n’y a pas d’actes sans pensée, mais le plus souvent cette pensée est largement en excès sur des actes qu’elle informe et auxquels elle donne un sens. Ce qui nous pose problème à nous sociologues, dans la prise en compte de cette subjectivité, ce n’est pas tant l’écart entre la prénotion et le concept, entre la culture et la science, voire entre l’idéologie et la science. Ce qui nous pose problème c’est l’hétérogénéité entre une pensée savante animée par la quête de l’intelligibilité du réel existant, de l’intelligibilité de ce qui est et une pensée subjective structurée par la quête des possibles, en d’autre terme, l’hétérogénéité entre une posture cognitive et une posture prescriptive.
Cette question est aujourd’hui posée et l’éventail des réponses est largement ouvert, depuis ceux qui déclarent cette hétérogénéité indépassable jusqu’à ceux qui parient sur une traductibilité immédiate des mots des gens en concepts. Ma position est la suivante : autant je pense que l’hétérogénéité de ces rationalités ne peut être annulée, autant je pense indispensable d’organiser leur mise en travail et leur mise en tension.
La situation d’enquête, de ce point de vue n’est pas sans importance et l’interpellation du chercheur par les problématiques professionnelles, politiques ou institutionnelles reste à mon avis la meilleure invite à ce travail sur la modernité.
Ceci est d’autant plus vrai dans les conjonctures de désinstitutionnalisation du type de celle que nous vivons : il me semble que l’analyse de la modernité passe par un effort d’élucidation de la subjectivité des possibles, et donc, d’abord, un travail sur la subjectivité du travail et de la politique.
Car ce qui nous importe alors n’est pas, classiquement, comment la situation objective déterminerait la subjectivité de la situation, mais bien quelle est la subjectivité qui donne à la situation objective sa consistance humaine et sociale, qui nous permet de la nommer et de la penser
On mesurera au passage le chemin parcouru pour l’historien de formation que je suis. On mesurera aussi, que dans une telle démarche, le travail et la politique en subjectivité, d’objet problématiques des sciences sociales qu’ils étaient, deviendraient donc des conditions de celles-ci. Mais n’est-ce pas d’une certaine façon, revenir aux sources de la sociologie quand Durkheim lui-même saluait l’apport du socialisme à l’émergence de cette pensée savante.
La seule différence, peut-être, était que Durkheim se confrontait à des pensées fortes et instituées, facilement identifiables qu’étaient le socialisme, la pensée industrielle usinière et celle de l’Etat Républicain. Ce qui n’est pas tout à fait notre cas.
L’enquête
Comment faire ?
Il n’y a ici d’autre alternative que l’enquête, mais laquelle ? Car la question préalable n’est pas tant de construire les objets d’enquête qui nous permettraient de prolonger un savoir déjà bien établi que d’établir avec rigueur l’ampleur de ce que nous ne savons pas. Et la question suivante n’est pas tant d’investir l’enquête sur des « faits sociaux » déterminés, que de déterminer par l’enquête les objets sociaux que l’on pourra nommer.
Autrement dit, il n’y a pas d’autre alternative que l’enquête sur les catégories elles-mêmes.
On peut, comme David Lepoutre dans son enquête sur les 4000 de la Courneuve[9], investir un terrain en tenant pour acquis qu’il existe des cultures, que la culture des jeunes de la cité est une culture de violence et qu’elle s’articule autour des notions d’honneur et de réputation. Ici le fait social Durkheimien est remplacé par le fait culturel qui détermine de la même façon, a priori, les comportements et les pensées, la cité est d’abord un bâti et des populations, la violence est posée comme un objet clair, l’honneur identifié à la réputation.
Les enquêtes menées au sein de la MST Formation à la connaissance des banlieues nous ont permis d’établir que cité était une catégorie en subjectivité disposant un face à face sans altérité ne s’identifiant ni à un lieu ni à une population, que violence n’était pas une catégorie opératoire pour désigner une multitude de situations dans leur diversité subjective et enfin qu’honneur se distinguait radicalement de réputation.
De la catégorie de culture et du concept sous-jacent de fait culturel, il ne reste à peu près rien au terme de cet examen. La cité émerge alors comme l’espace d’une crise de l’esprit public et de l’Etat au sens large, et l’espace d’une dramatique entre un discours institutionnel et disciplinaire et une prescription alternative qui se cherche.
On pourrait développer de même sur la difficile ré-émergence d’une figure du travail qui s’y déploie en tension autour de deux pôles opposés : celui de l’assignation de travail à argent (voire à logement) et celui de son assignation à « ce qui est utile aux autres ». Mais ni dans un cas ni dans l’autre ne sont convoqués la figue de l’emploi et de l’employeur, ce qui n’est pas le moindre des paradoxes intellectuels dans des lieux d’enquêtes marqués par la prégnance statistique du chômage. Je pourrais multiplier les exemples.
On voit à travers ces quelques cas d’espèce que l’enquête sur les catégories passe par une enquête rigoureuse sur les mots, non pour le prendre comme un signe, comme un symptôme mais comme lui-même porteur d’une pensée toujours à réidentifier. Non pour le définir et séparer le bon grain de l’ivraie et le concept de la prénotion, mais pour en identifier la charge cognitive et prescriptive à la fois.
Car il n’y a pas de langue naturelle unifiée et les mots clefs qui font le lexique d’une époque sont les multiples champ de bataille de la pensée du présent et du possible. Il en est ainsi de politique, de travail, d’ouvrier, de banlieue, de jeunes, de ville, d’immigré, d’école, d’élève, de violence et de bien d’autres encore. Nous n’en connaissons pas, loin s’en faut, la liste exhaustive. Elle est en fait notre programme de travail.
Et ce programme peut-être décliné. Car les mots de l’Etat ne sont pas ceux des gens et des nouvelles mobilisations politiques.
Il est certain que ma rencontre avec Sylvain Lazarus n’a pas été sans influence sur ce choix épistémologique et méthodologique. J’y étais peut-être un petit peu préparé par mon travail sur la pensée du social dans les nouvelles politiques sociales et urbaines territorialisée et par une longue fréquentation des chercheurs avec lesquels j’ai fait mon apprentissage sociologique. Je veux parler ici de l’équipe de Société Française, de la démarche de « communauté scientifique élargie » que nous avons portée ensemble. Une mention particulière doit être faite à Yves Clot, promoteur de la redécouverte des travaux de Lev Vigotsky en France. Ce même Lev Vigotsky qui conclue ainsi son ouvrage majeur, Pensée et langage :
La conscience se reflète dans le mot comme le soleil dans une petite goutte d’eau. Le mot est à la conscience ce qu’est un petit monde à un grand, ce qu’est une cellule vivante à l’organisme, un atome au cosmos. C’est bien un petit monde de conscience. Le mot doué de sens est un microcosme de la conscience humaine.
Que faire de la sociologie ?
La sociologie est née de la confrontation du socialisme et de l’ordre industriel dans le cadre de l’Etat Nation. Peut-elle y survivre ? Vraisemblablement pas en s’arc-boutant sur la recherche désespérée d’une rationalité perdue. Un espace de pensée a pris fin avec le siècle qui articulait l’institutionnalisation, la politique et le travail tant dans la rationalité et la langue de l’Etat que dans la rationalité et la langue de la science ou de la politique. La péremption politique et intellectuelle de la notion de classe comme l’émergence des thématiques de la banlieue en sont les signaux les plus flagrants.
Cette clôture met à l’épreuve à des titres divers la politique, l’Etat et la science..
Nous en sommes tous là..
Chacun est donc face aux responsabilités qui sont les siennes. Celle du sociologue est de contribuer modestement à l’intelligibilité du monde contemporain par ceux qui le vivent, de donner une forme et une légitimité à une pensée du monde et de ses possibles qui est plus à découvrir qu’à inventer. Dans ces conditions, selon les mots de Yves Schwartz[10], l’inconfort intellectuel est bien le lot des chercheurs. Elle est même le signe le plus flagrant de la bonne santé de la recherche.
[1] Kuhn (Thomas S.), La structure des révolutions scientifiques, Flammarion, 1983 (1962).
[2] Dans quelle société vivons-nous ?, Seuil, 1998
[3] page 300
[4] Métamorphoses de la question sociale, Fayard, 1995, page 460
[5] ibidem
[6] Schwartz (Yves), « l’homme, le marché, la cité », in Autrement 174/1997 « c’est quoi le travail », page 111
[7] Le raisonnement sociologique. L’espace non popperien du raisonnement naturel, Nathan, 1991
[8] Le désordre
[9] Lepoutre (David), Cœur de banlieue, Odile Jacob, 1997
[10] « De l’inconfort intellectuel ou : comment penser les activités humaines ? », in La liberté du travail, Cours Salies (Pierre), coord., Syllepse, 1995