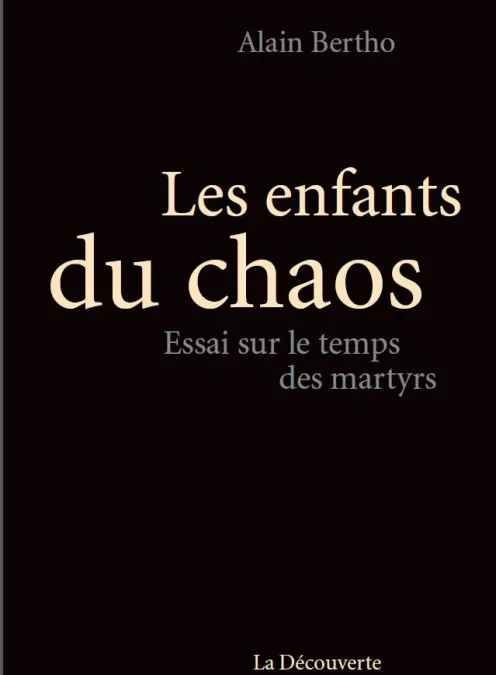BANLIEUES : LA MODERNITÉ CONTRE L’ETAT
Plurimundi 1999
artcle d’Alain Bertho
Les villes ne sont plus ce qu’elles étaient. Cette affirmation banale prend une épaisseur particulière dont il faut mesurer l’importance. Une rupture qualitative a eu lieu dans ce noeud d’activité et de subjectivité qui constitue la ville; Du coup les mots n’ont plus le même sens. A la rupture matérielle doit correspondre une rupture idéelle qui ne vient pas toujours à point nommé. Ce retard de l’intellectualité, en soit guère surprenant, a des effets importants. A regarder la modernité avec les yeux du passé, non seulement on se condamne à ne rien comprendre, mais on peut en plus déterminer des actions publiques au mieux inefficaces, au pire désastreuses.
Un nouveau regard de l’Etat sur la ville a commencé à se constituer en France en 1981, après la victoire électorale de la gauche, mais aussi à la suite de violences urbaines dans la banlieue lyonnaise. Ces violences sont apparues comme incompréhensibles aux yeux des pouvoirs publics. Face à un désordre qualitativement nouveau, il prenait conscience que ses réponses habituelles, nous dirons ses prescriptions, étaient inadaptées. Dans la difficulté à en inventer d’autres du même type que les précédentes, l’Etat s’est engagé dans une longue période de politiques tâtonnantes et expérimentales qui ont fin, en 19988, par prendre le nom de Politique de la Ville. Aujourd’hui, dix sept ans plus tard, face aux tensions et aux violences urbaines, sa perplexité est au moins aussi grande, ses réponses guère avancées.
Pourtant, entre temps, l’Etat a développé à propos de la ville un discours très structuré, largement relayé par une partie de la communauté scientifique et par les médias : l’espace public tout entier a vécu à l’heure du « malaise des banlieues ». Le paradoxe c’est que malgré l’inefficacité flagrante des politiques, le discours dominant ainsi produit est resté dominant alors qu’il est justement lié au maintien d’un regard ancien qui voit les manifestations de la modernité d’abord comme un désordre.
La question de la ville (et de la banlieue, son double démoniaque dans les débats français) est donc un révélateur puissant d’une vraie crise de l’Etat dont les dernières péripéties, la crise de la droite et le poids du Front national, ne sont que la partie émergée. Produire une intelligence moderne de la modernité urbaine passe donc notamment par l’analyse critique du discours institutionnelle et médiatique sur sa réalité à l’oeuvre.
1. Crise de la ville crise de l’Etat
1.1 émergence d’une politique
La nouvelle politique publique est mise en place à partir de trois grands rapports[1] qui la dessinent à grand traits : les quartiers, les jeunes, l’insertion, la sécurité. Tous les trois portent une critique des intervention publique antérieures, qualifiées de « sectorielles », et défendent le principe de la nécessité d’une approche globale des problèmes sociaux par une désectorialisation et une mise en rapport des compétences diverses (élus-professionnels-population).:La Ville a été officiellement une politique depuis qu’une délégation interministérielle à le Ville, mise en place en 1988 a pris la place de la Commission nationale de développement social des quartiers, que le Développement Social des Quartiers est devenu Développement Social Urbain, et qu’un ministère a achevé en 1990 de légitimer aux yeux de la Nation et dans la durée, cette nouvelle ligne de force de l’intervention publique.
Depuis quinze ans, les procédures se succèdent et s’accumulent, les financements progressent, les questions subsistent, la résignation s’installe[2]. Ce constat d’évidence laisse en suspens une question : pourquoi dans ces conditions la politique de la ville se poursuit-elle? pourquoi n’est-elle pas l’objet d’un débat public alternatif? pourquoi les catégories de l’action politiques mobilisent-elles si bien les acteurs comme les chercheurs? La politique de la ville apparaît comme une politique consensuelle sur le plan politique comme sur le plan intellectuel.. Le débat ou le conflit, s’il émerge, porte sur les moyens financiers mis en oeuvre plus que sur les orientations. Le consensus intellectuel est plus étonnant, qui mobilise la pensée et la recherche au plus près des procédures et des interrogations institutionnelles..
L’obscurité (ou simplement l’obsolescence) de l’objet de politique publique dénommé Ville, loin d’ouvrir un réel débat public, le ferme. Déficit de prescription étatique et consensus vont de pair. IL reste que lorsque, dans ces procédures publiques, la ville est mobilisée, elle l’est comme une figure d’un ordre à restaurer en lieu et place d’un désordre « banlieusard ». La ville n’est pas un projet, tout au plus une nostalgie dont la convocation empêche l’élaboration d’un projet positif. La ville émergente comme les dynamiques sociales nouvelles ont toutes les chances de passer inaperçues aux yeux des acteurs socio politiques principaux.
1.2 Les trois saisons : le social, l’économique, le policier
Dans ces conditions, depuis ses origines, la politique de la Ville contourne la définition prospective de son objet au projet de politiques de remise en ordre social. Ces politiques se sont développées en trois temps. La période fondatrice, celle du début et du milieu des années 1980, concentrée au départ sur quelques dizaines de quartiers, était censée être expérimentale, temporaire et localisée. IL n’est pas sûr qu’on ait tiré toutes les leçons des expériences positives qui ont été menées. Mais en généralisant la démarche, on est passé de l’expérimental à une nouvelle figue localisée et stigmatisante des politiques sociales en temps de chômage et de pauvreté. Les dizaines de quartiers concernés sont devenus des centaines, dans lesquels l’exception au droit commun s’est de fait substitué à la démarche expérimentale.
Cette première période, celle du développement social des quartiers a fortement mobilisé l’expérience ancienne de l’animation socioculturelle dans un contexte qui avait changé du tout au tout. Aux jeunes en quête d’un épanouissement et d’une reconnaissance symbolique, sociale et salariale, on a trop souvent proposé des démarches occupationnelles vécues comme dérivatives voire stigmatisantes. Le tour de passe passe n’est pas passé inaperçu aux yeux des principaux intéresses. Les émeutes de 1990-1991 ont rarement eut lieu dans des quartiers oubliés par la « Politique de la Ville ».
Le deuxième temps a été marqué par la montée en puissance dans les débats publics du thème de l’exclusion (et de l’insertion, comme objet de politique publique désignant la réalité vécue douloureusement par un nombre grandissant de gens. L’exclusion devient l’objet central de la « Politique de la Ville » affirme alors le rapport Geindre en 1993. L’accent est mis sur l’insertion économique et sa batterie de mesures successives mises à la disposition des acteurs de terrain. Une mobilisation réelle a eu lieu en terme humain comme en terme financier. Mais le bilan de plusieurs années de politique d’insertion est plus que nuancé et la multiplicité des contrats de travail dérogatoires a aussi fonctionné comme une subvention publique massive à la précarisation de l’emploi et à la création d’un double marché du travail.
On peut craindre que s’ouvre depuis plusieurs mois une troisième période qu’on pourrait qualifier de saison sécuritaire de la « Politique de la Ville ». Elle est dans la logique de stigmatisation des populations et des territoires amorcée par les deux premières. Elle est porteuse d’un grave danger de division voire d’affrontement des populations. Elle risque d’entraîner un engrenage de violence dans lequel l’Etat jouerait de plus en plus le rôle de pompier incendiaire. S’il y a à redonner du sens à la loi, il est nécessaire de ne pas oublier deux choses. La première est que la légitimité fondatrice de la loi est celle de la protection et non de la sanction. Une bonne partie de la jeunesse a perdu ce repère là et se sent démunie face aux agressions de la vie, d’où qu’elles viennent. Ce n’est pas la peur du gendarme qui répondra à ce déficit là. La seconde chose est que la loi n’est qu’un moyen et que notre objectif est la construction et l’avènement d’une société de respect de la personne humaine. C’est aussi la perte de ce projet là qui fait perdre du sens à la loi…
1.3 La ville nouveau lieu de conflit ?
IL n’est pas indifférent de noter que ce nouveau dispositif intellectuel et institutionnel se met en place au moment ou en France on assiste à une sorte d’évanouissement de la figure ouvrière et de la figure du travail, dans une période de recul des conflits sociaux et des forces organisées. La ville se serait-elle substituée à l’entreprise comme lieu central du conflit social ? C’est une question ouvertement posée dans l’espace intellectuel et une thèse largement soutenue[3].
Nous contestons ici cette thèse dans ses implicites mêmes, car elle est fondée sur une distinction fordiste entre la ville et l’entreprise qui appartient au passé. Nous y reviendrons. Mais nous devons nous y attarder pour en examiner la logique interne. En effet, si la sociologique d’Alain Tourainr et de ses disciples, entre autres, a pu chercher dans les mouvements sociaux urbains des années 70, le nouveau paradigme de l’historicité, force est de constater que les violences des années 80-90, n’apparaissent pas de prime abord comme des mobilisation porteuses de nouvelles normes sociales. Autrement dit, en changeant de lieu (de l’entreprise à la ville), la thèse incriminée change de conflit. Le conflit autour du travail mettait en jeu une autre organisation possible de la société. Les violences urbaines sont posées comme mettant en cause l’ordre public. Le premier était producteur de politique. Les secondes appellent une remise en ordre normalisatrice.
2. Le maintien de l’ancien regard et la pensée d’ordre
2.1 Objet local et ville métaphore
En fait, la clôture de l’histoire ouvrière, et la crise de l’Etat mettent aujourd’hui sur la sellette des grilles anciennes de lecture du social. La « fracture sociale » depuis quinze ans a tendu à prendre intellectuellement le pas sur la lutte sociale, l’insertion sur la libération, la participation citoyenne sur l’engagement. Le glissement cognitif, culturel, prescriptif de la « classe » à « l’exil » où à « l’exclusion », de la « lutte » à « l’insertion », des « besoins » à la « prévention », du « bastion » au « ghetto », signale une pensée de la société sans conflit porteur de nouvelle normalité, une substitution de l’Etat à la politique. La politique de la Ville a été un vecteur de promotion de cette nouvelle pensée du social. Cette pensée pratique les métaphores de l’espace dans une sorte de spatialisation des rapports sociaux où les tensions sont toujours lues à travers des problématiques territoriales : ils y a ceux qui ne sont pas du territoire (les immigrés) et les territoires « relégués » qui concentrent les problèmes sociaux (les banlieues)….
Ce qui a fait la force symbolique de cette politique, c’est qu’elle propose des catégories à une situation nouvelle et peu lisible. L’espace urbain y devient à la fois le cadre de référence et la métaphore de la question sociale. Autour d’une représentation spatiale de la question sociale qui fonctionne aussi bien dans l’espace urbain (les quartiers, les banlieues) que dans le symbolique (insertion, marginalisation), s’organise tout un appareillage catégoriel qui fonctionne aussi bien dans le discours savant que dans le discours institutionnel.
2.1.1 Dedans et dehors
Cette spatialisation théorique des problèmes sociaux a été exprimée par Alain Touraine[4] qui affirme le « passage d’une société verticale, que nous avions pris l’habitude d’appeler une société de classe avec des gens en haut et des gens en bas, à une société horizontale où l’important est de savoir si on est au centre ou à la périphérie ». Dans ces conditions, pour lui, « ce qu’on appelle d’un terme symbolique la banlieue, c’est justement cette zone de grande incertitude et de tensions où les gens ne savent pas s’il vont tomber du côté des in ou du côté des out« . Une véritable galaxie catégorielle peut alors être déclinée. Elle l’est notamment dans les quartiers d’exil, par François Dubet et Didier Lapeyronnie[5].
La question de la banlieue est donc moins une question urbaine qu’une question sociale, c’est moins une question concrète qu’une question symbolique. La métaphore de l’exclusion et de l’inclusion, par exemple, s’applique d’abord à la banlieue et à la ville. La catégorie de banlieue[6] apparaît la première et reste jusqu’à aujourd’hui le terme le plus largement utilisé dans le champ médiatique, malgré les réticences de l’Université[7]. L’usage de la catégorie dans le champ universitaire ne reste vraiment développé que sur le terrain des pratiques professionnelles, où des réflexions de chercheurs et de praticiens continuent de se heurter à la difficile lisibilité du social contemporain : la banlieue dans ce cas n’est plus réductible ni à un territoire ni à un peuplement, elle désigne les limites réelles auxquelles se heurte la politique de la ville[8]. La banlieue est le champ de l’incertitude, le chaudron bouillonnant du désordre et de la peur[9].
Il en va autrement de la Ville, notion légitimée par le vote d’une loi d’orientation et la création d’un ministère. Mais, associée à la politique du même nom, cette catégorie est à usage plus prescriptif que cognitif . Elle renvoie moins à la sociologie urbaine qu’à la ville de l’urbaniste. Elle est moins une réalité à décrire qu’un modèle à restaurer[10], un ordre à reconstruire dans l’ordre spatial, puisque c’est d’abord ainsi que le désordre a été caractérisé.
La ville est le lieu ou ce qui est caractérisé comme « crise du lien social » va être l’objet d’une thérapie d’État: celle de l’appel à « l’implication citoyenne ». L’espace public des architectes est pris pour la figure urbaine de l’espace public selon Habermas[11], on assimile l’ouverture du territoire et l’accès à l’abstraction politique. La ville, modèle et cadre de l’Etat moderne devient le paradis perdu d’une société en crise[12]. Le rapport de la banlieue à la ville se présente comme celui du désordre à l’ordre ou plutôt à la mise en ordre : « la banlieue apparaît comme l’envers de la ville, comme la figure de la crise et des changements induits par ces « politiques » de la ville. »[13]:
2.1.2 Exclusion insertion
C’est en effet le couple exclusion/insertion qui est le point fort du dispositif conceptuel. L’exclusion[14]: est mis en exergue des textes politiques comme des textes savants. Jacques Donzelot et Philippe Estèbe en font la définition même de la politique de la ville, relayés par le rapport Geindre. Le vocabulaire social, médiatique et politique cultive la vocabulaire du manque : les sans emploi, les sans statut, les sans papiers, les fin de droits, les sans domicile fixe. L’exclusion fait, en 1996, l’objet d’une somme à voix multiple dirigée par Serge Paugam[15]. L’ouvrage annonce d’emblée la couleur : si l’exclusion se pose pour la plupart des auteurs comme une prénotion aux contours scientifiquement flou, il n’en reste pas moins que la science y est convoquée par l’Etat dont elle est une des pièces maîtresses du nouveau dispositif social. Par delà la problématique classiste dont la fin est annoncée, la réflexion qui s’engage ici, comme chez le Jacques Donzelot de L’invention du Social ou le Robert Castel des Métamorphoses de la question sociale, renoue avec la problématique du paupérisme du début du XIX° siècle. Autrement dit, en refermant la question ouvrière comme une parenthèse, l’intellectualité qui s’investit là s’inscrit dans la lignée de la recherche de la cohésion sociale, voire de la paix sociale, voire de l’ordre tout court.
L’insertion répond institutionnellement à l’exclusion. Consacrée par la préparation et à la mise en place du Revenu Minimum d’Insertion[16] en 1988, reprise dans les Plans Locaux d’Insertion par l’Économique, sa logique traverse une multitude de politique sociales sectorielles. Cette logique est toujours, peu ou prou celle d’une stigmatisation des victimes, désignées comme désocialisées ou inemployables et qu’il s’agit de remettre dans le rang, de réintégrer à la cohésion sociale dont la responsabilité est rarement réintérrogée. Cette logique est celle d’une normalisation.
2.2 Immigré et intégration
Les années 80 resteront dans l’histoire française comme celles de l’émergence de la « question de l’immigration » dans le débat public. Cette « question de l’immigration » a pris politiquement un visage terrifiant. La thématique de l’immigré a fait un triomphe, que les 15% du Front National en 1995,1997 et 1998 ne mesurent que très partiellement. Elle est partout, dans tous les discours et dans toutes les têtes. Elle nécrose la lecture du social. Elle est nodale en se sens qu’elle est porteuse d’une lecture en terme de statuts sociaux en lieu et place d’une lecture en terme de rapports.
Les immigrés existent-ils ? La question semblera encore plus provocatrice que celle, similaire, posée sur l’exclusion. On m’opposera sans tarder les chiffres, masses de % datées, croisées, corrélées. A ces chiffres on répondra : oui, en France, depuis le siècle dernier, il y a de l’immigration. Mais les ouvriers retraités des foyers ou des quartiers sont-ils des immigrés ? Au bout de combien d’années cesse-t-on d’être immigré pour devenir immigrant ? Et combien d’années encore pour être comme habitants et travailleurs, tout simplement des gens d’ici ? A moins qu’il ne faille plusieurs générations…
La figure contemporaine de l’immigré s’affirme en fait parallèlement à la crise du travail et à l’affaiblissement de la figure ouvrière. Le poids de l’immigration dans le développement de l’industrie taylorisée, singulièrement parmi les OS de la région parisienne est une réalité dès les années 70. Mais les grèves de l’automobile des années 70 sont d’abord qualifiées comme de grèves d’ouvriers spécialisés. Lorsque dans le début des années 80, l’usine automatisée de Citroën à Aulnay, entre dans une grève longue, la figure de la grève ouvrière laisse peu à peu le terrain à celui de la grève immigrée dans l’espace public, voire à celui de la grève « chiite »[17]. Le glissement s’opère au sein même de la classe, voire même de la classe issue de l’immigration. Lorsque l’ancien secrétaire du syndicat CGT d’une entreprise métallurgique à St-Denis, aujourd’hui à la retraite après la fermeture de son établissement, regarde avec nostalgie son quartier en recomposition industrielle, il ne voit plus d’ouvrier : il ne « voit » plus que d’un côté quelques travailleurs du tertiaire et une population « immigrée », qui est pourtant majoritairement composée d’ouvriers.
Le groupe ouvrier, au terme d’années de luttes défaites, privé d’avenir, arc-bouté sur les acquis des décennies antérieures contribue ainsi lui même à l’effacement de sa propre figure en fermant sa porte identitaire aux nouveaux venus. Pendant plusieurs années le Front National a été en tête dans l’électorat populaire et ouvrier .
Un nouvel objet social est apparu : les immigrés, ou « population d’origine étrangère » ou « population étrangère ». Il est parfois lié aux notions « d’ethnicité » et de « communautarisme »[18]. Le taux d’immigration, ou de population étrangère, ou d’origine étrangère devient un indicateur-clef de difficulté sociale, en lieu et place de la catégorisation socio professionnelle. C’est un indicateur clé mis en avant par toutes les évaluations prescrites en amont de la mise en place des procédures de la politique de la Ville. Par des glissement catégoriels parfois peu maîtrisés, on passe ainsi de la nationalité à l’origine nationale, puis de l’origine nationale à la couleur de la peau, nourrissant ainsi des statistiques locales parfois fantasmagoriques et des diagnostiques sociaux imaginaires.
Jusqu’en 1997, rares sont les voix qui remettent en cause l’axiome fondateur de cette dérive selon lequel il existerait un « problème de l’immigration » en France. Le dit « problème de l’immigration » devient ainsi une évidence partagée. Sommés de le définir, la plupart de ses thuriféraires, quand ils se défendent de toute position xénophobe ou raciste, renvoient à « l’évidence » qu’il « ne faut pas se cacher ». Le problème c’est que cette évidence n’en est pas une. Lorsque l’on parle d’immigration on ne sait plus trop s’il est question des étrangers, des étrangers en situation irrégulière, des enfants français d’étrangers ou tout simplement des basanés. Il y a aujourd’hui en France un taux de population étrangère inférieur à 1931, et même à 1982. Les flux migratoires sont dérisoires par rapport à ceux qu’on a connus dans les années 50 ou 60. Les enfants issus de l’immigration n’ont pas des parcours scolaires plus mauvais, à situation sociale égale, que les autres. Même le lien en présence d’immigré et racisme ou vote Front National a été indiscutablement réfuté.
|
IL reste, dans cette affaire, à régler le sort d’une catégorie, celle d’intégration, version immigrée de l’insertion. Si la nationalité et la citoyenneté qui lui est liée, est bien une catégorie juridique, être français consiste à bénéficier de la nationalité française par acquisition ou par naissance. Toute autre considération est en dehors du champ concerné. Si on parle des rapports sociaux et culturels, utiliser la catégorie d’intégration renvoie à une conception de la société comme système de normes intangibles et non comme production collective. S’intégrer devient alors le synonyme de se soumettre aux normes dominantes de vie sociale, singulièrement de la vie privée.. C’est faire un contresens grave sur ce que fut le fameux « modèle français républicain d’intégration » dont il est de bon ton de regretter l’épuisement. Ce « modèle » ne fut pas un simple système de normalisation étatique et économique par voie d’école et de plein emploi. Il est inséparable des processus politiques de production sociale et notamment de la lutte des classes. Une fois encore, c’est la clôture d’une forme historique de polémique sociale et de normativité qui est en cause. |
Derrière les questions de l’immigration, de l’ethnicité et du communautarisme, c’est la question de la pensée de la société par elle même et par l’Etat qui se profile. Le communautarisme est en effet l’expression extrême et institutionnalisée de cette taxinomie statutaire que nous avons révélée. Elle évacue la notion même de rapports sociaux et tend à transformer la lutte sociale en une guerre de tranchée, voire une guerre extérieure. Elle fait de l’Etat l’acteur principal du social et tend à assimiler la dynamique sociale à un désordre. Si l’ethnicité est un nouveau paradigme, c’est celui de la mort combinée de la politique et de la science.
3. L’émergence de la modernité urbaine
Comment lire la modernité autrement que comme la désagrégation d’un monde ? Comment aborder cette modernité autrement que dans une problématique de restauration ? La production savante a longtemps accompagné les réflexions publiques en amont et en aval des procédures mises en place. Elle n’a pas, de ce point de vue, joué le rôle d’éveilleur ou d’éclaireur de la décision; Elle l’a le plus souvent légitimée : comme si la fin de la ville fordiste et la clôture d’une séquence historique liée à l’histoire ouvrière avait déterminé, parallèlement à la crise de l’Etat, une mise en difficulté certaine de la pensée sociologique. L’obsolescence des catégories et des concepts marquent d’abord ceux dont c’est l’aliment intellectuel principal et la nouveauté d’une période ne génère qu’avec difficulté la nouveauté des instruments intellectuels nécessaires à sa pensée. Une nouvelle intellectualité de la ville commence aujourd’hui à émerger.
Penser les processus sociaux urbains nécessite de s’ancrer dans deux démarches complémentaires :
1. Il s’agit d’abord d’aller jusqu’au bout de la prise en compte de la fin e la séquence fordiste et dont de la péremption des catégories qui l’accompagne. Travail, Ville, société ne désignent plus les mêmes réalités. De ce point de vue, la centralité actuelle des questions urbaines ne signifie pas forcément une démonétisation du travail mais plutôt un déplacement des champs de son développement.
2. Il s’agit d’autre part de travailler sur l’intellectualité des situations déjà à l’oeuvre : le point de vue des gens, leur intelligence singulière des situations nous ouvre des nouveaux horizons de pensée sur la modernité
3.1 La ville se crée autour d’une nouvelle figure du travail.
3.1.1 Les apprentissages collectifs
La confrontation des acteurs publics aux réalités de la ville et du travail dans le cadre des procédures d’insertion est un moment important d’apprentissage collectif et d ‘émergence de nouvelles pensées. C’est ce qu’avec une équipe de recherche nous avons été a mené à constater ces dernières années en région parisienne dans le quartier ou a été construit le Stade de France pour la coupe du monde de football 1998.
La Plaine St-Denis est un terrain privilégié d’expérimentation des procédures de la politique publique de l’emploi comme de l’exploration de nouvelles voies d’intervention publique pour la requalification économique du territoire. Un Plan local d’insertion par l’économique (PLIE) a été mis en place depuis 3 ans. La décision d’implantation du Stade de France sur le site du Cornillon et l’ouverture simultanée de plusieurs grand chantiers à la Plaine a créé une conjoncture encore plus favorable dont il convient d’analyser les effets, d’autant que la politique publique d’emploi s’est fortement axée sur l’objectif et les moyens de l’insertion. Le dispositif mis en place autour des chantiers et dans la perspective du développement de l’économie et de l’insertion au niveau local est multiforme, mixte, partenarial et en réseau. Il favorise les synergies et les formes de partenariat entre les différents dispositifs, les organismes municipaux et para-municipaux, les services public.
Les meilleures conditions semblent réunies, mais une contradiction majeure persiste entre la nature de l’offre et de la demande d’insertion. Entre des pouvoirs publics dispensateurs d’aides diverses, ordonnateurs de mieux disant social et en charge d’une population accueillie à diverses permanences et , d’autre part, les besoins des entreprises, la tension est irréductible. Elle est bien sûr lisible en terme quantitatif, dans l’écart entre les besoins des hommes (demandeurs d’emplois) et ceux des entrepreneurs. Tout ce qui peut être fait, en mobilisant de gros moyens publics, est sans commune mesure avec l’attente du public.. Cette contradiction se développe sur le caractère de l’emploi ouvert : ici on cherche un métier stable, là une main-d’oeuvre mobile et flexible. Dans ce quiproquo, l’aide publique peut alimenter une forme subventionnée d’interim pour les travaux à basse qualification.
C’est pour dépasser cette équation perverse que se développe des réflexions et des projets dont la logique serait de passer de la logique individualisante de la formation/insertion à une logique territoriale de développement..
La réflexion publique locale se propose d’inverser la démarche d’insertion. Puisque les gens perdent leur qualification en sortant de l’entreprise, mais que d’autre part, l’emploi diminue, il ne s’agit pas de polariser l’activité publique sur la requalification des personnes pour des emplois existants en raréfaction mais de piloter l’emploi par l’amont, par une requalification collective du territoire. Cette réflexion s’investit dans des projets finalisés. Un projet plus globalisant prend forme avec l’idée de Maison de l’initiative économique locale, dont la finalité serait l’aide à l’élaboration de projet, au montage au lancement et à la gestion des petites entreprises locales.
La réflexion sur l’aide publique qui pourrait être apportée aux entreprises part du constat de la contradiction entre la situation actuelle des entreprises qui pourraient aider au développement de l’emploi (ce sont des PME-PMI) et les contraintes auxquelles elles ont à faire face qui les brident dans l’embauche : concurrence accrue au niveau international, taille parfois incompressible des marchés, manque de prévisibilité des compétences à mobiliser qui entrave les tentatives de formation en amont de la main-d’oeuvre. Il en ressort que l’effort devrait être porté sur l’information stratégique autant que sur une information technologique finalisée. Il y a là une responsabilité potentielle de la puissance publique. Il semble donc nécessaire d’impulser les pôles de savoir stratégiques et de coopération qui pourraient constituer la culture locale du territoire : des PME-PMI prenant l’habitude de se regrouper pour prendre les lots, des alliances durables entre grosses et petites entreprises, avec des réseaux techniques et gestionnaires, informer en amont des marchés et des besoins, identifier un lieu source d’information, pour rendre les PMI-PME capables d’anticiper sur la mobilisation des moyens par exemple en matière de main d’oeuvre et de qualification. La notion de territoire apprenant pourrait alors s’élargir aux dynamiques entrepreneuriales. On a là un champ d’expérimentation de logiques d’acteurs dont les conclusions les plus importantes ont une portée beaucoup plus large.
3.1.2 Les espaces intermédiaires et les interstices:
Des recherches récentes[19] montrent en effet que les « espaces intermédiaires urbains » peuvent être des lieux d’émergence de nouvelles figures du travail dans des milieux de jeunes précaires [20]. Il faut pour les découvrir pister l’enchevêtrement des diverses économies urbaines dans une société salariale qui s’effrite. Ce sont dans les espaces intermédiaires qu’apparaissent des lieux de petite production urbaine, le plus souvent dans un cadre associatif, parfois avec l’appui des collectivités locales et dans l’espace du travail immatériel. C’est là que se mobilisent des jeunes en situation précaires qui y développent une diversité de compétences. Ces compétences, lorsqu’elles se développent sont d’abord collectives mais peuvent parfaitement , par la suite, déterminer des trajectoires individuelles . Ces compétences sont en écart plus ou moins importants avec les logiques institutionnelles et marchandes : elles intègrent une culture du don, une culture de l’aléatoire. Ce faisant, ces foyers d’activités produisent aussi de la ville moderne dans des lieux stigmatisés comme marginaux.
Les interstices apparaissent dans le processus de transformation de l’économie et de la société urbaine. Ils accueillent momentanément et localement ce que la ville ne sait pas accueillir ou intégrer dans son propre mouvement. Ils bouleversent ainsi les rapports de travail et le rapport salarial de type fordiste. Sur le bas Montreuil par exemple vivent es intermittents du spectacle mais aussi de jeunes entrepreneurs qui sont tantôt patrons, tantôt ouvriers en sous traitance. Leur lieu de vie est aussi lieu de travail et les relations sont indistinctement relations de travail et relations amicales modifiant ainsi leur rapport au territoire et à la ville. Le rapport entre emploi et travail est ainsi flou, car dans les interstices ces notions sont parfois peu distinctes. IL s’agit très souvent de relations contractuelles peu formelles, sans dimension collective.
La crise de la ville fordiste se pose d’abord comme une crise de l’Etat et une remise en cause de la figure historique de l’espace public. Telle n’est pas la moindre raison de sa perception comme un désordre à réduire. Telle n’est pas, non plus, la moindre des raisons qui font que les discours récurrents et significatifs sur le retour nécessaire de l’Etat ne soient finalement porteurs que d’un discours sur le retour de la police. Mais à vouloir désespérément rafistoler l’édifice qui s’écroule, on reste myope sur la modernité émergente et les exigences nouvelles d’État qui en découlent…
3.1.3 Le travail immatériel et la ville émergente
Si la crise de la ville et de la pensée de la ville, comme crise de l’Etat, a pour matrice l’émergence, impensée ou mal pensée d’une nouvelle figure du travail, alors c’est du côté du travail qu’il faut porter notre regard pour retisser les fils d’une pensée de la modernité urbaine. Et c’est du côté des formes les plus récentes et les plus impalpables de l’organisation de la chaîne productive qu’il faut se tourner. Les travaux sur le travail immatériel et sur le bassin de travail immatériel offrent un champ de réflexion tout a fait passionnant de ce point de vue. Ils intègrent de fait la notion d’espaces intermédiaires dans une vision plus générale de la recomposition du capital et du travail[21]. La ville, comme espace de subjectivité, de coopération et de création devient alors le véritable espace du travail en lieu et place de l’usine et de la grande entreprise. Les frontières entre espace public et espace privé, entre lieu de production et lieu de vie sont remises et cause. Le capital n’apparaît alors que comme un parasite financier venant ponctionner la créativité humaine de l’espace urbain, venant prendre sa part d’une sorte de plus-value sociale globale. Le nouveau paradigme, que nous avions critiqué plus haut,; selon lequel le lieu central du conflit serait passé de l’entreprise à la ville prend alors un autre sens, car il se comprend alors comme un déplacement du lieu de conflit sur le travail et non comme l’effacement du travail dans le conflit. On comprend alors le caractère de plus en plus territorial et urbain des nouvelles luttes sociales françaises. La ville émergente, dans ces conditions, n’a plus rien a voir avec la ville fordiste et la volonté politique de l’Etat de reconstruire la ville sur des normes en péremption n’apparaît plus que pour ce qu’elle est : une démarche disciplinaire et policière.
3.2 Une réalité qui ne se caractérise pas seulement par l’écart à la norme.
Dans ce contexte, y a-t-il une pensée moderne de la ville par ceux qui la font ? Et y a-t-il une pensée de la crise de la ville et de l’Etat qui a pour nom banlieue, pour ceux qui y souffrent ? C’est à ces questions que s’attelle l’équipe de la Maîtrise de Sciences et Techniques Formation à la connaissance des banlieues de l’Université de Paris 8 à laquelle je collabore. Les enquêtes menées depuis trois ans sur la pensée de la banlieue par les gens de banlieue nous incite à répondre par l’affirmative. Ces enquêtes originales visent à saisir et analyser la pensée des gens dans leurs catégories singulières, leurs énoncés thétiques et leur visions du possible[22].
L’unité de pensée pertinente pour penser la crise n’est ni la ville ni la banlieue mais la CITE comme catégorie de pensée plus que comme unité urbaine. Néanmoins, si la cité se présente comme hors de l’espace public urbain, la question est moins d’en faire sortir les habitants ou d’y faire entrer la police, que de l’urbaniser au sens plein du terme. DE ce point de vue, la question clef est moins une question d’urbanisme ou de ségrégation sociale que de la force d’une absence : celle de la figure du travail, matrice d’une polyfonctionnalité des lieux, donc de l’urbanité, donc de l’espace public.
La cité comme espace intellectuel de la crise ne se pose donc pas par son écart à la norme : la question n’est pas celle du désordre, de la ghéttoisation ou d’un urbanisme mal tissé. C’est un espace intellectuel particulier. Disons que c’est le nom donné à une crise de l’Etat générée par une crise de la figure du travail. La boucle est bouclée.
4. L’insécurité, nouvelle question politique
L’impensé de la nouvelle figure du travail et de l’exploitation est la matrice d’une crise de l’Etat dont la banlieue est le lieu et le nom. Cette crise de l’Etat prend une allure paroxystique lorsqu’elle touche à l’incapacité de cet État a assurer la première nécessité de son existence c’est à dire l’ordre public. Plus ses difficultés sont patentes, plus ses réponses sont sécuritaires et plus elles ouvrent à une confrontation violente avec la population et singulièrement les jeunes. C’est dans ce contexte, et dans ce contexte seulement que l’on peut comprendre pourquoi et comment la violence et l’insécurité risque d’être la grande affaire politique de la décennie qui vient.
Le thème récurrent du malaise des banlieues, apparu au début des années 80 a marqué la fin d’une certaine analyse critique de la société en terme de classes sociales. Jusqu’aux mobilisations de ces dernières années, une bonne vieille culture du conflit social a été submergée par une approche des problèmes en terme de désordre social à réduire. A chaque désordre sa remise en ordre : quartiers en difficultés et « équilibre social », délinquance et prévention ou répression, une certain conception de l’exclusion et de l’insertion, immigration et intégration. Comme si à chaque fois, l’Etat, quelque soit le gouvernement trouvait un responsable idéal dans les victimes elles mêmes. Ce seraient les élèves qui sont en difficulté, pas l’école. Ce sont les chômeurs qu’il faut insérer (en baissant les salaires et en déréglementant) pas l’économie qu’il faut transformer, ce sont les jeunes qui seraient les fauteurs de troubles et non les premières victimes de toutes les violences. C’est la composition sociale d’un quartier qui serait à l’origine de la mal vie…
Tout un discours sur la crise sociale et la rupture du lien social fonctionne un peu comme une mise en accusation des gens eux mêmes pour les dégâts créés par la course au profit et les difficultés des pouvoirs publics. Il y a là une logique globale de recherche de bouc émissaire. Il n’est pas étonnant dans ces conditions, que la figure de l’immigré ait, en France, cristallisé sur elle cette démarche implicite. On découvre seulement maintenant que dire que l’immigration est un problème, c’est glisser sur une pente où ce sont les gens qui sont mis en accusation pour les malheurs qu’ils subissent. En ce sens, la nouvelle pensée du social dominante, quelles que soient parfois ses bonnes intentions, fait le lit du Front National
Avec l’émergence de la violence comme question politique, on touche au coeur de ces enjeux fondamentaux. Car il s’agit ni plus ni moins de la capacité de l’Etat démocratique à assurer la tranquillité des gens. Et sur cette question, la tendance à désigner des boucs émissaires pour assurer l’ordre est bien plus forte qu’ailleurs. L’alternative est alors simple. Soit l’émergence sécuritaire d’un état policier qui répondrait à la violence par une autre violence sans autant la résoudre, détruisant le pacte de confiance démocratique qui lie les citoyens, quels qu’ils soient, et les institutions. Soit une reconstruction de l’espace public et de l’Etat démocratique à partir de la nouvelle figure du travail, des coopérations et de la ville, par la mobilisation des gens eux-mêmes pour leurs droits.
[1] Tandis que la commission Schwartz a reçu une mission sur l’insertion des jeunes dans la vie professionnelle, la Commission Nationale de développement Social des quartiers, présidée par le maire de Grenoble, Hubert Dubedout, est mise en place en décembre et la Commission dite « des Maires », future Commission nationale de prévention de la délinquance, présidée par Gilbert Bonnemaison, est créée en mai 1982. Les rapports de ces commissions sont à l’origine de ce qu’on appelle à partir de la fin des années 80, la politique de la Ville[1]. Mais le rapport « Ensemble refaire la ville » vise essentiellement les quartiers populaires d’habitat social.
[2]. Philippe Estèbe , « Les états d’âme d’un chef de projet », Face à l’exclusion la modèle français, sous la direction de Jacques Donzelot, Paris, Ed.Esprit, 1991.
[3] Dubet (F.) « Les figures de la ville et de la banlieue » , Sociologuie du travail,XXXVII 2/95
[4]. Ce texte fait référence et « Face à l’exclusion » a été publié deux fois en quelques mois dans des lieux éditoriaux voisins : dans le n° d’Esprit consacré à la France des banlieues, dans le coll dirigé par dans le coll. Citoyenneté et Urbanité, éditions Esprit,1991.
[5]. François Dubet, Didier Lapeyronnie, Les quartiers d’exil, Paris, le Seuil 1992.
[6]. Un ouvrage dans le même champ que celui de M.Pinson mais sur un registre un peu plus journalistique, paru en 1986 a pour titre Banlieue de Banlieue (Raymond Passant, Paris Ramsay, 1986)
[7] Citée trois fois et indexée dans Sortie de siècle, la France en mutation, dirigé par Jean Pierre Durand et François Xavier Merrien, Paris, Vigot, 1991, elle est ignorée par Sociologie contemporaine, Dir. par Jean Pierre Durand et Robert Weil, Paris, Vigot, 1989. Ce n’est qu’avec réticence que la banlieue prend place dans le colloque international PIR-Ville-Université de Paris 8 en janvier 1994 (Banlieue, Ville, Lien social)
[8]. Création en 1993 du Centre de Ressource »profession Banlieue » par la SCET , reprenant le titre du colloque de l’Université de Paris 8 de 1992, organisé par Jean Luc Roger et Alain Bertho ; « Travailler en banlieue : un nouveau métier? », Migrant Formation.N°93, Juin 1993 ; Bernard Charlot, Elisabeth Bautier, Jean Yves Rochex, Ecole et savoir dans les banlieues.. et ailleurs, Paris, Colin, 1992.
[9] Rey (Henri), La peur des banlieues, Presses de Sciences Po, Paris 1996
[10] Comme le suggère très bien le titre d’un ouvrage collectif paru en juin 1996 sous la direction de C. Blanc-Coquart, C. Heudron et R. Le Gad, A la recherche de la ville perdue (L’Harmattan)
[11]. Habermas (.), L’espace public, archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise, Paris, Payot, 1978 (1973).
[12] La première série des « entretiens pour la ville » organisés par la DIV en 1991 et publiés par la revue Esprit sous le titre Citoyenneté et Urbanité est significative à cet égard
[13]. Dubet (F), « Les figures de la ville et la banlieue », Sociologie du travail, XXXVII,2/95.
[14]. Thème lancé en 1974 par René Lenoir, secrétaire d’État à l’Action Sociale de 1974 à 1978 (Les exclus, Paris , le Seuil) et repris par lui dans Français, qui êtes vous ? dir . Jean Daniel Reynaud et Yves Grafmeyer , Documentation française, 1981 : « Inadaptation et exclusions sociales ».
[15] L’exclusion l’état des savoirs, La découverte, 1996, avec la collaboration notamment de Robert Castel, Jacques Donzelot, Claude Dubar, François Dubet, Olivier Galland, Catherine Grémion, François Xavier Merrien et Michel Wieviorka.
[16]. Serge Milano , La pauvreté absolue, Paris, Hachette, 1988
[17] Je renvoie ici aux analyses de Sylvain Lazarus sur la figure ouvrière, notamment lors des séminaires de St-Denis , « banlieues : lieus, situations, politiques
[18]. En couverture du N° d’Esprit de février 1991 (op. cit.), on lit « Entre ethnicité et intégration » pour signaler les articles « Ethnicité, bandes et communautarisme » (Olivier Roy), « pour une intégration communautaire » (Philippe Genestier), « immigration et minorités ethniques au Royaume uni » (John Crowley). Dans Ville exclusion et citoyenneté (op.cit.), on peut lire « les immigrés dans la ville, peut-on parler de tension ethniques » (Olivier Roy). Dans « quelques réflexion sur l’évolution électorale d’un département de la banlieue parisienne » (Hérodote n°43) Henri Rey et Jacques Roy mettent en rapport montée du Front national et % de population étrangère dans les communes. Didier Lapeyronnie et François Dubet (Les quartiers d’exil, op. cit.) consacrent une partie à « immigrés et minorités » et une autre aux « jeunes immigrés » ; le N° de Panoramique (op.cit.) consacré à la banlieue développe largement ces thèmes….
S. Hessel, Immigration, le devoir d’insertion, rapport du Commissariat général au Plan, Paris, La documentation française, 1988, 2 vol. ; Pierre Weil, La France et ses étrangers, Paris, Calmann-Lévy, 1991 ; Claude Bouchoux, « L’immigration ou la révélation d’un enjeu », Politix n°12 1990 ; A. Hochet , « L’immigration dans le débat politique français de 1981 à 1988 », Pouvoirs, 47, 1988 ; A. Lyon-Cahen , « Étranger, immigré, immigrant, question de définition », Revue Française de Droit sanitaire et Social, N°2, Avril 1987 ; Territoires, « Les étrangers dans la ville », hors série n°2, oct. 1990
[19] Roulleau-Berger (L.), Les mondes de la petite production urbaine, LEST-CNRS, juillet 1997
Hatzfeld H.et M.), Ringard (N.) , Ville et emploi -interstices urbains et nouvelles formes d’emploi, jui n1997
[20] Roulleau-Berger (L.), op.cit
[21] Corsani (A.), Negri (T.), Lazzarato (M.), Le bassin de travail immatériel en région parisienne, l’Harmattan, 1996
[22] Lazarus (S.), Anthopologie du nom, PUF, 1996