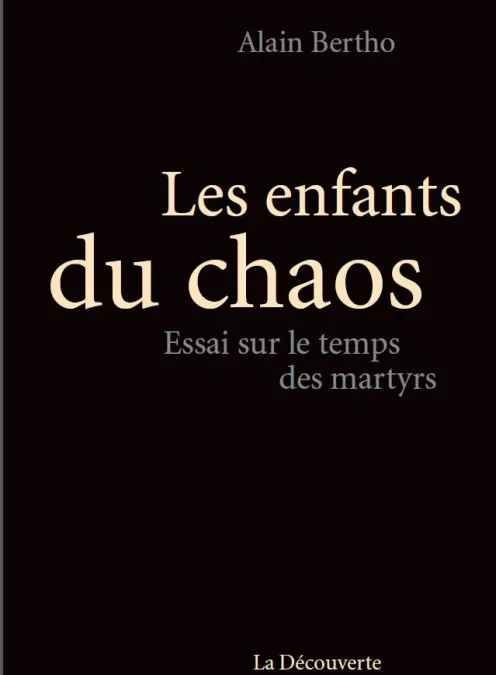La politique entre le travail et l’Etat

Alain Bertho, in Le travail à l’épreuve du salariat 1997
En dix ans, la problématique de la crise de la politique est passée du statut d’hypothèse contestée à celle d’évidence partagée. Mais il y a des évidences piégées et des consensus plus obscurs que des polémiques. Tous s’accordent sur les « symptômes : recul des activités militantes, désaffection électorale, notamment dans les milieux populaires, baisse d’influence des organisations les plus anciennes au profit, sporadique ou durable, de courants politiques plus récents et se situant en contestation des termes du débat public. La mise en valeur et la mise en rapport de ces indicateurs, tous enracinés dans l’espace public, en oriente l’interprétation. Car, à s’en tenir là, la crise de la politique ainsi décrite s’enferme dans un champ qui ne permet pas d’en percevoir la dynamique et l’issue.
Ce champ est celui de l’institution, de la politique perçue comme un système, et donc, peu ou prou, comme un ordre. Il s’agirait alors d’une part de transformer les données de « l’offre politique » (question d’image, de langage ou de pédagogie…) et d’autre part de travailler sur ce fameux « lien social » dont la crise ferait obstacle à la « participation politique ». Depuis une quinzaine d’année, l’Etat développe sur ce terrain des réponses d’une grande cohérence dans le cadre de ce qu’on appelle généralement la politique de la ville et dont les grands principes fondateurs sont souvent mis en oeuvre par les collectivités locales : promouvoir localement des espaces de « citoyenneté active » ou de « démocratie participative » censés, dans même mouvement, répondre à la crise de la politique et à la crise du lien social. On peut s’interroger sur leur efficacité…On peut aussi s’interroger sur la confusion culturelle et institutionnelle dont elles sont porteuses et qui peut même être un facteur de crise[2].
l’Etat et la politique
La première confusion est celle de l’Etat et de la politique, de la citoyenneté et de l’activité politique. Il faut être clair sur les termes qu’on emploie, les catégories que l’on mobilise pour désigner les processus sociaux. l’Etat est d’abord prescripteur et normalisateur: il est porteur et garant des normes reconnues socialement à un moment donné et inscrites dans le droit. Il définit les limites et les règles de l’espace public. La citoyenneté relève de ces règles, elle relève donc d’abord de l’ordre du droit. Il n’y a pas de citoyenneté active ou passive, il y a des droits établis ou refusés, respectés ou déniés.
La politique est autre chose. Elle est de l’ordre de l’activité : activité d’élaboration de normes nouvelles, de mobilisation autour de ces normes et des valeurs qui les portent, de rassemblement d’énergies et de subjectivités pour les faire triompher. La politique est donc d’abord une activité polémique et normative. Elle suppose qu’un débat soit ouvert sur l’ordre social existant dont l’Etat est le symbole et le garant, elle peut contribuer à l’ouvrir. Elle a vocation à irriguer l’espace public mais il lui arrive, dans les moments les plus forts de contestation de l’ordre social, de le déborder pour mieux le redéfinir. Ce fut le cas du mouvement républicain au début du XIX° siècle et du mouvement ouvrier plus tard. Car la politique est aussi une réalité historique discontinue : elle a ses hautes et ses basses eaux.
Cette distinction de l’Etat et de la politique, dont on voit par ailleurs les liens indéfectibles de dépendance et de tension réciproques, est salutaire. Trop d’État tue la politique. Trop de politique renverse l’Etat. La citoyenneté sans politique est une coquille vide. La politique sans citoyenneté, c’est la guerre civile.
Cette indistinction est portée depuis quinze ans par ce qu’on désigne aujourd’hui comme « politique de la ville » et qui amène, par exemple, sous couvert de « renouer le lien social », à envoyer en mission des travailleurs sociaux en lieu et place des militants défaillants. Or s’il y a pu y avoir dans l’histoire des militants professionnels, on ne remplace pas des militants par des professionnels appointés par l’Etat ou sa périphérie. On ne remplace pas une activité polémique par une activité consensuelle, ni une activité volontaire et normative par une activité prescrite. l’Etat ne remplace pas la politique sans dommage. Quand le conflit naissant est lu comme un désordre à réduire, la mobilisation n’a pas lieu, la dissidence prend la figure de la violence et le soucis de l’ordre se termine toujours par l’intervention d’un uniforme[3]. Telle est l’aporie récurrente de la politique de la ville et de toutes les tentatives de « démocratie participative ». Telle est aussi l’impasse dans laquelle on enferme les professionnels du social.
Normes et classes
S’il y a désordre social, certains diraient anomie, ou crise du sens, l’accès à la norme ne peut prendre le chemin de la prescription d’État. Dans la mise à l’épreuve contemporaine de l’ordre et de ses représentations, il convient de se rappeler que le désordre est historiquement premier et que l’ordre se construit et s’accepte dans la polémique[4]. Alors que la plupart des discours et des analyses qui s’élaborent depuis 20 ans sur la fin des classes, dressent le tableau d’une pacification socio-politique, d’une fin des « passions françaises », voire d’une désidéologisation du pays, il semble au contraire que le brouillage symbolique des conflits soit un facteur majeur de crise de l’ordre social et de ses représentations. Comme si la fin de la guerre de classes annonçait moins la paix universelle qu’une guérilla sociale incontrôlée.
L’histoire de la classe ouvrière française est l’histoire d’une intégration à la nation, d’un accès à la normalité. Mais cet accès n’a pas été une allégeance. Cette normativité collective et conquérante n’a pas été le fruit d’une quelconque normalisation[5]. Elle alimente une culture, construit des solidarité de compagnonnage plus que de partage.
Le mouvement ouvrier a promu le développement, non pas de l’accès des classes populaires à un style et un niveau de vie « normalisé », mais bien à une normativité individuelle et collective (du « décent » à « l’humain » et au « digne »). Le mouvement ouvrier a été ainsi porteur à la fois d’individuation ouvrière[6] et de normes juridiques, économiques, voire techniques, nouvelles: la banlieue rouge fut ainsi le « banc d’essai de la modernité »[7]. Il a été politique au sens plein du terme. Son identification sociale portait en elle-même sa négation.
Cette histoire, dira-t-on n’est que celle du communisme français, d’une séquence historique où les rapports de la politique et du travail ont pris une figure singulière : celle de l’inscription de la lutte des classes dans une culture nationale. L’affaire semble entendue sur le fait que cette séquence est close avec la lutte des classes, que la séquence contemporaine aurait vu se déplacer la contradiction principale de l’usine à la ville, que le travail n’aurait plus la centralité sociale qu’on lui a connu[8]. Cet argument fait masse. Il s’impose du poids de plusieurs millions de chômeurs, d’une violence urbaine incontrôlée, de nombre de voix autorisées du. monde sociologique ou politique.
Il mérite néanmoins une contestation radicale.
On pourra d’abord noter que la crise du communisme et d’une figure historique de la lutte des classes s’est moins accompagnée de la recomposition de l’espace public que de sa désagrégation.
On notera ensuite que les tensions urbaines, vulgairement nommées « malaise des banlieues » ont plus été porteuses d’un nouveau développement, particulièrement consensuel de l’activité de l’Etat que d’une polémique politique nouvelle. C’est la dialectique du désordre et de l’Etat qui domine, celle du conflit et des normes qui recule.
Bref, l’effacement de la figure ouvrière et le recul communiste ont bien été le signal d’une crise généralisée. La force de ce constat, qui plaide en faveur d’un nouveau paradigme politique du travail et de la lutte des classes, au bénéfice de tous, est pourtant passé inaperçu aux yeux des premiers intéressés dans le champ politique lui même : les communistes.
Mais le dernier argument est sans doute le plus fondamental : il existe un lien fondateur entre la politique et l’activité de travail.
La politique au coeur de l’activité industrieuse ?
Car il existe bien, un lien, anthropologique, entre la politique et l’activité industrieuse, un lien qui va bien au delà d’une conjoncture nationale et historique qui a fait du conflit de classes une matrice majeure des débats politiques. Le travail, et singulièrement dans la forme sociale d’emploi salarié, est une expérience sans égale de confrontation à un ordre, à une prescription, à des normes établies, d’une activité qui, fût-ce marginalement, perturbe cet ordre, ébranle la prescription et les normes, en appelle d’autres.
Cet écart entre le réel et le prescrit, entre la capacité éprouvée des hommes et l’ordre social, cette épreuve subjective fondamentale, est au principe de la normativité sociale des hommes et, donc, de la mobilisation politique. Reste au militant la tâche d’allumer cette expérience ouvrière suivant la belle expression de Michel Verret, de transformer le mobile en finalités sociales collectives. Dans les conditions propres à chaque temps et à chaque lieu. Car ce terreau politique peut rester en friche, s’il ne se développe pas une culture qui le légitime, lui donne un sens, généralise ses projets.
Prenons garde à toutes les implications de cette piste de réflexion qui met en parallèle notre analyse de la politique et l’analyse du travail et des activités humaines telle qu’elle est menée depuis de nombreuses années par de nombreux chercheurs[9]. Elle s’inscrit en faux contre l’interprétation de la crise de la politique comme simple produit de ce que d’aucuns nomment la « fracture sociale », une interprétation qui fait de la désocialisation par le chômage l’origine principale d’une « désocialisation politique », bref de certains effets de la crise de l’emploi, la matrice de la crise de la politique.. C’est la remise en jeu générale des activités et de l’usage de la force de travail dans la société qui est ici en cause. Cette piste est extrêmement fructueuse pour lire la crise non seulement dans le groupe ouvrier, mais au-delà dans l’ensemble des activités sociales aujourd’hui sujettes à une recomposition qui ne se résume pas à la crise de l’emploi mais qui en est la cause.
Certes, le lien entre chômage et retrait de l’espace public par abstention voire non inscription sur les listes électorales est réel. Mais il ne résume pas à lui seul la totalité de la crise que connaissent aujourd’hui les activités politiques dans ce qui fait leur fonction ‘d’allumage militant » : la capacité d’élaboration de finalités sociales, de mobilisation des normativités, de rassemblement des expériences dans un projet commun. C’est au centre du dispositif qu’il faut aller voir la crise, dans les doutes, les replis, les difficultés des militants les plus éprouvés
Ce qui subsiste de la culture ouvrière et de la culture communiste, par exemple, se trouve mise en porte à faux par les enjeux nouveaux de contenu et de forme des activités de travail. En défaut de porter sur le neuf, un regard à la fois polémique et dynamique, la politique « exécutive » selon une autre expression de Michel Verret, peut alors tendre à la référence identitaire spectatrice des mutations de son temps. La souffrance qui en découle peut même en accentuer les tendances au repli orthodoxe. Cette disjonction de la culture et de la normativité sociale est à la base d’un notable affaiblissement de l’activité des organisations Elle peut atteindre son point de rupture par un basculement brutal, sorte de « retour du refoulé » qui touche d’abord la périphérie militante et vieillissante, dont une des manifestations est l’émergence du repoussoir étranger, de cette figure de l’immigré qui se retrouve au centre du dispositif de catégorisation sociale dominant aujourd’hui..
Cette remise en jeu générale de la valeur d’usage de la force de travail, met la subjectivité et l’identité en première ligne de la polémique avec l’ordre social, avec pour seul bagage des cultures politiques construites dans d’autres conjonctures productives et donc largement démonétisées. Il est dans ces conditions logique que la crise du communisme soit au coeur de la tourmente.
Ceci est essentiel, si on veut bien considérer que le mystère social de la politique réside justement dans le rapport qui s’établit, ou non, entre les finalités sociales des activités proposées et les mobiles des sujets. De la plus ou moins grande richesse de cette dialectique dépend au final, l’état réel de l’espace public et de la politique dans la société. Cette dialectique prend corps dans des cultures qu’elle transforme en retour, si ces dernières ont su se rendre opératoires.
Mais si la contradiction entre l’expérience individuelle et l’ordre existant n’est pas, pour « x » raisons, porteuse de normativité, il peut y avoir affrontement, violence, il y aura souffrance individuelle, mais il n’y aura pas conflit, il n’y aura pas de politique. Et c’est ce travail de l’existant et du possible, ce travail constant des conflits et de la politique qui est producteur d’État, de règles, de normes et d’activités nouvelles pour les faire connaître, les imposer, les gérer. Car, « il n’y a pas de pouvoir à prendre s’il n’y a pas d’avenir à conquérir »[10].
Crise de la politique et crise du communisme
C’est parfois du côté de l’Etat et de sa composante municipale locale que semblent se focaliser aujourd’hui les ferments potentiels d’une dynamique politique, mais au prix d’un véritable renversement du paradigme du communisme municipal. La municipalité communiste s’est pensée durant des décennies comme la représentante légitimée de la classe face au capital local, une représentante dont les actes et les réalisations pouvaient avoir autant d’effet symboliques que pratiques, dans le cadre d’un combat national, voire universel.
Or la population ouvrière est mouvante et ne travaille plus forcément dans la commune, les pauvres ne sont plus forcément ouvriers ni a fortiori aux prises avec le capital, puisque chômeurs. Quant au capital, la question principale pour les édiles locaux aujourd’hui, est moins de le combattre que de le maintenir, voire de le faire venir sur le territoire de la commune. Il faut une bonne dose d’imagination et d’inventivité pour réinvestir des valeurs ouvrières, dans la nouveauté de situations encore compliquées par les mutations nationales de l’Etat.
Les espaces ouverts dans le cadre de politiques locales plus ou moins apparentée à la politique de la ville, sur le registre du partenariat et de la concertation, ont souvent une logique consensuelle qui assourdit la polémique plus qu’elle ne la transcende, favorisant plus le bénévolat para-municipal que le militantisme. La pertinence de l’espace public dépend moins de la décision institutionnelle de son ouverture que du contenu et du registre des polémiques qui s’y développent. Il ne suffit pas de créer des lieux de « participation des habitants » ou « d’expression des salariés » pour que ces derniers s’y investissent.
La question de l’espace public et précisément ici de la « scène politique » et de la représentation des conflits est donc décisive, mais non première. C’est la confrontation de la normativité et de l’Etat qui lui donne sa consistance. Et dans cette confrontation, ce n’est pas l’Etat qui fait défaut. C’est la politique, et précisément ici, la classe ouvrière comme « classe sociale subjective »[11].
Une lutte des classes sans classe ouvrière ?
Si la politique est bien un mode historique de passage du désordre à l’ordre, un mode historique de production de normes dans la polémique, il n’est pas très étonnant que la lutte des classes en ait été, durant des décennies, une matrice particulièrement opératoire. La politique de ce siècle, là où elle s’est le plus développée, a largement partie liée avec le communisme. Son efficacité vient particulièrement à sa façon de faire fonctionner des groupes sociaux, leur opposition et leur force identitaire comme opérateur de la normativité et de la polémique. C’est précisément ce point qui, dans la recomposition actuelle de la force de travail et son investissement subjectif, en fait la faiblesse.
C’est de ne pouvoir assumer aujourd’hui sa place dans la subjectivité au travail, et dans les activités sociales, que meurt aujourd’hui une forme historique de politique. C’est de cet espace en souffrance qu’elle a rejailli, contre toute attente, dans le mouvement gréviste de décembre 1995, débordant l’espace public et ses organisations, portant la normativité la plus générale dans la particularité des situations et des discours. La politique institutionnelle en général, la Gauche, et le P.C.F. en particulier, en sont restés saisis, comme pétrifiés par l’événement.
La crise de la politique nous renvoie donc à la crise de la classe comme mode historique particulier d’articulation entre l’activité productive des hommes et leur subjectivité, entre le capital et l’identité, entre le capital et l’Etat. Forme transitoire car si « l’histoire sociale des hommes n’est jamais que l’histoire de leur développement individuel »[12], le point actuel de développement de cette individualité pose en des termes nouveaux la façon dont, selon l’expression de Marx, l’espèce humaine se produit elle-même en produisant ses propres conditions d’existence.
Dans la tension entre le prescrit et le normatif, la classe a, sur plusieurs générations, et avec quelques réaménagements, assuré l’existence d’un collectif qui ménage à la fois la reconnaissance sociale et la polémique. Or le développement de l’individuation ouvrière, comme les transformations du travail, conduisent à individualiser la reconnaissance comme la polémique, mais à socialiser massivement des enjeux de classe.
En d’autres termes, nous avons affaire à des contradictions de classe qui touchent l’ensemble du monde du travail et sur lesquelles la mobilisation des individus en collectif ne transite pas par le sentiment d’appartenance à un groupe social spécifié. Bref nous avons à gérer une situation nouvelle, qui s’est manifesté avec éclat en novembre et en décembre : celle d’une lutte de classe sans classe ouvrière, dans laquelle la question de la valeur d’usage de la force de travail a pris le pas sur sa valeur d’échange. Et si une période est bien close, c’est celle ou la libération de tous les hommes pouvait s’incarner dans un groupe social spécifié. Il n’y a pas aujourd’hui à chercher une nouvelle classe ouvrière, mais la culture polémique capable de rassembler la multitude des expériences de confrontation à l’ordre social sur des enjeux communs. Car l’enjeu lui même s’est déplacé et on n’en a aujourd’hui qu’une lecture dominée par la logique marchande : avec l’intellectualisation de travail et l’intégration de la mobilisation subjective des hommes dans la compétence, cette dernière devient un facteur décisif de production. A travers elle, d’une certaine façon, on assiste à une réappropriation individuele et sociale, de l’outil, d’un nouvel outil. Cette donnée perturbe fondamentalement les termes des relations capital/travail et donc les politqiues d’emploi des entreprises. Lorsque ces dernières argumentent aujourd’hui sur « l’inemployabilité » d’une partie de la main-oeuvre, on pourrait leur renvoyer que c’est d’une difficulté nouvelle de l’exploitation qu’il s’agit en fait.
Si le lien du travail de la subjectivité et de la politique que nous avons esquissés s’avère opératoires, on perçoit le travail qui reste à faire. pour répondre à la question suivante : quelle est aujourd’hui la culture politique qui peut prendre corps dans la mobilisation contemporaine des hommes dans une expérience du travail qui peut aller jusqu’au déni de leur valeur d’usage ?
L’expérience juvénile de la précarité est, de ce point de vue, un bon champ de réflexion. Quelles forces mobiliser, sur quel terrains et avec quels objectifs pour contrer la précarisation ? Quel est l’horizon mobilisateur de nouvelles garanties sociales voire statutaires qui pourraient assurer à tous une place, une utilité sociale reconnue ? Car il y a une façon de s’arc-bouter sur les figures anciennes de l’emploi, qui laisse les victimes isolées et démunies face au redéploiement entrepreneurial.
Pire : la multiplication des procédures dites « d’insertion » peuvent jouer contre l’emploi ou pour sa précarisation. On y trouve toujours, peu ou prou, l’acceptation de deux idées forces du patronat : la main-d’oeuvre est trop chère, et le chômage est d’abord du à « l’inemployabilité » des demandeurs d’emploi. Il s’agit donc de réduire les coût et de former les impétrants, de les « normaliser », à grand renfort de transferts de fonds publics. Le résultat est une dévalorisation sociale et subjective du travail disponible. Les jeunes qui, à travers des parcours de précarité divers, font l’expérience des relations sociales de travail, sont mis dans une situation d’infériorité dans la confrontation Capital/Travail…
Et si le contraire de la précarité n’était pas l’emploi à vie, mais des garanties sociales voire des statuts permettant de vivre une nécessaire mobilité d’emploi dans la valorisation du travail et la sécurité de la vie ?
La valorisation individuelle de la compétence professionnelle, face aux conditions modernes de l’exploitation, devient un terrain potentiel de la lutte collective. Il y a à réfléchir sur ce qui se joue dans les parcours positifs de précarité, ceux dans lesquels réussissent à se construire un profil professionnel valorisant en terme d’expérience, de polyvalence ou de capacité à se reconvertir. Or ce terrain ne mobilise guère aujourd’hui que des énergies individuelles… Quels objectifs, quelles garanties, quelles formes publiques nouvelles sur lesquelles s appuyer, faudrait-il dessiner pour passer d’une mobilisation individuelle à une mobilisation collective, de la débrouille de « ceux qui s’en sortent » à une nouvelle culture de lutte ?
Les exigences qui s’expriment aujourd’hui en terme de compétence, d’expérience, de « flexibilité », ne sont des armes contre les hommes que si on laisse à la seule logique financière et marchande le soin d’en définir les termes. Elles pourraient être un nouveau terrain d’acquis sociaux et de valorisation du monde du travail. Il faudrait pour cela faire culturellement le deuil d’une certain figure du travail et de l’emploi, et voir que les enjeux actuels en terme de professionnalité sont à la fois beaucoup plus individualisés dans leur formes et nécessitent des garanties collectives, des points d’appuis publics (en terme de revenus, de formation continue), beaucoup plus collectifs.
Quels nouveaux droits revendiquer ? Quelles nouvelles valeur d’usage définir pour des services collectifs à promouvoir au niveau national comme au nouveau local, en terme de formation, d’organisation professionnelle, de point d’appuis publics aux projets d’activités ? telles sont les pistes de réflexion qui s’ouvrent pour un redéploiement de l’activité syndicale, ou ce qui pourrait être, en cette fin de siècle, l’équivalent de ce que fut, avant guerre, la révolution municipale des communistes : ancrer dans le droit et l’Etat une normativité en polémique avec l’ordre social, transformer les ghettos sociaux en bastions et en tremplin d’une modernité universalisable. Une telle démarche nécessiterait de rompre aussi avec la politique de la ville, sa philosophie stigmatisante et normalisatrice, la taxinomie sociale dont elle est porteuse et les dérives culturelles qu’elle engendre.
[1] Ce texte reprend pour l’essentiel une intervention de l’auteur au colloque « Travail, marginalisation, citoyenneté » organisé par Avis de Recherches, Société Française, Espace Marx et l’IRM sud à Marselle, les 3&4 mai 1996
[2] J’ai développé cette analyse dans La crise de la politique : du désarroi miliatnt à la politique de la ville, Paris, L’Harmattan, 1996
[3] Bertho (A.), « Le social et le politique : d’une pensée du conflit à une pensée du désordre », Société Française 3/53, octobre 1995.
[4] Canguilhem (G), Normal et le pathologique, (1966), Paris, PUF, 1991 :
« Le malade n’est pas anormal par absence de normes, mais par incapacité d’être normatif. (…) Ce qui caractérise la santé c’est la possibilité de dépasser la normes qui définit le normal momentané, la possibilité de tolérer des infractions à la norme habituelle et d’instituer des normes nouvelles dans des situations nouvelles. (…)
Le normal est à la fois extension et exhibition de la norme. Il multiplie la règle en même temps qu’il l’indique. Il requiert donc, hors de lui et contre lui, tout ce qui lui échappe encore. Une norme tire son sens, sa fonction, sa valeur du fait de l’existence en dehors d’elle de ce qui ne répond pas à l’exigence qu’elle sert. Le normal (…) est un concept dynamique et polémique. Le chaos a pour rôle d’appeler, de provoquer son interruption et de devenir un ordre. (…) dans l’ordre du normatif, le commencement c’est l’infraction. (…) L’anormal, logiquement second est existentiellement premier. »
[5] Verret (M), L’espace ouvrier, Paris Colin 1979 :
« Peut-être faut-il plus que des normes de pierre pour déposséder la classe ouvrière de son identité. Les analyses catastrophiques de la normalisation ont tendance à définir la reproduction de la classe ouvrière comme un pur mécanisme de répétition, dont la bourgeoisie ou son Etat, règlerait l’agencement, et dont la classe ouvrière subirait le mouvement. (…) La classe ouvrière, classe vivante, souffrante, réfléchissante, réagissante, intervient dans le mode de production capitaliste comme un des termes de sa définition, dans le mouvement de sa reproduction comme un des termes de sa modification. Ni l’évolution de ses conditions de logement, ni l’évolution des normes d’habitabilité ne se conçoivent sans ses revendications, ni ses luttes. (…) L’expression des normes étatiques sur le logement ouvrier n’est pas la pure et simple expression de la demande de la classe dominante. C’est l’expression composée d’une double et contradictoire demande, des dominants et des dominés, des dominants sous la pression des dominés, des dominés en, protestation contre les dominants »
L’analyse menée par Jean-Pierre Terrail sur le rapport des la classe ouvrière à la boisson va dans le même sens (1990, Destins ouvriers la fin dune classe ? PUF)
[6]. Terrail (J.P.) , op. cit.
[7]. Autrement (série Mémoire) n° 18/1992, Banlieue rouge 1920, 1960, dirigé par A. Fourcaut.
[8] On trouvera un developpement assez synthétique de cet esprit du temps dans Dubet (F.), « les figures de la ville et de la banlieue », Sociologie du travail, XXXVII 2/95 « La ville : habiter, gouverner
[9] Je doit ici reconnaitre tout ce que je dois aux travaux de Yves Schwartz, Yves Clot, Jean ves Rochex et Chritophe Dejours.
[10]. D. Berger, Futur Anterieur, 4° trim. 1993.
[11]. Michelat (G.), Simon (M.), Classe, religion et comportement politique, Paris, PFNSP-ES, 1977, Page 210 et suivantes.
[12]. Marx (K.), « Lettre à Annenkov » de décembre 1846, in Marx (K.), Engels, (F.), Correspondance, Paris, Ed; Soc., 1971, tome 1, page 448