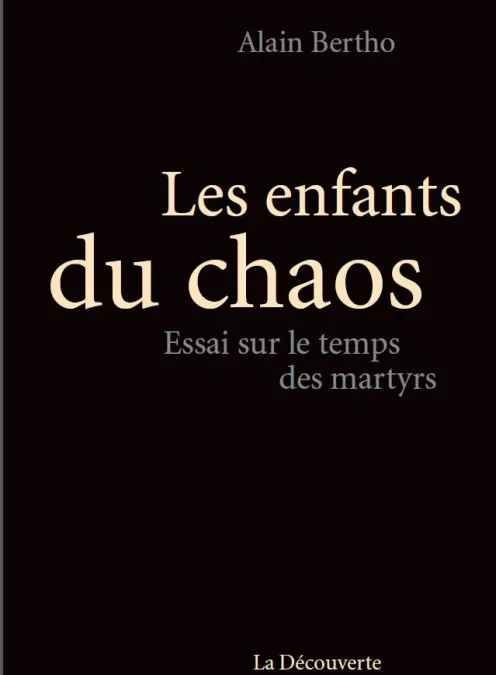Le social et le politique
D’une pensée du conflit à une pensée du désordre
Alain Bertho in Société française 1996
L’élection présidentielle et la campagne qui l’a précédé a donné à voir une nouvelle articulation du social et du politique. Comme souvent dans ce type de conjoncture, ce qui se donne en temps court cristallise des évolution longue, accélère des tournants voire des ruptures. De quoi s’agit-il ? D’abord d’une présence quantitativement nouvelle du social dans ce type de période, du point de vue des activités déployées dans un champ conflictuel comme du point de vue du discours des candidats de droite. Mais aussi d’une présence qualitativement nouvelle et ceci notamment dans le champ du discours politique. Le social qui se parle et qui polarise les débats n’est plus le social d’antan. La fracture y a remplacé la lutte, l’enjeu y est social et non plus « de société ».
L’arrière plan conflictuel d’une campagne qui anticipe sur ce qu’il est convenu d’appeler troisième tour social n’est pas nouveau même s’il est convenu d’attendre une sorte de parenthèse des conflits sociaux en période électoral. La campagne pour les élections Européennes de 1979 s’était déroulée sur fond de conflit de la sidérurgie en Lorraine. De ce point de vue la campagne électorale de 1995 a fait aussi exception. Grèves en Corse, dans la fonction publique, occupations de logement, la question sociale sous le double aspect de l’exclusion et du salaire a été présente de façon active : les étudiants, les ouvriers de Renault, l’association Droit au logement ont successivement ou ensemble, occupé l’arrière scène de la concurrence électorale. C’est plutôt à un premier tour social auquel on a assisté.
L’interprétation de cet événement comporte deux volets. Que nous apprend-elle de l’évolution des conflits sociaux en terme de terrains et de mobilisation ? C’est la première question qui vient et le premier terrain d’investigation qui s’ouvre. Mais que de telles mobilisations aient lieu en pleine campagne présidentielle, c’est à dire pendant le débat national où la polarisation de tous les problèmes nationaux dans l’enjeu électoral est le plus fort, n’est pas sans poser aussi quelques questions quant aux transformations de la politique elle même.
Il existe en effet une différence essentielle entre 1995 et 1979. Si aujourd’hui le social a été présent dans des actes militants et des mobilisations, et, d’autre part, dans les discours des différents candidats, elle n’est plus un élément central de clivage politique. La présence forte de la « question sociale » dans le débat politique, la prégnance de thèmes comme la pauvreté, l’exclusion, le succès de quelques formules comme celle de « fracture sociale », ne signifient pas pour autant que l’élection soit perçue comme un enjeu de société.
Car la nouvelle articulation du social et du politique a d’abord comme matrice, une nouvelle vision du social, un nouveau léxique qui semble aujourd’hui ne plus faire débat. Il faut mesurer de ce point de vue le bouleversement culturel qui s’est opéré ces dix dernières années. Cette nouvelle pensée du social, sorte de vulgate catégorielle, s’est répandue aussi bien dans le champ médiatique et les discours politiques que dans une partie du milieu scientifique. Le fait nouveau est que cette vulgate et son lexique unifié a servi cette année de matière principale aux débats électoraux eux-mêmes, signant par là même une sorte de consensus politique dans l’approche des problèmes sociaux contemporains. Il faut dire que cette nouvellle pensée bénéficie d’une assise populaire importante. Interrogés par la SOFRES en 1994 sur les divisions les plus importantes de la société française, les français citent comme tiercé gagnant la distinction entre gens aisés et exclus (66%), la distinction entre actifs et chômeurs (55%), la distinction entre français et immigrés (52%). L’opposition patronat salariat vient loin derrière avec 33%…
1. une pensée de l’ordre et du désordre
L’histoire culturelle et institutionnelle de ce corpus reste à écrire. Elle passe à coup sûr à travers la mise en place de la politique de la ville, qui, du développement social des quartiers au ministère de l’intégration, a marqué de son sceau l’approche des questions sociales en France depuis le début des années 80. Elle à généré un véritable milieu culturel où travailleurs sociaux, cadres de l’Etat, chercheurs et élus locaux ont peu à peu appris à parler le même langage. Les maîtres mots en sont exclusion et banlieue, pour ce qui est du diagnostic, insertion et ville pour ce qui est des solutions.
ville et banlieue
La politique de la ville a proposé des catégories à une situation nouvelle et opaque : celle de ségrégations et de tensions sociales de moins en moins lisibles en terme de classes sociales, que ce soit par les savants, les politiques, ou les interessés eux mêmes, en raison du poids grandissant du chômage et de la précarité dans les processus de paupérisation.
L’espace est devenu à la fois, le cadre d’analyse et la métaphore de la question sociale. Il fonctionne aussi bien dans l’urbain (les quartiers, les banlieues) que dans le symbolique (insertion, marginalisation). Autour de cette représentation spatiale s’organise un appareillage catégoriel qui fonctionne aussi bien dans le discours savant que dans le discours institutionnel.
C’est sans doute Alain Touraine [1] qui a exprimé le plus tôt et avec le plus de concision et clarté cette spatialisation théorique des problèmes sociaux. Il pronostique ainsi « le passage d’une société verticale, que nous avions pris l’habitude d’appeler une société de classe avec des gens en haut et des gens en bas, à une société horizontale où l’important est de savoir si on est au centre ou à la périphérie.(…) Ce qu’on appelle d’un terme symbolique la banlieue, c’est justement cette zone de grande incertitude et de tensions où les gens ne savent pas s’il vont tomber du côté des in ou du côté des Out« .
Dans cette spatialisation du regard, les mots de banlieue et de ville ne sont pas équivalents. En fait la catégorie de banlieue est la seule opératoire, jointe à celle de quartier, durant les premières années de la politique de Développement social des quartiers, qui n’est pas encore celle de la ville. Elle reste jusqu’à aujourd’hui le terme le plus largement utilisé dans le champ médiatique, et beaucoup moins dans le champ scientifique pour désigner les problèmes sociaux nouveaux, difficilement lisibles avec les catégories anciennes, lourds de violence réelle ou symbolique. Dans son usage actuel le plus courant, son sens n’est plus celui que lui donne les géographes ou les urbanistes. Il ne se réfère pas obligatoirement à un lieu ou une population précise.
Le terme de banlieue est toujours associé à l’idée de crise, d’explosion, de mal[2], à moins de ne concerner qu’un passé considéré comme révolu[3]. Son usage s’amenuise en proportion des ambitions de sérieux des textes qui y font référence.
Même lorsqu’un rapport officiel nomme la banlieue dans son titre, la catégorie est inutilisée dans le corps du texte[4]. Un ouvrage de synthèse sur la France contemporaine[5] ne l’emploie que trois fois (en fait dans une seule contribution consacrée aux « solitudes urbaines »), en la faisant figurer à l’index thématique. Un manuel de sociologie du même éditeur, en 1989[6] va jusqu’à l’ignorer dans son index. Ce n’est qu’après un débat préalable que la banlieue prend place, au côté de la ville, dans le colloque international financé par le PIR-Ville et organisé par l’Université de Paris 8 en janvier 1994 à la Villette[7]. L’usage de la catégorie dans le champ universitaire ne reste vraiment développé que sur le terrain des pratiques professionnelles où des réflexions de chercheurs et de praticiens continuent de se heurter à la difficile lisibilité du social contemporain : la banlieue dans ce cas n’est plus réductible ni à un territoire ni à un peuplement, elle désigne les limites réelles auxquelles se heurte la politique de la ville. [8]
La catégorie de Ville, légitimée par son institutionnalisation politique, le vote d’une loi d’orientation et la création d’un ministère, obtient un succès fulgurant dans la fin des années 80. Ainsi sur les trois ouvrages collectifs de la collection « société » des éditions Esprit consacrés au sujet entre 1991 et 1993[9], la ville est nommée directement dans sept titres de contribution, l’urbanité dans trois, la cité dans deux, la banlieue dans aucun. Cette catégorie est à usage aussi prescriptif que cognitif : elle est associée à la réflexion à la politique du même nom (2 fois), au développement souhaité d’un espace public démocratique (3 fois, plus si on ajoute cité et urbanité).
L’usage de la catégorie, dans nombre de publications renvoie moins à la sociologie urbaine qu’à la ville de l’urbaniste. Elle est moins une réalité à décrire qu’un modèle à restaurer, un ordre à reconstruire dans l’ordre spatial, puisque c’est d’abord ainsi que le désordre a été caractérisé. Elle est le lieu ou ce qui est caractérisé comme « crise du lien social » va être l’objet d’une thérapie d’Etat: celle de l’appel à la « participation » et à la citoyenneté. L’espace public des architectes est pris pour la figure urbaine de l’espace public selon Habermas[10], on assimile l’ouverture du territoire et l’accès à l’abstraction politique. La ville, modèle et cadre de l’Etat moderne devient le paradis perdu d’une société en crise. La première série des « entretiens pour la ville » organisés par la DIV en 1991 et publiés par la revue Esprit sous le titre Citoyenneté et Urbanité est significative à cet égard[11]. Le rapport de la banlieue à la ville apparaît ainsi comme celui du désordre à l’ordre ou plutôt à la mise en ordre. C’est ce que François Dubet exprime d’entrée dans un article récent de Sociologie du Travail :
« Aujourd’hui, la question urbaine tend à se profiler comme le nouveau visage d’une question sociale détachée de la question ouvrière, comme l’espace des mutations les plus sensibles des politiques publiques et comme l’appel à une sociabilité perdue. dans tous ces sens, la banlieue apparaît comme l’envers de la ville, comme la figure de la crise et des changements induits par ces « politiques » de la ville. »[12]
exclusion/insertion
Le couple « exclusion/insertion » est l’autre point fort du dispositif conceptuel. Son axe est celui de l’exclusion[13], mis en exergue des textes politiques comme des textes savants. Jacques Donzelot et Philippe Estèbe[14] en font la définition même de la politique de la ville, relayés par le rapport Geindre[15]. Le vocabulaire social, médiatique et politique cultive la vocabulaire du manque : les sans emploi, les sans statut, les sans papiers, les fin de droits, les sans domicile fixe. L’exclusion est citée sept fois à l’index thématique de Sortie de Siècle[16] (la marginalisation sociale une fois), alors qu’elle est absente de Sociologie Contemporaine[17] .
Cette catégorisation a l’intérêt d’être quantifiable. Ainsi, dans le rapport Geindre, parmi des critères retenus pour qualifier villes, régions ou quartiers, le taux de chômage est en bonne place (la première), ainsi que dans nombre de diagnostics locaux.
Pour autant le contenu de la catégorie n’est pas si facile à saisir, sinon que s’intégrant fort bien au schéma tourainien, elle désigne en fait la ségrégation sociale contemporaine[18] dont l’originalité est perçue comme une ségrégation hors du travail et de ses conflits c’est-à-dire sans dynamique possible[19] , même si Etienne Balibar tente, en partant des réflexions de Robert Castel[20], de lui redonner une dynamique conflictuelle[21] « généralisée ».
Du coup elle alimente une représentation des inégalités sociales cumulées comme hors de l’organisation sociale elle-même. Au-delà même de la notion de « société à deux vitesses » ou de « société duale[22] » qui avait eu son temps de succès à partir des années 70, il y a bien ici posée l’idée d’une société humaine ayant un dedans et un dehors.
Les notion d’insertion et d’intégration désignent donc les réponses sociales et institutionnelles recherchées. La première s’applique de façon générale et a connu des développements particulièrement importants liés à la préparation et à la mise en place du Revenu Minimum d’Insertion[23] en 1988, elle est reprise dans la mise en place actuelle des Plans Locaux d’Insertion par l’Economique.
Mais l’exclusion existe-t-elle ? La question elle-même n’est « politiquement correcte » dans une période qui a vu le thème de l’exclusion nourrir une bonne part du débat de l’élection présidentielle, sur fond de réquisition sauvage de logement et de manifestations nationales et locales.
Pourtant si la pauvreté, la souffrance et toutes ses conséquences qui, de la délinquance aux déstabilisations psychiques sont aujourd’hui une réalité bien tangible, il reste scientifiquement légitime de contester le nom générique qu’on semble vouloir lui donner. Non que celui-ci n’aurait pas de sens. Mais peut-être parce qu’il n’a pas de sens sociologique, qu’il reste, comme aurait dit certains, une prénotion.
Où se situerait donc la limite entre le dedans et le dehors ? entre les chômeurs et les autres ? On sait que la situation actuelle de l’emploi et les progrès de la précarisation nécessite une analyse pour le moins plus poussée. On est toujours un peu l’exclu de quelqu’un.
Pauvreté, souffrance, délinquance, précarisation sont des objets de connaissance. Pas l’exclusion. Telle n’est pas la moindre des conclusions par exemple d’un colloque de septembre 1994 à l’Université de Paris 8 sur le thème « Exclusions et éducation ». L’insertion, certe, est étudiée dans le cadre d’enquêtes d’évaluation des politiques publiques. Mais ce n’est pas la même chose et ce n’est pas innocent. En fait, la seule définition valable de l’exclusion qui reste est la suivante : sont exclus ceux qui sont justifiables d’une politique d’insertion… L’exclusion, c’est la pauvreté, l’inégalité et la ségrégation sociale vue du côté de l’institution, de l’Etat, de l’ordre, d’une norme de vie sociale considérée comme intangible. L’exclusion c’est la domination sociale et l’inégalité dans ses formes les plus criantes lues comme une pathologie, comme un désordre à « réduire ». Dans une telle logique, c’est le malade qu’il faut d’abord soigner, et soumettre aux normes et non la société qui devrait revoir les siennes.
immigration/intégration
La notion d’intégration est à l’origine plus étroite, elle est le plus souvent liée à la désignation d’une sous-population, les immigrés[24] et désigne une politique spécifique, celle des « sites pilotes pour l’intégration »en 1990 d’un secrétariat d’Etat et d’un Haut Conseil. Or, le dernier gouvernement a désigné comme ministère de l’intégration le département ministériel regroupant l’ancien ministère de la ville et une part des affaires sociales. La responsabilité des « quartiers en difficulté » n’est qu’un secrétariat d’Etat.
Ce glissement marque la légitimation institutionnelle de la nouvelle centralité de l’immigration comme catégorie opératoire de lecture du social, que ce soit comme marqueur de la banlieue, ou comme cible particulièrement visée de l’exclusion.
2. L’ethnicité comme nouveau paradigme ?
Les années 80 resteront dans l’histoire française comme celles de l’émergence de la « question de l’immigration » dans le débat public. Cette « question de l’immigration » a pris politiquement un visage aux Européennes de 1984. Elle conduit la nouvelle majorité de droite à l’Assemblée Nationale à voter en 1994, dans l’indifférence générale une série de lois sur la nationalité et le statut des étrangers en rupture avec la tradition républicauine française..
La thématique de l’immigré a fait un triomphe, que les 15% du Front National en 1995 ne mesurent que très partiellement. Elle est partout, dans tous les discours et dans toutes les têtes. Elle nécrose notre lecture du social. Elle est nodale en se sens qu’elle est porteuse d’une lecture en terme de statuts en lieu et place d’une lecture en terme de rapports.
La figure contemporaine de l’immigré s’affirme paralèllement à la crise du travail et à l’affaiblissement de la figure ouvrière. Le poids de l’immigration dans le développement de l’industrie taylorisée, singulièrement parmis les OS de la région parisienne est une réalité dès les années 70. Mais les grèves de l’automobile des années 70 sont d’abord qualifiée comme de grèves d’Ouviers spécialisés. Lorsque dans le début des années 80, l’usine automatisée de Citroën à Aulnay, entre dans une grève longue, la figure de la grève ouvrière laisse peu à peu le terrain à celui de la grève immigrée dans l’espace public, voire à celui de la grève « chiite ».
Le glissement s’opère au sein même de la classe, voire même de la classe issue de l’immigration. Lorsque l’ancien secrétaire du syndicat CGT de Jeumont Schneider à St-Denis, aujourd’hui à la retraite après la fermeture de son établissement, regarde avec nostalgie son quartier en recomposition industrielle, il ne voit plus d’ouvrier : il ne « voit » plus que d’un côté quelques travailleurs du tertiaire et une population « immigrée », qui est pourtant majoritairement composée d’ouvriers.
Le Taux d’immigration, ou de population étrangère, ou d’origine étrangère devient un indicateur-clef de difficulté sociale, en lieu et place de la catégorisation socio professionnelle. C’est ainsi le deuxième indicateur retenu après le taux de chômage dans le rapport Geindre, le premier pour la caractérisation des populations scolaires en difficulté dans le rapport Delarue. Toute zone scolaire en recherche de classement zone d’éducation prioritaire, toute cité en difficulté sera ainsi prioritairement caractérisée par l’origine de sa population. Par des glissement catégoriels parfois peu maîtrisés, on passe ainsi de la nationalité à l’origine nationale, puis de l’origine nationale à la couleur de la peau, nourissant ainsi des statistiques locales parfois fantasmagoriques et des diagnostiques sociaux imaginaires.
Les écoles de la Plaine St-Denis ont ainsi été mises à l’index de la rumeur publique de la ville de St-Denis et de l’administration des écoles de la ville en raison de la coincidence affirmée d’un fort échec scolaire et d’une forte scolarisation étrangère. Un rapport de recherche de 1987 avait d’ailleurs conforté les responsables sur ce diagnostic. Vérification faite, le taux de retard scolaire n’est pas plus important que celui d’autres quartiers de la ville.
Quant au taux de fréquentation par des enfants étrangers annoncé par les inscriptions, il est visiblement surestimé. Les chiffres annoncés pour les rentrées de 1989 et 1990 sont respectivement de 81.2 et 85.9 %. D’après le recensement, on ne compte que 48 % d’étrangeers parmis les enfants d’âge scolaire du quartier. Même si on considère que la totalité de l’évitement scolaire (il manque 26% des effectifs de la classe d’âge dans les écoles du quartier), est uniquement le fait d’enfants français, ce qui est peuvraisemblable, le taux maximum que pourrait atteindre la scolarisation étrangère ne dépasse pas 65.5 %. Par quel miracle, 20 % d’enfants français (au moins) sont-ils devenus étrangers à l’inscription ?
Une « ethnicisation des rapports sociaux » ?
L’origine nationale voire l’origine ethnique des populations tend à devenir une des grilles dominantes de lecture du social, les « rapports inter-ethniques » une grille de lecture des rapports sociaux[25] et pas seulement en banlieue, tant la question du racisme serait liée à la crise de la modernité[26]. On peut ainsi passer d’un racialisme culturel rampant à une théorisation sérieuse et pavée de bonnes intentions.
Il y a deux façons de s’engager dans le concept d’ethnicisation des rapports sociaux. La première consiste à prendre la chose pour le nom qu’elle se donne, et par un objectivisme curieux, de déduire du racisme des uns, l’ethnicité des autres. La seconde consiste à céder à la pression dominante au nom même de la résistance. Le raisonnement est alors le suivant :
« Le racisme l’emporte car l’argumentation antiraciste est faible de ses a priori et de ses tabous. Donc le tabou principal à surmonter est celui qui consiste à extérioriser le racisme, à ne lui attribuer que des causes sociales. Ce tabou empêche les bonnes ames antiracistes de voir « la réalité des problèmes de l’immigration » qui auraient aussi une base ethnique. Or, dans l’histoire c’est parfois l’ethnique qui crée le social. Ce fut le cas dans le colonialisme, contrairement à certaines conceptions qui, au nom de l’universalité de la culture ont justifié la domination des peuples européens sur les autres. Donc, pour y voir clair et résoudre les problèmes posés aujourd’hui, il faut à la trilogie des rapports de production/rapports de sexe/rapports de générations, une dynamique de « rapports inter-ethniques » dont l’importance est grandissante. »
La démonstration est sans faille à un détail près : sa conclusion est loin d’avoir fait les preuves de son caractère opératoire dans des enquêtes empiriques même dans les ouvrages qui s’en réclament explicitement comme Ethnicisation des rapports sociaux paru en 1994.[27] D’autre voix s’élèvent pour aborder l’ethnicisation des rapports sociaux comme un processus de l’ordre de la subjectivité plus que de l’objectivité. C’est le cas d’Olivier Roy[28] qui conclue que c’est bien le racisme qui crée l’ethnicisation et non l’inverse. Retour à la case départ.
Mais le doute commence-t-il à peine à s’installer sur la validité scientifique de l’approche ethnique du social, que l’idée prend un nouvel envol dans le champ idéologico politique. L’ethnicité se voit promue au rang de nouveau paradigme politique, légitimée par le label scientifique dont bénéficient ses promoteur. Michel Wieviorka, par exemple en fait la pierre angulaire nécessaire et souhaitable d’une reconstruction sociale face aux dangers du populisme et du nationalisme contemporain voire du repli communautaire.[29]
La société : rapports ou statuts
Derrière les questions de l’immigration, de l’ethnicité et du communautarisme, c’est la question de la pensée de la société par elle m^me et par l’Etat qui se profile.
Le communautarisme est en effet l’expression extrême et institutionnalisée de cette taxinomie statutaire portée notamment par l’Etat et la commande publique de recherche. Elle évacue la notion même de rapports sociaux et tend à transformer la lutte sociale en une guerre de tranchée, voire une guerre extérieure. Elle fait de l’Etat l’acteur principal du social et tend à assimiler la dynamique sociale à un désordre.
On peut dans ces conditions partir à la recherche d’un nouveau prolétariat dans les « classes dangereuses » contemporaines[30] ou s’interroger sur la nouvelle définition de la « question sociale » dans l’absence de mouvement social[31]. Il reste que globalement, la catégorisation sociale qui s’impose est celle de l’Etat[32] : la question sociale est un désordre, et non pas un conflit, dont le noeud ne se situe pas dans le travail mais dans la question urbaine, elle est donc à réduire et non à dépasser. C’est l’objet principal de la politique dite « de la Ville ». La boucle est bouclée.
3. Quelle crise de l’Etat ?
Or depuis plus de dix ans, la politique de la ville apparaît au moins autant comme le lieu d’expression d’une crise de l’Etat, que d’une politique destinée à répondre à une dite « crise de la ville ». Les procédures se succèdent et s’accumulent, les questions subsistent, la résignation s’installe. Ce constat laisse en suspend une question : pourquoi dans ces conditions la politique de la ville se poursuit-elle, pourquoi n’est-elle pas l’objet d’un débat public alternatif, pourquoi les catégories de l’action politique mobilisent-elles si bien les acteurs comme les chercheurs?
La politique de la ville transcende les clivages politiques et les changements de majorité. Le consensus politique porte sur le constat de difficulté, sur la recherche tâtonnante de solutions partielles, sur le cadre contractuel de l’ensemble. Le débat ou le conflit, s’il émerge ne porte que sur les moyens financiers mis en oeuvre. Un consensus intellectuel mobilise la pensée et la recherche au plus près des procédures et des interrogations institutionnelles. On est loin des débats et des tensions entre sociologues et planificateurs dans les années 60 et 70. Faut-il que l’Etat affirme ses objectifs pour que des chercheurs affirment leurs objets ? Car cette politique a pour caractéristique principale, depuis le début des années 80 de renvoyer aux acteurs et aux chercheurs la définition de son objet. La prescription de l’Etat, après le constat fait au tournant des années 80 d’un grippage institutionnel et de l’urgence d’une politique de maintien de l’ordre[33], y est d’abord de procédure, dans un cadre décentralisé, territorialisé, et contractualisé[34].
L’Etat n’est plus de tous les lieux: il intervient de façon spécifique sur des territoires délimités pour « recoudre » le social « là où il se défait ». L’Etat produit du provisoire puisque les procédures, dans leurs lieux et territoires, sont expérimentales. Hypothèse, action, évaluation : l’institution crée une situation, elle ne répond pas à une sollicitation sociale, elle sollicite l’expression des besoins sociaux. L’Etat devient normalisateur sur lui même: il instaure procédures et critères d’activité. Il n’est pas porteur de normes sociales à la recherche desquelles il se met d’une certaine façon en quête. Il y a perte de sens des activités publiques et des règles. La cause en est que l’Etat ne vient pas suppléer à une défaillance de l’Etat voire revivifier de sa propre présence un lien social en dissolution. Ce n’est pas d’une absence de normes dont souffre les relations sociales et les activités humaines, mais d’une absence de normalité, c’est à dire de normativité [35].
La banlieue, ses territoires de « marginalisation », ses fronts d’insertion » et de « développement » voit se répandre la présence et l’activité normée d’un Etat polymorphe et inefficace, en lieu et place de cette activité collective de production des normes que l’on nomme politique. Cette distinction est importante si on veut aujourd’hui démêler l’écheveau des situations réelles. Le glissement cognitif, culturel, prescriptif de la « classe » à l’exil » où à l’exclusion », de la « lutte » à l’insertion », des « besoins » à la « prévention », du « bastion » au « ghetto », signale un projet de société sans conflit porteur de nouvelle normalité, une substitution de l’Etat à la politique[36].
Dans la difficulté de la société à se penser et à penser ses contradictions, gît donc, en fait, la crise majeure de notre époque, celle de la politique. Il y a aujourd’hui des catégories qui perdent simultanément de leur valeur heuristique et de leur vertu mobilisatrice. Une crise de la politique et de l’action normative des hommes sur la société met à mal des symboles mais aussi des savoirs. Elle laisse le champ libre à des représentations et des taxinomies sociales qui évacuent le conflit et la contradiction comme un désordre.
[1]. « Face à l’exclusion » , coll. Citoyenneté et Urbanité, éditions Esprit, 1991.
[2]. Par exemple Duprez (D.), le mal des banlieues ? sentiment d’insécurité et crise identitaire, Paris, l’Harmattan, 1992 ; « Banlieue, intégration ou explosion ? », Panoramiques 1993 ; « La France des banlieues », Esprit, février, 1991.
[3]. On pourrait citer ici toute la bibliographie sur la « banlieue rouge » ; Fourcaut (Annie) dir., Un siècle de banlieue parisienne (1859-1964), guide de recherche, Paris, l’Harmattan, 1988.
[4]. Delarue (JM.), Banlieues en difficulté, la relégation, Syros, 1991
[5]. Sortie de siècle, la France en mutation, dirigé par J.P. Durand et F.X. Merrien, Paris, Vigot, 1991.
[6]. Sociologie contemporaine, Dir. par J.P. Durand et Robert Weil, Paris, Vigot, 1989.
[7]. Banlieue, Ville, Lien social, suivi par la publication par l’université d’une revue du même nom.
[8]. Création en 1993 du Centre de Ressource »profession Banlieue » par la SCET , reprenant le titre du colloque de l’Université de Paris 8 de 1992, organisé par Jean Luc Roger et Alain Bertho ; « La banlieue est-elle un métier? », Migrant Formation, op.cit. ; Charlot (B.), Bautier (E.), Rochex (J.Y.), Ecole et savoir dans les banlieues.. et ailleurs, Paris, Colin, 1992.
[9]. Face à l’exclusion, le modèle français, dir. J. Donzelot, 1991 ; Ville, citoyenneté, urbanité, dir. Joël Roman, 1991 ; Citoyenneté et urbanité, 1993.
[10]. Habermas (.), L’espace public, archéoligie de la publicité comme dimension dconstitutive de la société bourgeoise, Paris, Payot, 1978 (1973).
[11]. On y lit: « Ville et démocratie » par Paul Thibaud ; « Lumières de la cité grecque » par Pierre Vidal Naquet ; « Avant le monumental, les passages: Walter Benjamin » par Guy Petitdemange ; « Espace privé, espace public à l’âge post-moderne » par Gilles Lipovetsky.
[12]. Dubet (F), « Les figures de la ville et la banlieue », Sociologie du travail, XXXVII,2/95.
[13]. Thème lancé en 1974 par René Lenoir, secrétaire d’Etat à l’Action Sociale de 1974 à 1978 (Les exclus, Paris , le Seuil) et repris par lui dans Français, qui êtes vous ? dir . Reynaud (JD) et Grafmeyer (Y), Documentation française, 1981 : « Inadaptation et exclusions sociales ».
[14]. L’Etat animateur, éd. Esprit, 1994..
[15].Villes, démocratie, solidarité, le pari d’une politique, la Documentation Française, 1993
[16]. op.cit.
[17]. op.cit.
[18]. On aura une idée du traitement « ancien » de la question de la ségrégation spatiale dans Pinçon-Charlot (Monique), Preteceille (Edmond) et Rendu (Paul), Ségrégation urbaine, classes sociales et équipements collectifs en région parisienne, Paris, Anthropos, 1986 ou Tabard (Nicole), « Voisinage social et Ile de France », dans Données Sociales Ile de France 1989, Paris INSEE, 1989.
[19]. C’est ce que Jacques Donzelot et Ph. Estèbe désignent comme « non forces sociales » op. cit.
[20]. Castel (R.), « De l’exclusion comme état à la vulnérabilité comme processus », in Affichard (J.), Foucauld (J.B. de), Justice sociale et inégalités, Paris, Esprit, 1992, page 135.
Castel (R.) « De l’indigence à l’exclusion, la désaffiliation », in Face à l’exclusion, le modèle français, sous la direction de J.Donzelot, Paris, Esprit, 1991.
[21]. Balibar (E.), « Inégalités, fractionnement social, exclusion, nouvelles formes de l’antagonisme de classe ? », in Affichard (J.), Foucauld (J.B. de), Justice sociale et inégalités, Paris, Esprit, 1992.
[22]. « A l’horizon 2000, le risque majeur est celui d’un clivage croissant entre une couche moyenne et une classe d’exclus, enfermés dans un cumul d’inégalités. Ce qu’il est convenu d’appeler société duale« . Faire gagner la France, dir. François Guillaume, commissaire au Plan, Paris, Hachette, 1986, page 160.
[23]. Milano (S.), La pauvreté absolue, Paris, Hachette, 1988
[24]. Lapeyronnie (D), « de l’intégration à la ségrégation », Ville, Exclusion, Citoyenneté, op. cit.; Haut Conseil de l’intégration, Pour un modèle français d’intégration, Paris, la Documentation française 1991 ; Schnapper (D.), La France de l’intégration, Paris Gallimard 1991 ; Beaud (S), Noiriel (G), « Penser l’intégration des immigrés » « , Face au racisme T.II, Paris, La découverte, 1990.
[25]. Véronique De Rudder, Autochtones et immigrés en quartier populaire, d’Aligre à l’îlot Chalon, Paris l’Harmattan, 1987 ; I. Taboada-Léonetti, « territorialisation et structuration communautaire : les Asiatiques dans le 13° arrondissement de Paris », Espaces et société, N°45, juillet décembre 1984 ; Véronique de Rudder, « trois situations de cohabitation pluri-ethnique à Paris », Espace et Société, N°45 ; Véronique de Rudder, I. Taboada-Léonetti et F. Vourc’h, Stratégies d’insertion et immigration, Paris, Iresco, 1990 ; Gilles Kepel, les banlieues de l’Islam, Paris, Le Seuil, 1987. Henri Mendras consacre un chapitre aux « contrastes régionaux et éthniques » dans La seconde révolution française 1965-1984, Paris, Gallimard, 1988.
[26]. Racisme et modernité, sous la direction de Michel Wieworka, Paris, la Découverte, 1992, notamment Alain Touraine, « Le racisme aujourd’hui ».
[27]. Martine Fourier et Geneviève Vermes, dir. Ethnicisation des rapports sociaux , L’Harmattan, 1994.
[28]. Dans le N° d’Esprit consacré à la France des banlieues
[29]. Wieviorka (M.) La démocratie à l’épreuve, nationalisme, populisme, ethnicité, La découverte 1995
[30]. Dubet (F), La galère, Paris, fayard, 1987
[31]. Donzelot(J.), Roman (J.), « le déplacement de la question sociale », et Donzelot (J), « Le social du troisième type » dans Face à l’exclusion, op. cit.
[32]. L’INSEE, à l’occasion du recensement de 1990 a d’ailleurs affiné ses catégories en ce qui concerne les immigrés et les étrangers.
[33]. Dubedout (H), Ensemble, refaire la ville, Doc Fr. 1983; Bonnemaison , face à la délinquance, prévention, répression solidarité, doc. fr., 1983; Schwartz (B) , l’insertion professionnelle et sociale des jeunes en difficulté, doc. fr. 1981
[34] . Bertho (A.), « Marginalisation, insertion, de quelle crise parlons-nous ? », Avis de Recherches, février 1994
[35]. Canguilhem (G), Le normal et le pathologique (1966), PUF, 1991.
[36] . Bertho (A.), La crise de la politique, L’Harmattan, 1996